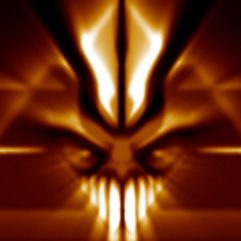Un délicieux Carnage
roman
Une Aventure d’Albert le Dingue
Avertissement : Ce texte est une première impression, un premier jet. 10-1-2006
« Pas besoin d’être
Anglais
Pour étrangler… »
Albert le Dingue
Poésies
Lundi 1er septembre
« Le Rayon Vert »
16 :00
Je me souviens avoir écrasé mes premiers vers de terre vers l’âge de trois ans, c’étaient des lombrics rouges et longs que je trouvais dans la terre du jardin fraîchement bêchée. Au début, je les coupais en deux, et les deux morceaux continuaient de gigoter chacun de leur coté. C’était amusant et rassurant. Car, à ce moment là, tous les espoirs étaient permis. Un Monde dans lequel chaque morceau aurait sa vie propre dès lors qu’on le coupe, me convenait parfaitement.
Et puis, l’envie d’en savoir plus, d’aller de l’avant, de comprendre, de générer du progrès, était tellement irrésistible que j’ai continué mes expériences. J’ai donc coupé de nouveau les deux morceaux du ver en deux, ce qui faisait quatre morceaux. Et j’ai remarqué avec stupéfaction qu’ils gigotaient déjà beaucoup moins. Intrigué, j’ai continué, jusqu’à ce que je les écrase avec un caillou, que je les pile et qu’ils deviennent une crème rougeâtre, plutôt peu ragoûtante. Et là, comme un savant, je suis resté des heures à observer la chose.
Et bien, ça ne bougeait plus du tout. La crème rouge restait désespérément inerte. J’avais beau la titiller avec une brindille. Rien à faire.
Pour la première fois de ma vie, je me penchais sur le puits de l’angoissante métaphysique et je n’en voyais pas le fond…
Ce jour-là, j’ai compris ce qu’était le vertige.
J’ai récupéré le « truc » avec une petite cuillère en plastique et je l’ai mis dans une petite boîte d’allumettes vide. Toute la nuit j’ai gardé la boîte sous mon oreiller en écoutant un possible bruit qui se serait inévitablement produit, si la chose s’était remise à vivre. J’avais même glissé dans la boîte de quoi manger, un peu d’herbe, quelques gouttes d’eau.
Et rien…
Je me souviens, le lendemain, j’ai renouvelé l’expérience, avec une limace que j’ai mélangée à un escargot. Je les ai bien broyés, avec la coquille, et j’ai observé. J’ai dû me rendre à l’évidence, ils ne bougeaient pas plus. Pire encore, quand j’ai retrouvé la première boîte d’allumettes sous mon oreiller, plusieurs jours après, ça puait…
A cet instant, j’ai eu la révélation que ce monde était infiniment cruel. Et qu’il allait me falloir rester « entier », le plus longtemps possible si je ne voulais pas finir comme mes lombrics.
Plus tard, à la boucherie de mon père, je voyais passer les carcasses de bœufs qui venaient de l’abattoir. Je me cachais, parfois, pour me faire peur, dans la chambre froide. Là, tapis dans la semi obscurité glacée, je regardais attentivement ces monstres sanguinolents et inertes, pendus aux crochets, et je méditais. On m’avait appris à l’école que les cadavres des dinosaures s’étaient transformés, au cours des millénaires, en pétrole, dans le sous-sol. C’était donc du dinosaure que mon père mettait dans la voiture pour faire marcher le moteur. Je caressais l’idée que, peut-être, moi aussi, dans quelques millions d’années, je servirais de carburant à un énorme vaisseau spatial qui transporterait des extraterrestres épouvantables et dégoûtants. Malgré sa poésie, cette idée ne me consolait pas.
Très tôt, j’ai aimé les steaks hachés que ma mère faisait cuire avec des pommes de terre du jardin. C’était succulent. Elle ajoutait un petit hachis d’échalotes crues sur la viande et plein de jus. Au début, dès la première bouchée, j’ai cru mourir de dégoût. Puis, à force de mastiquer, je me suis mis à aimer ça, passionnément. J’avais goutté aux lombrics écrabouillés, et je les avais très vite recrachés. J’imaginais que le bœuf était meilleur que le lombric car il était plus proche de moi, physiquement… Mon idée était que, dans l’échelle des valeurs, la meilleure chose au monde, c’était moi.
Un jour, j’ai voulu procéder à la fabrication de mon repas, ma mère étant très occupée à rendre la monnaie aux clients dans la boucherie.
J’ai mis des beaux morceaux de viande bien rouge dans le hachoir électrique. Puis j’ai appuyé sur le bouton, rouge lui aussi. La machine s’est mise à broyer avec un bruit sans équivoque. La viande hachée a giclé par les petits trous du hachoir comme de la pâte à modeler. Cependant, un morceau de viande rebelle avait échappé au carnage, il n’était pas descendu au fond du hachoir et était resté désespérément accroché à la paroi. C’est alors que j’ai eu la très mauvaise idée de le pousser du bout de l’index et d’appuyer sur le funeste bouton rouge. J’ai senti une succion désagréable. Ma phalange y est passée. J’ai aussitôt retiré ma main. Je ne sentais rien. J’ai juste vu qu’il me manquait trois bons centimètres de mon index. C’est alors que je me suis mis à gigoter comme un lombric coupé en deux.
Affolée par mes cris, ma mère est arrivée en courant. Elle a poussé un hurlement terrible, qui raisonne encore dans mes oreilles.
Depuis cette histoire, je mange la viande hachée avec respect. Et pendant longtemps, la nuit, je n’ai pu m’empêcher de penser que, coupé en morceaux si jeune, j’avais désormais moins de chance que les autres de vivre vieux. J’imaginais mon doigt mort, qui devait sentir mauvais, quelque part. Fort heureusement, je n’avais plus la conscience ni le souvenir d’avoir « été » ce doigt. En fait, je l’avais toujours considéré comme un étranger. Et peut-être que, sans le savoir, j’avais commis la terrible faute de ne pas avoir été suffisamment à l’écoute de ce doigt, quand il faisait encore partie de ma main. Peut-être même en a-t-il souffert le martyre ? Depuis je regarde mes autres doigts différemment, je les écoute, je les caresse. Parfois même, quand je réfléchis intensément, je les passe sur mes lèvres. J’ai regretté vraiment, pendant très longtemps, de n’avoir pas mangé le steak haché contenant mon pauvre doigt.
A cinquante ans, je porte une prothèse en plastique avec un faux ongle. Non pas que j’aie honte de mon moignon, mais j’évite les signes distinctifs. Je préfère me fondre dans la masse. Surtout dans les aéroports.
Le vol 666 au départ de Londres a du retard. Je suis assis dans la salle d’embarquement depuis plus d’une heure. J’avale une pilule de Xanax, j’ai ma demi-bouteille d’eau.
C’est long…
J’ai décidé de partir quelques jours au soleil, au bord de la mer. J’ai fait ma valise sur un coup de tête. J’ai ressenti un besoin impérieux d’immensité, de parfums affolants, de calme et de silence métaphysique. Pour moi, le bonheur est simple comme quelques victuailles que je déguste, quelques cigares que je fume, quelques verres d’alcool que j’avale, après les avoir fait longuement tourner et retourner dans ma bouche.
J’aime le sud-ouest, les plages de sable blanc à perte de vue, les dunes, pendant l’arrière saison. J’adore le canard gras : son foie, son cœur saignant, aillé et persillé, sauté à la poêle, ses cuisses confites, son magret cuit au gros sel de Guérande, sa carcasse dorée aux braises dans la cheminée. Surtout quand une poêlée de cèpes de Bordeaux les accompagne. Je dis de Bordeaux car, parfois, ils vous servent des cèpes de pins ou des espagnols qui, de mon point de vue, sont aux cèpes ce qu’est la vérole au bas clergé breton, ils vont bien ensemble, mais ils n’ont pas le même goût.
Il y a tellement de poésie dans le canard et l’oie. Accompagné d’un vin de Saint Mont rouge, c’est une « tuerie », si je puis dire…
Et puis, je vais rejoindre Simona. Là-bas. Je sais qu’elle m’attend, depuis vingt ans…
J’ai fait tellement de choses depuis vingt ans. Lorsque je regarde derrière moi, je ressens comme un vertige, tellement j’ai travaillé. A la force des poignets, j’ai acquis un savoir faire, comme on dit. Je suis devenu un professionnel respecté. Mes clients me donnent encore aujourd’hui toute leur confiance. Et, bien que je pratique des tarifs exorbitants, ils payent cash, en mallette de billets, dollars ou euros, en fonction de la conjoncture économique. J’ai toujours un œil sur la bourse.
Bien sûr, j’investis régulièrement de grosses liasses de billets en recherche et développement, pour ne pas être dépassé par la concurrence impitoyable qui sévit dans le milieu. Les technologies évoluent si vite. Ma force, c’est le cash que j’ai planqué un peu partout, dans une quinzaine de pays pour être exact. Il faut être malin aujourd’hui. Les banquiers m’adorent et m’envient, alors que je les déteste et les méprise. Ce sont des pions que je pousse. Je connais par cœur les méandres tortueux de leur raisonnement alambiqué qui n’ont qu’un but : voler mon argent. Il faut dire qu’au début de ma carrière, pour obtenir mon concours de tueur, j’en ai éviscéré trois, avec un coupe papier, et j’ai été reçu avec mention.
Dans mon métier, j’essaie toujours d’avoir une éthique : un banquier s’éviscère avec un coupe papier, bien aiguisé naturellement. Par contre, un jardinier, je lui briserais les os avec un râteau. Ce n’est pas toujours évident de trouver la technique adéquate. Un avocat, par exemple, je vais l’achever à coup de barreaux.
Parfois je cale…
Je ne m’emmerde pas, une balle dans le crâne, une autre dans la pendule, ça fait l’affaire :
« Pan ! pan ! »
17 :00
Je tue le temps, pour ne pas perdre la main…
L’aéroport d’Heathrow grouille de voyageurs. Je les observe un par un. Bientôt, tous ces braves gens seront rangés côte à côte, dans d’énormes boîtes métalliques volantes, comme des sardines riches. Ils boiront un whisky ou du coca-cola à dix mille mètres d’altitude au dessus du vide, transgressant ainsi une loi fondamentale de la nature qui dit que :
« Tout corps jeté en l’air doit retomber violemment sur le sol ».
Ils s’étonneront ensuite que la nature se venge en provoquant des cracks boursiers, des tornades ou des cancers.
Les lettres s’agacent enfin avec un cliquetis sur le panneau d’embarquement :
London / Biarritz : BOARDING GATE 06
Je suis fixé. L’embarquement du vol commence enfin. Je vérifie que j’ai le bon passeport et le billet. Ils sont bien là, dans ma poche révolver. Je n’ai pas de bagage à main car j’aime me sentir libre, mais surtout, j’évite les contrôles inutiles. Tout à l’heure, les douaniers ont passé un produit réactif, avec un long coton tige, dans la trousse de toilette d’une femme qui était devant moi. Que cherchent-ils ? De la drogue ? Des explosifs ?
Peut-être prélèvent-ils des échantillons de cellules, un cheveu dans la brosse, un spermatozoïde mort de peur dans une capote usagée qu’elle garde par amour. Ils fichent. Ils matent. Il y a des caméras partout. Malheureusement pour eux, et heureusement pour moi, ils ne peuvent pas encore lire dans mes pensées. Je peux donc imaginer ce que je veux, librement, même les pires des saloperies, les pires des turpitudes, en toute légalité.
Avec les techniques informatiques, on sent bien que la captation de la pensée est pour demain. Lorsqu’on émettra une pensée, comme quand on parle dans un téléphone portable, celle-ci sera captée par un programme « Echelon » quelconque qui stockera ces informations dans un zone sécurisée du réseau, ce cerveau collectif et planétaire. Et là, mes aïeux, finies les vilaines idées ; il faudra faire taire cette voix bavarde qui parle constamment dans notre tête. Il nous restera peut-être l’hyper-moi ou l’inconscient, qui nous enverra parfois des SOS ou des messages codés, sous forme d’actes manqués ou de lapsus.
J’espère que, ce jour là, je serai mort…
En attendant, je passe le contrôle. La jeune femme derrière son guichet me tend mon billet et mon passeport optique.
— Have a nice trip, monsieur Dumoulin.
Elle récite, sans me regarder. Je ne la regarde pas non plus. Il ne faut jamais regarder un flic, un maton ou un employé quelconque. Jamais. Je file dans les couloirs sans fin.
« Monsieur Dumoulin »
J’imagine la tronche dégueulasse de Dumoulin, tordue dans son sac poubelle en plastique. Il l’a bien cherché.
Me voici dans l’Airbus de la British Airways. C’est important d’avoir un passeport optique, ça rassure les flics et les douaniers. Sur un présentoir, je prends le Times, pour faire chic, et m’assois sur le siège 75, à côté du hublot, ma place préférée. J’attache ma ceinture. Une asiatique sans âge se vautre sur le siège d’à coté. Elle porte Opium d’Yves Saint Laurent. Je suis incollable en parfum pour dame. J’en fais une grosse consommation. C’est un truc personnel pour effacer certaines odeurs déplaisantes quand je travaille.
Ma voisine ouvre Vogue et me bouche la vue. On devrait interdire ces formats de magazine dans les transports. Je mate, malgré moi, le fascisme qui s’étale sur ces pages glacées : la race supérieure est là, sur chaque photo de mode, humanoïdes décharnés, adolescents asexués, beaux et froids avec une expression de jouissance glamour, voire d’orgasme à la limite du ridicule. Dans quelques années tous ces jolis corps seront putréfiés, volatilisés. Vogue n’est qu’un marchand de cadavres, il aurait pu s’appeler Meat ou Dust.
17 :30
L’airbus 387 de la British Airways décolle dans le ciel anglais. Dans deux heures, je serai à l’hôtel Miramar, les pieds dans l’eau. Je ferme les yeux…
Je pense à Albert Einstein, à son cerveau conservé dans un bocal rempli de formol, posé sur une étagère poussiéreuse du département médicolégal de l’université de Princeton. Je pense à la relativité, au temps qui se contracte avec la vitesse et qui justifie le fait que, pour se décontracter, il vaut mieux, oh combien, rester sur place, si possible allongé dans une chaise longue au bord de la piscine. Mon cerveau à moi tourne comme une planète autour d’un soleil froid, quand un hémisphère dort, l’autre veille et vice versa. Ma mémoire est peuplée de fantômes et d’anges qui vivent là, tapis. Ils sont ma famille et mes amis… Quand je voyage, je pars avec eux.
Je vois le beau visage de Simona qui me sourit et qui m’attend dans la chambre 109. Je passe dans un monde parallèle. Je ressens l’énergie noire. Je me consume, je trace dans l’espace comme un météore qui joue avec la vie et la mort, l’ombre et la lumière, le chaud et le froid.
Qu’est ce que je fous là ? Dans ce scénario dont nous savons tous qu’il se terminera mal, très mal, dans l’ombre, le froid et la mort. Car le pire est toujours devant nous, il ne faut pas se raconter d’histoires. Il n’y a qu’à voir les vieux en phase terminale. A ce propos, je suis émerveillé par la richesse de la langue française, quand elle fait rimer hospice et pisse. Abstinence et incontinence. Corps et mort…
L’avion décroche, ça bouge. A gauche à droite. On se crashe ? Ça m’ennuierait de finir en bouillie rouge comme les lombrics de mon enfance… J’ouvre les yeux. C’est un trou d’air.
« Détends toi, Albert… »
Je n’aime pas l’avion. Je pense à tous ces pauvres bougres qui sont morts, hachés menus, carbonisés comme des steaks anglais dans des catastrophes aériennes. Que ressent-on lorsque sonne le moment suprême ? Hein ? Rien sûrement. Le cerveau crée une chimie spéciale qui court-circuite les sens. On est comme quand on dort. Comme avant qu’on naisse. Il n’y a rien derrière la mort, que l’ombre, le silence, le froid, éternel. Le seul endroit où nous pouvons nous prolonger existe peut-être dans les rêves et les cauchemars des proches qui nous survivent. Les souvenirs et les fantômes de l’aube, que le temps balaie d’un revers de manche.
La mort est mon métier. J’ai expérimenté et acquis, d’abord des convictions, puis des certitudes, basées sur des expériences que j’ai renouvelées avec le même succès. Quelque part, je suis un scientifique.
Je me rappelle avoir fait un pacte avec un client que je devais occire pour le compte d’un homme politique connu. Une exécution classique qui ne présentait aucune difficulté. La victime était un homme très intelligent mais extrêmement douillet. Comme quoi…
Il avait été kidnappé et la famille avait oublié de payer la rançon. Comme il paniquait, je l’ai convaincu d’accepter d’être occis sans douleur et par surprise. En échange, (nous avions convenu d’un code), il devait me serrer la main s’il voyait une autre vie, au moment fatidique où il passerait de vie à trépas.
Je lui fis, tout en lui tenant la main, le coup du « rat », cette terrible manchette qu’on applique entre les yeux avec un journal plié (un truc de professionnel).
Il est mort sur le coup, les yeux exorbités, avec une expression de surprise, du style :
« Merde alors… »
Et bien, il ne m’a rien serré du tout. Mais il a chié dans son froc, une merde posthume.
Ça fait réfléchir…
Oui, ça fait réfléchir…
Chaque fois que je peux, j’observe attentivement, au ralenti, le passage de vie à trépas. L’instant où le regard se fige, les pupilles se rétractent. Le souffle devient un râle, les jambes tremblent plus ou moins fort, sûrement par panique, mais le cerveau sécrète immédiatement l’endomorphine qui coupe les circuits. Tout se passe comme quand on éteint son ordinateur portable. Rien. L’homme n’est rien à l’échelle de l’univers. Et la vie après la mort, comme on dit dans le milieu, c’est de la « couille de loup ». Les dames excuseront mon langage, c’est un pro qui parle.
L’hôtesse me tend mon plateau repas.
— Coffee, dis-je, dans un anglais impeccable.
J’examine le plateau. Je trouve une sorte de savonnette en guise de pâté. Dans une barquette, un bout de barbaque indéfinissable baigne dans de la confiture verte. Il n’y a que le pudding qui trouve grâce à mes yeux. Je le plonge dans le café et le dévore en trois bouchées. Ça coule sur mes doigts.
En fait, j’avais faim, et quand j’ai faim, je deviens irascible et parfois même, je peux devenir méchant. Je broie du noir. Je bois le café, il est ignoble. J’avale une nouvelle pilule.
Je pense à Simona, à sa jeunesse. Au décalage absurde qui sépare la jeune fille désirable de la femme plus austère qu’elle est devenue en quelques années. La jeune fille a ce je ne sais quoi de fraîcheur, de courbure dans les formes, qui la rendent bien plus désirable que la femme qu’elle sera plus tard. Et pourtant c’est un âge ingrat, fait de temps perdu, d’esthétique magique mais inutile, rendu stérile par cette éducation puritaine qui pollue les esprits.
J’ai aimé Simona à la folie, il y a plus de vingt ans. Son fantôme ne m’a jamais quitté. Il est en moi, pour toujours. Il partage mes états d’âme et mes douleurs. Le spleen, nous l’oublions en nous abrutissant de travail, en fonçant tête baissée dans la vie et dans la mort, comme des bolides, sans regarder le monde autour de nous.
Est-ce l’âge ? Est-ce l’expérience qui me pousse aujourd’hui à m’arrêter, à réfléchir, à faire le point, à jeter un regard en arrière, comme dans le vide, lorsqu’on s’agrippe désespérément à une paroi vertigineuse.
Je somnole.
Le temps passe, indifférent, comme dans du coton.
Soudain, mes oreilles se bouchent. On descend. Je jette un œil par le hublot. J’aperçois l’océan et la côte d’argent. Je reconnais Biarritz, la côte basque. Mon terrain de chasse. Je sens déjà l’odeur iodée des huîtres. J’aime regarder en bas quand je suis à côté du hublot. On relativise mieux les choses de la vie. Ça tape sous mes pieds. Le train d’atterrissage est sorti. L’Airbus atterrit. On s’immobilise enfin.
Je fais la queue dans l’allée, sagement, comme un enfant, en évitant à trois reprises d’être assommé par les bagages que des retraités récupèrent nerveusement dans les portes bagages. On devrait sortir ces pauvres vieux de la circulation, l’euthanasie est un droit qui faudra finir par leur donner. En sortant, je salue le personnel, l’hôtesse qui porte Organza de Givenchy. A ce propos, je me rends compte que je n’ai jamais travaillé dans l’aéronautique, je veux dire dans le milieu de l’aéronautique, je n’ai jamais éviscéré une hôtesse de l’air, par exemple.
A la sortie, sur le tarmac, une bouffée de chaleur m’enveloppe. Derrière l’odeur de kérosène, je flaire l’iode de la mer.
Dix minutes plus tard, après avoir récupéré mes bagages, je hèle un taxi :
— Hôtel Miramar, s’il vous plait, jeune homme.
19 :55
Le taxi démarre en trombe. Il fait beau. Le tableau de bord de la Mercedes est bourré de technologie clignotante, ça sent le skaï et le déodorant. Le chauffeur se tait, il manipule son GPS en conduisant
Ah, la technologie… les produits blanc et noirs.
La radio diffuse Chambre avec Vue en sourdine. Une petite sainte vierge en plastique suspendue à une ficelle au rétroviseur oscille de droite à gauche, comme beaucoup d’indécis.
Très vite, on longe la plage, on traverse la forêt de pins.
— Ça circule plutôt pas mal, dis-je pour engager la conversation.
— Ça pour circuler, ça circule.
Le chauffeur a un accent à couper au couteau.
— Vous savez, la meilleure saison c’est septembre. Juillet c’est pourri et au mois d’août c’est le trop plein.
Soudain, un piéton traverse au rouge, il pile :
— Hil de pute, regardez moi ce couillon, éructe-t-il.
Quelques minutes plus tard, nous tournons dans le parc devant le Miramar. J’ai le cœur qui s’excite. La façade n’a pas changé, elle est couverte de glycines.
Des parterres fleurissent la petite allée de gravier qui mène à la porte de chêne. Ça crisse sous mes pas. J’entre. C’est vieillot et charmant. Une employée de l’hôtel s’affaire à encaisser un couple d’amerloques qui va profiter de mon taxi pour gagner l’aéroport. Puis elle s’adresse à moi :
— Monsieur ?
— Paul Montebourg.
Je lui tends un de mes passeports. Ici, je suis désormais Paul Montebourg, auteur de romans, journaliste d’investigation sur les tueurs en série, venant de Montréal chercher l’inspiration. Elle pianote, ses ongles font un drôle de petit bruit sur les touches de son ordinateur. Elle porte Amen de Thierry Mugler. Trop épicé pour moi…
Elle me tend une fiche et un crayon. Je connais par cœur l’identité de mes deux cents vingt passeports.
— Vous avez la chambre 109, comme vous l’avez demandé, me dit-elle, en me tendant la clé. Elle donne sur l’océan.
Je lui rends son sourire. Je prends la clé. Le cuivre est usé, c’est peut-être la même clé que j’ai tenue il y a vingt ans. Je reconnais le porte-clé qui représente une petite pomme de pain en étain. Je la glisse dans ma poche.
— Merci.
— Le petit déjeuner est servi au salon ou en terrasse s’il fait beau, le repas également. Les ascenseurs sont au fond du couloir à droite. Je vous souhaite un agréable séjour, monsieur Montebourg, récite-t-elle.
Décidément, l’accueil laisse à désirer, il y a vingt ans j’avais droit aux égards chaleureux de la patronne, à un verre de vin rouge et il n’y avait pas d’ascenseurs. Mais la vioque a cassé sa pipe et c’est une multinationale qui a repris.
« Quelle poignée de misère ! »
Je récupère mon passeport. Je traverse le couloir et prends les escaliers. Ça sent le vieux et le propre. J’entends le reniflement énervé d’un aspirateur. Les couloirs de l’étage ont été retapissés. Je remarque que l’électricité a été refaite. J’arrive devant la porte de la chambre 109. J’enfonce la clé dans la serrure. Vingt piges ont passés depuis la dernière fois que j’ai tourné la clé dans cette serrure. Je pousse la porte, doucement. Je déguste cet instant comme un gâteau sec. J’aperçois le lit, la table de chevet, le balcon. Les rideaux volent un peu, je sens un souffle d’air. L’océan brille au loin sur la terrasse. Le soleil couchant baigne le grand lit de ses rayons rouges, dans le silence. Vingt ans, j’ai l’impression que c’était hier.
Je projette mes souvenirs comme un calque. Les murs sont éclaboussés de sang. Le lavabo déborde de viscères. Sur la table tachée, les restes du repas, le plateau en argent, le couvert, le seau à champagne sont maculés eux aussi. Simona est paisible, écartelée les bras en croix, attachée sur le lit, dans sa jolie robe blanche, les yeux grands ouverts, regardant l’Éternité. Il y a un grand trou béant dans sa poitrine. Son cœur rouge palpite encore sur l’assiette blanche en porcelaine de Limoge.
Simona… Mon amour.
Je me recueille.
Vingt ans déjà. J’entre. Je m’assois sur le même lit et touche la cretonne du dessus de lit, du bout des doigts. Le tissu blanc est immaculé. Je regarde autour de moi. Tout est propre. Je pose ma main sur le mur, près du lit, à la recherche d’une minuscule trace. Juste une trace… Je me mets à quatre pattes et scrute le parquet, millimètre par millimètre, sous le lit. Soudain dans le bois d’une plinthe, une cavité minuscule. Je me penche. Là, dans la cavité, une petite éclaboussure marron. Serait-ce possible ? Elle est microscopique. Je me penche encore et du bout de la langue je lèche le bois à cet endroit. Je salive, suce cette ultime gouttelette de sang, vingt ans après.
La minuscule tâche a disparu. Mes tempes battent. Une sorte d’orgasme me secoue. Je tétanise. Les larmes montent. Mon corps, que je ne contrôle plus, tombe sur le sol comme une serpillière humide. Je sais que la crise va passer comme elle est venue. Je pleure comme un enfant.
Il faut que je respire…
Je me relève et m’allonge sur le lit. Je transpire. J’ai l’impression d’avoir avalé dix pilules de valium. La lumière du balcon m’éblouit. Mes pupilles se contractent. Là-bas, au loin, un voilier rentre, il fend l’océan dans le soir.
Quand on frappe à ma porte. Je panique. Je m’assois sur le lit, réajuste ma chemise, essuie ma bouche.
— Bagages, crie une voix derrière la porte.
Je me précipite et ouvre. Un groom est là avec mes bagages. Il doit avoir dix huit ans.
Posez-les là, dis-je, un peu sonné.
J’ai la tête qui tourne.
— Bien monsieur.
Il entre et pose ma grosse valise.
— Monsieur n’a besoin de rien ?
— Non, merci
Il me dévisage, et insiste poliment en fronçant les sourcils.
— Monsieur est sûr ?
— Non merci !
Il m’énerve. Je prends une poignée de monnaie dans ma poche que je lui donne, et je ferme la porte. Dans la salle de bain, le miroir me renvoie ma tête de déterré. Je me débarbouille. L’eau fraîche me fait du bien. J’ai très soif. Je vais aller prendre un verre sur la terrasse. Il faut que je respire.
Impérativement.
Je sors de la chambre et tourne la clé…
20 :45
Quelques minutes plus tard, je m’attable à la terrasse de l’hôtel, face à la mer. Cette fois ça y est, je suis Paul Montebourg, journaliste, écrivain, de la racine de mes cheveux gris, aux ongles jaunis de mes gros orteils.
Devant moi, le sac et le ressac vont et viennent, ils lavent et relavent le sable de la plage. Chaque grain y passe, aucun n’est oublié. La marée est déjà haute. L’océan me fascine, il piège mon regard, saisit mon esprit et l’emmène là-bas, à la frontière de mes souvenirs.
Je reprends mes esprits. Le bleu de la mer, comme un vertige délicieux, calme mon angoisse avec l’efficacité d’un Lexomyl qui serait accompagné d’un whisky tourbé sur glace. C’est magique. Je ferme les yeux et respire. Je vois Simona, elle fait dorer son corps d’ange sur le sable de la plage. L’air iodé a encore un parfum d’ambre solaire, preuve irréfutable du passage de la meute des touristes. Il fait encore très chaud en ce premier jour de septembre. Je suis surpris d’être encore là…
— Vous voulez voir la carte, Monsieur ?
La voix brise ma rêverie. La serveuse du Miramar pose la carte sur la table de bistro en fer. Le désagrément qu’elle me cause est aussitôt compensé par la beauté de son visage et de ses cheveux tirés. Elle porte un joli tablier blanc sur une jupe noire et me regarde de ses yeux verts et tristes que subliment les rayons aveuglants du soleil couchant. Je m’aperçois que je suis seul sur la terrasse, sous un parasol Pepsi-Cola que le vent secoue nerveusement, comme un dératé. La lumière est pourpre.
— Non. Ce sera un whisky Sour avec du Jack Daniels, s’il vous plait, dis-je avec une voix que je veux aussi neutre que possible.
— Bien monsieur.
Elle tourne des talons et s’éloigne. Je ne peux m’empêcher de jeter un regard furtif sur sa taille de guêpe et ses longues cuisses. Elle monte les marches en roulant des hanches et disparaît dans l’encadrement de la porte de l’office.
— Elle allume la petite, me dis-je.
J’allume une Craven et tire une longue bouffée. Au loin, le soleil plonge dans la mer, la plage à perte de vue est déserte. Le temps passe délicieusement.
Soudain, à travers les verres fumés de mes ray ban, je crois voir le dernier rayon du soleil qui plonge dans l’océan : le sublime Rayon Vert.
Je dois faire un vœu, là, immédiatement. C’est la tradition lorsqu’on voit le Rayon Vert. Je revois le regard triste et la silhouette de la fille qui me sert. Je fais le vœu de ne rien faire, je suis en vacances pour une semaine, je ne ferai rien de ce qui peut ressembler au travail du professionnel que je suis.
— Je ne ferai rien !
Je fais souvent des vœux, et la plupart du temps ça marche…
Je savoure cette première heure de vacances. L’hôtel Miramar a gardé ce côté suranné, dérisoire, chaque chose est restée à sa place. L’odeur des couloirs a la même délicatesse sublime du pain ancien, du linge propre, et des parfums de dames mêlés aux tabacs blond des américains de passage. Odeurs de voyage, de sels de bain, de mer et de sable.
Quand je les entends descendre les marches, elle et le tintement des glaçons dans le verre, je ne peux m’empêcher de tressaillir. Sans trembler, elle pose délicatement le plateau sur la table. Dans son verre évasé, le Sour a un aspect impeccable. Elle me tend la note et un stylo à bille.
— Le numéro de chambre et la signature, s’il vous plait ?
Sa voix tinte comme une clochette.
Je marque le numéro 109 et signe la facture.
— Merci, souffle-t-elle en récupérant le stylo et la note. Le dîner sera servi à partir de vingt heures.
Elle essaie d’être agréable. Lorsqu’elle se penche, je vois mon regard glisser malgré moi dans son cou, elle porte une petite médaille de la vierge, accrochée à une chaînette en or, et un soutien-gorge en dentelle, blanc.
Dans le soir subtil, le Sour s’avère savoureux.
Je me laisse aller à quelque vers que j’écris sur la nappe :
« A la lueur
De l’aube
L’Éviscérateur
Mange
Le cœur
D’un ange
Emasculateur
Il broie son cœur
Déchire les chairs
Du cher
Fantôme
Fait homme
Dans l’aube
Qu’enrobe
Un brouillard
Épais comme
Le sang neuf
Qu’aux abois
Le loup boit
A la lueur
De l’aube… »
En me relisant, j’ai l’impression d’entendre les clappements d’un loup dévorant une charogne. Je déchire le bout de nappe en papier et le glisse dans ma poche.
21 :15
Lorsque la fraîcheur tombe, je remonte dans ma chambre. Je range quelques affaires et je prends une douche. J’examine la baignoire, il y a la rayure sur le fond. C’est bien la même, bien que la salle de bain ait été repeinte. Mes souvenirs sont d’une précision surprenante. Je retrouve en détails tout ce que j’ai méticuleusement consigné dans ma mémoire. Je reviens dans la chambre. J’examine le parquet, il n’a pas bougé. C’est du parquet en point de Hongrie, qui date de 1850 environ. Un parquet indestructible, qui grince légèrement. Je me mets à quatre pattes. Je compte les lattes, je me souviens du code :
« Mort de Louis XIV : 1715»
Au croisement de la latte 17 et de la 15, je compte, sous le lit, la latte est intacte. Je prends la clé de la chambre, elle est suffisamment plate pour passer dans l’interstice irrégulier. D’une pression sur la clé, je fais levier. La latte bouge ; je coince la clé dessous. Encore un effort. Je soulève la latte entière. Elle est supportée par deux solives, entre les solives, un trou. Je passe ma main, enfonce mon avant bras, je la sens, la sacoche, elle est là, au fond. Je la retire délicatement. Ma sacoche en toile. Je l’ouvre à la manière d’un archéologue qui aurait trouvé une relique extraordinaire. Je caresse la lame du « saigneur à désosser ». A ses cotés, un équarisseur. Un couteau filet de sole à la lame souple. Un fusil à aiguiser. Un sachet rempli de poudre blanche. Un superbe couteau de cuisine japonais, qui tranche mieux qu’une lame de rasoir.
On raconte qu’un bourreau trancha un jour la tête d’un condamné avec ce couteau. Après l’opération, le condamné tout joyeux s’adressa au bourreau en lui disant :
— Regarde, tu m’as loupé, ma tête tient encore.
Et le bourreau lui répondit :
— Bouge un peu ta tête, imbécile.
Le condamné bougea sa tête et celle-ci roula sur le sol…
Ce sont de merveilleux couteaux. Je prends l’objet, méticuleusement. Je lèche la lame en évitant de me trancher la commissure des lèvres. Il ne reste rien qu’un goût de métal. Mais j’ai fait un vœu : je suis en vacances. Je range les lames dans le sac et remets le sac à sa place dans le trou. Je replace délicatement la latte de parquet. Nettoie la poussière. C’est parfait. Plus aucune trace de rien. Je repousse le lit.
La nuit est tombée, je meurs de sommeil.
Je branche mon ordinateur portable que je pose sur le bureau de la chambre, enfin, je veux dire l’ordinateur de Paul Montebourg. Il s’allume. Je constate avec satisfaction que le Wi-fi fonctionne. Ils sont en progrès dans l’hôtellerie de province. Je vérifie ses e-mails et les miens. Rien à signaler.
Ce qui est formidable avec Internet c’est la facilité avec laquelle on garde son anonymat en communiquant. Je n’ai pas de téléphone portable, c’est trop dangereux. Je téléphone depuis des appareils fixes. Le meilleur moyen de communiquer sans risque d’être alpagué par la police, c’est le courrier électronique. On l’expédie depuis des adresses bidons, sur des ordinateurs différents, on crypte le message en évitant les mots qui éveillent l’attention et le tour est joué.
J’extrais de mon sac le livre de poche de Paul Montebourg. Ce salaud a eu le culot d’écrire un bouquin sur moi, il a enquêté sur moi, c’est lui qui a ébruité ce surnom ridicule « Albert le Dingue ». Albert est mon vrai prénom. « Le Dingue », c’est parce ils ne savent pas qui je suis, et parce que je les ai toujours surpris. J’ai toujours été là où ils ne m’attendaient pas… Ils essaient de me faire passer pour un fou. Ceci dit, Montebourg ne l’a pas emporté au paradis.
Je suis fatigué. J’avale mon dernier Xanax et je me couche. Je me colle contre l’oreiller et entame la lecture du bouquin. J’ouvre une page au hasard :
« On l’appelle Albert le Dingue. Il est non seulement un tueur en série, mais il est aussi tueur à gages, à la solde de la pègre internationale. Insaisissable, la police ne possède rien de concret sur l’identité réelle du tueur, certains policiers sont même convaincus qu’autour de ce patronyme se cache une véritable organisation internationale. Albert le Dingue, comme beaucoup de tueurs en série, ne connaît pas la peur, il tue comme il respire, froidement, sans états d’âme. Anthropophage, on raconte qu’il a dévoré à plusieurs reprises le cœur de ses victimes. »
Et alors, je n’ai pas bouffé le tien, peut-être… C’est minable, c’est cliché. On se croirait dans le « Silence des Agneaux ». Ça m’énerve…
« Le professeur Bossuet de l’hôpital Necker à Paris est persuadé que l’éviscération cardiaque est une sorte de signature morbide. Manger le cœur de ses victimes était un rite courant dans l’antiquité. Le vainqueur récupérait ainsi la bravoure et le courage de cet adversaire vaincu. Dans le cas du tueur en série, il faut interpréter ce rite différemment. Le tueur n’a cure du courage de ses victimes. Il faut voir ici un acte barbare qui concrétise la possession de l’âme de la victime par le tueur, le cœur étant le générateur, le centre vital. Manger le cœur est un acte intellectuel. N’est ce pas Alfred de Musset qui a dit :
« Frappe toi le cœur, c’est là qu’est le génie. »
D’après notre enquête, Albert le Dingue n’a mangé que le cœur de femmes jeunes dont on suppose qu’il en était amoureux. Par recoupement nous avons dénombré une vingtaine des victimes disséminées sur toute la planète. Toutes des femmes éviscérées dont on n’a jamais retrouvé le cœur. »
Je tourne quelques pages…
« Adolf Hitler était lui aussi un adepte de scatologie somatique. Il ne jouissait que lorsque sa compagne Eva Braun lui déféquait dans la bouche et sur le corps. C’était une manière refoulée d’expier ses crimes. Cette pratique a désinhibé son impuissance et réveillé des pulsions masturbatoires refoulées depuis son enfance. En se masturbant, il ouvrait une vanne de son subconscient d’où giclait un orgasme fascinant probablement mille fois plus porteur de plaisir que la moyenne des éjaculations humaine n’en procure. Cette surdose de plaisir explique la terrible dépendance qui en découlait et aide à mieux comprendre la machine infernale psychopathologique qui le rongeait de l’intérieur, un peu comme la réaction en chaîne d’une explosion atomique. La consommation de drogues hallucinogènes n’arrangeait pas les choses.
Dans le cas d’Albert le Dingue, on retrouve le même processus. Une masturbation infantile hypertrophiée. Probablement des viols à répétition que le futur tueur en série refoule. Et l’appel du sang dû à un environnement particulier. Le jeune Albert a probablement vécu dans une boucherie ou un hôpital, voire une morgue… »
Je tourne quelques pages :
« Sa technique de « planque » consiste à usurper l’identité de ses victimes et à vivre dans leur peau, avec leur argent. »
Ce bouquin est un cauchemar à lire. Finalement, j’ai fait une action humanitaire en éliminant un type aussi minable que Montebourg.
J’éteins la lumière qui, instantanément, laisse sa place à l’Ombre complice… Je leur en foutrai…
« Albert le Dingue» …
II.
Mardi 2 septembre
« Room-Service »
08 :00
On frappe à ma porte. J’ouvre un œil. Il est huit heures pile à ma Rolex. Pourtant je n’ai rien demandé. Je suis bien en vacances, je ne rêve pas. Je déteste être surpris en plein sommeil. Pâteux, je hurle :
— Qu’est ce que c’est ?
— C’est un pli urgent pour vous.
Je reconnais la voix du groom.
— Glissez-le sous la porte.
— Bien, Monsieur.
J’entends le bruissement du papier sous la porte. Personne ne sait que je suis ici. Énervé, je ramasse le pli et lis :
« Monsieur Montebourg, Je suis ravi de vous savoir en vacances au Miramar. J’ai adoré votre dernier livre : « Albert le Dingue ». Si nous faisions une interview et quelques photos pour le journal Sud-Ouest.
Répondez-moi vite au 99 22 35 82 44 – Daniel Desprat. Journaliste indépendant. »
Bordel de merde. Il est des moments où un tout petit grain de sable vient foutre en l’air une semaine de vacances méritées. Non seulement Montebourg est un écrivain médiocre, mais il est l’opposé physique de ce que je suis. Il a une tête d’imbécile. Il est, en outre, très efféminé, ce qui n’arrange rien. Je ne peux donc pas me faire passer pour lui auprès de gens qui le connaissent. En principe ce genre de situation ne peut pas se produire. Il n’y a statistiquement aucune chance pour que Paul Montebourg, un français immigré depuis plus de quinze ans à Montréal, au Canada, à huit mille kilomètres, connaisse un journaliste de Sud-Ouest, qui, de plus, a dû être prévenu par un membre indélicat du personnel de l’hôtel.
Je sais, si j’étais Montebourg, je serais flatté. Mais je ne suis pas Montebourg, je suis « Albert le Dingue ». Un des hommes les plus recherchés de la planète. Et Montebourg est dispersé dans une trentaine de sac en plastique biodégradable eux-mêmes dispersés dans une trentaine de décharge publiques d’Amérique de Nord, et aucun morceaux n’est reconnaissable, c’est du steak haché !
Je m’emporte…
Une chance que Montebourg soit un journaliste minable et qu’il n’ait pas sa photo sur le net… Après tout, rien ne m’oblige à répondre aux injonctions de la presse locale, je suis un écrivain en vacances privées.
J’appelle immédiatement le standard de l’hôtel :
— Allo, passez-moi le directeur de l’hôtel, c’est urgent. Merci.
— Ne quittez pas.
Je patiente quelques instants. Puis j’entends la voix du Directeur :
— Allo, monsieur Montebourg, que puis-je pour vous ?
J’éructe :
— Je vous demande de préparer ma note, j’annule ma semaine de vacances. Je suis scandalisé que votre personnel ne sache garantir la vie privée de vos clients.
— Pardon, mais que s’est-il passé ? s’étrangle-t-il.
— Quelqu’un a prévenu la presse locale que j’étais ici. Je suis harcelé par un journaliste de Sud-ouest qui veut interview et photos. C’est inadmissible de la part d’un établissement tel que le vôtre. Je connais la combine, on file un tuyau à la presse et aux paparazzis qu’un « people » est en chambre et on prend une commission. Je suis ici incognito, monsieur, en vacances…
— Monsieur Montebourg, je vous promets que vous ne serez plus importuné. Je vous donne ma parole.
— Vous me promettez ?
— Je vous promets. J’en fais une affaire personnelle !
— Entendu. Et bien, faites courir le bruit que j’ai quitté l’hôtel.
— Bien, monsieur.
— Et puis servez-moi un petit déjeuner en chambre. Café fort, croissants et orange pressée, n’oubliez pas le journal.
— Bien, monsieur.
Je raccroche. Je déchire le pli en petits morceaux et le jette dans la cuvette des WC. Je tire la chasse.
J’espère que ça va marcher. Sinon, je vais devoir faire taire ce journalise…
Ah mais…
Je pisse.
Ça me calme. Je déteste les réveils brutaux. Pour un premier matin, ça commence mal. Très mal… Mais ça ne m’empêchera pas de faire mes trente pompes quotidiennes.
Je m’allonge sur le parquet, je raidis mon corps. Je suis sur les bras… Allez une, deux, trois, quatre, je me sens un peu faible… Allez… Dix, onze, douze…
…Vingt sept… Je meurs, vingt huit, vingt neuf… Ah ! Trente… Je m’affale sur le sol.
Je reprends mon souffle.
Je me relève. J’ouvre les volets, heureusement, l’océan est là et il fait beau. Je reste quelques minutes à regarder la mer. Quant on frappe à la porte :
— Room Service. Votre petit déjeuner, Monsieur.
C’est la voix de la serveuse d’hier soir. J’ouvre la porte. C’est elle. Elle tient un plateau.
— Posez ça là, dis-je en montrant la table.
Elle entre, je pousse l’ordinateur pour faire de la place. Les glaçons tintent dans le verre de jus d’orange.
Elle me tourne le dos, j’en profite pour examiner sa nuque, son dos, ses fesses. Sa taille est fine. Son parfum est indéfinissable. Une eau de Cologne, peut-être. Elle pose le plateau.
— Le journal, vous avez oublié le journal, dis-je un peu gêné. Vous savez, j’ai besoin de lire les nouvelles pour écrire, ça excite les neurones.
Je lui souris.
— Je comprends, monsieur.
Elle me rend mon sourire.
— Je reviens tout de suite.
Elle s’échappe. Je mesure les trésors de volupté et de jouissance qui se cachent à son insu sur chaque centimètre de sa peau. J’hume encore son parfum qu’elle a laissé comme un panache. Un frémissement de désir me traverse de part en part. Le café fume, les croissants sont chauds. Je vais me régaler. Quelques minutes plus tard, elle frappe à nouveau. Je me précipite pour ouvrir la porte.
— Voila, me dit-elle.
Elle me tend Sud-ouest, Libération, le Figaro et le Point. Elle sourit. Ému, je prends cette presse encore chaude.
— Grâce à vous je vais avoir de la lecture aujourd’hui. Merci mille fois.
Elle me répond par un sourire.
— Si vous avez besoin de quoique ce soit, n’hésitez pas. Je suis là.
— Votre nom est ?
— Laura.
— C’est un très joli prénom, Laura, il vous va très bien.
— Merci, monsieur, bonne journée.
Elle fait une légère révérence et s’échappe. Je ferme la porte. Ce parfum : je fonds. J’entends des résonances venues du fin fond de mon inconscient, comme un chant voluptueux et triste. Mon cœur s’est accéléré. Je la désire. Je suis ému, et quand je suis ému, j’ai les larmes faciles :
« Laura ! »
Je déjeune en lisant la presse. Le monde tourne et avec lui ses lots de catastrophes. La bourse monte, mes actions se portent plutôt bien. J’ai un portefeuille éclectique, sans gros risque. C’est agréable de gagner de l’argent sans rien faire, uniquement en lisant le journal. Je trempe mon croissant dans le café. Je mastique. C’est bon. J’avale la dernière goutte de café.
Je sens un nouveau besoin naître dans mon fondement…
09 :35
Dans la salle de bains, je me déculotte et m’assois sur les WC. J’ai un bon transit. Oh, ça n’a pas toujours été le cas. Le moment de déféquer est un des meilleurs moments de la journée, car il est propice à la méditation. C’est là que je fais le point sur ma vie :
J’aime mon métier. J’ai quelques gros clients dans le monde de la politique. C’est tellement rassurant de faire disparaître ceux qui, parce qu’ils en savent trop, pourraient vous nuire. On se sent tellement mieux après. Les techniques ont vraiment évolué ces dernières années. Certes, on ne rechigne pas à utiliser encore des armes à feu de précision, avec lunettes et silencieux, comme dans l’ancien temps, mais c’est dans le but d’alerter les gazettes et la police, et par là même, de prévenir l’adversaire. Cette méthode est de moins en moins employée aujourd’hui au profit de techniques plus discrètes qui passent inaperçues, et c’est là que j’interviens. J’ai mes secrets de fabrique et je pratique le marketing. Je pars d’un principe simple :
« La mort est une chose banale qui arrive à tout le monde au moins une fois dans sa vie. »
C’est statistique. A partir de cette donnée, je liste les causes de ces décès :
Il y a la vieillesse, première cause de mortalité, puis viennent les maladies et enfin les accidents et les disparitions. Je laisse de côté la vieillesse qui est difficile à provoquer. Les maladies sont plus faciles à inoculer. Quand on a le temps, c’est une méthode efficace. Il y a une pléthore de maladies mortelles : le sida qui a eut son moment de gloire, mais aussi des choses plus exotiques et moins connues, la Psittacose purulente, une variante de la maladie du perroquet qui provoque une fièvre de cheval et des délires spectaculaires, certaines Leishmanioses qui tuent lentement et sûrement. Et plein d’autres gâteries dont le nom m’échappe.
Il faut se procurer des souches, auprès de « spécialistes » qui prolifèrent dans les pays de l’Est, et les stocker dans des caches sûres de manière à pouvoir en disposer le moment venu. L’idéal est de ne jamais passer les frontières avec des produits suspects. J’ai des caches dans une dizaine de pays. Le plus souvent dans des chambres d’hôtel. Dans les faux plafonds, sous les lames de parquets, dans les murs. J’évite les meubles, les matelas, qui sont susceptibles de changer de chambre. Et puis, il faut penser au plombier ou à l’électricien qui va faire la maintenance. La cache de chambre d’hôtel est pratique, en cas de découverte accidentelle, la police aura beaucoup de mal à savoir qui, des centaines de clients annuels, l’a pratiquée, surtout quand j’utilise une vraie fausse identité. J’évite de laisser des traces, empreintes digitales, cheveux, poils divers. Pour cela j’ai un petit truc de pro, je laisse des traces, mais pas les miennes. Je conserve les empreintes de la pharmacienne sur les ampoules ou les fioles. Dans les toilettes, c’est bien le diable si, en cherchant bien, je ne trouve pas un poil de cul ou un cheveu, laissé par le précédent locataire et oublié par la femme de ménage, je le récupère avec une pince à épiler stérile, puis je le dépose négligemment près des objets cachés. Le moment venu, cela fait le délice de la police locale.
Les « accidents » demandent un savoir faire et beaucoup de pratique. Les assureurs enquêtent et dieu sait s’ils sont têtus… Le plus simple à mettre en œuvre, c’est l’accident bête, parce qu’il est imprévisible. Je le conseille au débutant. La victime part, seule, faire un footing dans la montagne près d’un précipice, c’est imprévisible. On doit saisir cette opportunité : on la pousse tout simplement dans le vide après avoir vérifié qu’il ne peut pas y avoir de témoin.
Ou bien, la victime part se baigner dans l’océan. On plonge avec elle. Lorsqu’elle est suffisamment loin de la côte, on lui saute dessus, on la maintient quelques minutes la tête sous l’eau. Elle se noie. On la ramène sur la plage. On pratique un bouche à bouche, évidemment, en vain… Et, plus tard, on explique à la police qu’on n’a rien pu faire pour la sauver. Cette technique a un avantage qui flatte l’ego, elle fait passer l’assassin pour un héro. Je l’ai pratiquée une fois, il y a bien une quinzaine d’année, sur la femme d’un copain qui n’osait pas rompre. Faut dire que Gisèle était très autoritaire (je suis poli). Pour la petite histoire, par la suite, j’ai dû occire son mari, bien qu’il fût mon ami. Il paniquait. Je ne peux prendre aucun risque. Pour lui, ce fut le suicide, il n’a pas supporté la mort de sa femme chérie : 32 comprimés de Témesta dans l’estomac l’ont calmé, pour longtemps…
La disparition demande une dextérité et des techniques de professionnels, je la déconseille aux amateurs, car tôt ou tard la police remonte les pistes. Il faut, dans un premier temps, provoquer le décès sans laisser de traces. Puis, faire disparaître l’arme du crime. Ensuite on doit pratiquer la disparition proprement dite, c’est-à-dire, disperser les soixante dix kilos de viande, de sang, d’os et de vêtements. Là, je dois avouer que ma formation de boucher m’a beaucoup servi. L’étal, le couteau à désosser que j’appelle le saigneur, la scie. Deux pschitt de parfum sur deux bouts de cotons que je plante dans mes narines. L’artiste est au travail. Je découpe, cisèle, dépiaute, hache. J’épluche. Les viscères d’un coté, les os de l’autre. Deux sacs poubelles de cinquante kilos avec lies (jaunes). Il faut avoir pratiqué les abattoirs à l’ancienne pour comprendre. Les jeunes sont défavorisés sur ce plan. Le métier se perd. Il faut absolument revaloriser les métiers manuels.
Ensuite, on peut obtenir une aide précieuse de certains animaux pour rogner les os, ou dévorer la viande. Les fourmis carnivores sont parfois des alliées précieuses. La chimie des acides est efficace aussi. Parfois une simple poubelle fait l’affaire. Le nombre de cadavres qui passent inaperçus dans les poubelles municipales est inouï.
A ce stade de ma réflexion, j’avoue une faiblesse de gourmet : le filet mignon passé et repassé à la poêle avec sel et poivre. Mais surtout sans moutarde, ça tue le goût. Servi avec un simple cœur de laitue en salade. Le tout arrosé d’un Tavel rosé bien glacé, si on est en été. Pour les abats je recommande une cuisson longue, une daube par exemple avec oignons, carottes et pommes de terre, lardon humain, si possible. Cuisson longue, surtout si la victime a subit un stress, un interrogatoire musclé, et, il faut bien le dire, c’est souvent le cas… Je tolère la cocotte minute pour ceux qui ont subi une longue incarcération avant l’exécution. Cependant, l’idéal reste la daube cuite la veille pour le lendemain, avec bouquet garni et croûtons.
Je sais que l’anthropophagie fait peur, mais c’est ridicule. Dans l’acte d’amour, par exemple, on lèche les liquides corporels de ses partenaires, on se délecte même de quelques traces d’excréments quand on pratique un cunnilingus en bonne et due forme et on n’en fait pas un fromage, si je puis dire…
Je sors de ma rêverie, j’entends les râles asthmatiques des aspirateurs qui se rapprochent dans le couloir. Je me lève, me torche avec le papier WC triple épaisseur, parfumé à la vanille, et tire la chasse d’eau.
J’aime rester des plombes aux toilettes, même si ça me fait des marques rouges aux fesses…
10 :10
Je m’habille. Je mets le livre de Paul Montebourg bien en vue sur ma table. « Albert le Dingue » : le titre n’est pas si mal… Il justifiera auprès du personnel de l’hôtel l’authenticité de mon métier.
Ils adorent les romanciers en mal d’inspiration, c’est tellement romantique.
Je laisse la place aux femmes de ménage. Une promenade me fera le plus grand bien. En descendant j’aperçois Laura qui met les couverts sur les tables de la terrasse pour le déjeuner. Elle me voit, je lui fais un petit signe de la main, elle me répond discrètement par le même geste. Je l’observe de loin. Le maître d’hôtel s’approche d’elle et la sermonne. Il lui indique la position des couverts sur la table et semble très agressif. Laura a le visage fermé. Décidément, je ressens beaucoup de compassion pour cette jeune fille. Le mépris que lui porte son chef la rend encore plus magnétique. Je pense qu’elle se rend compte que j’observe la scène.
Je descends sur la plage.
J’ai longtemps détesté la poésie. Je n’irais pas jusqu’à dire que je commence à l’aimer, mais je ressens des choses nouvelles. J’en écris même un peu parfois. « Pas besoin d’être anglais pour étrangler » est mon premier poème important. Je pense sérieusement publier un recueil un jour. Peut-être quand je serais à la retraite. A cinquante ans, je vis seul, toujours à l’hôtel, je n’ai pas de domicile fixe. Ma vie est une longue succession d’aventures. Les gens pour qui j’ai éprouvé de la compassion, avec qui j’ai partagé une intimité, sont morts. C’est vrai que j’en ai aidé pas mal. Mais, finalement, ils sont bien, là où ils sont, ils ne me manquent pas.
Ce qui me rassure dans la vie, c’est la manière dont la nature a équitablement réparti les jolies femmes sur la surface de la planète. Je ne connais pas un endroit où je n’ai pas été séduit par l’une d’elles. Il n’y a donc pas de raison pour que ça s’arrête. Cela réveille mon instinct de chasseur. Où que j’aille, la Nature a disposé une entité femelle compatible, qui, sans le savoir, m’attend. Une sorte de piège délicieux, rempli de plaisir, un peu comme des doses de point de vie réparties dans un jeu vidéo, qu’on doit gober :
« Gloup !gloup ! »
J’ai été gâté par la vie. Chaque mois, chaque année, est parsemée de rencontres, parfois de fièvre, de passion. Mais ça ne dure pas, car cela ne doit pas durer. L’erreur consiste à penser que l’amour dure toujours. C’est une bêtise. Le mâle est un chasseur qui traque les femelles pour les engrosser. Point. Croître et multiplier, c’est la loi de la « Nature Universelle ». J’obéis au sens de la vie. Si je m’attache trop, si je sens que la séparation va me faire souffrir, si j’éprouve de la jalousie, alors je dois prendre cette vie, ce souffle, je dois me nourrir de cette passion. Une fois qu’elle est en moi, la fureur s’arrête. Le calme revient. Mais ne vous méprenez pas, quand je tue en dehors de mon travail, c’est toujours un acte sublime d’amour.
Avec Simona nous avons souvent foulé cette plage. Je suis revenu deux fois en vacances, et chaque fois le miracle s’est produit entre nous. Je l’ai abandonnée pendant deux ans. Il a fallu que je revienne, elle me manquait trop. Elle travaillait dur, elle aussi, comme serveuse à l’hôtel. Elle me portait le café dans la chambre, le matin. Nous sommes fatalement tombés amoureux l’un de l’autre, sans effort, naturellement. Sa beauté était exceptionnelle, mais elle n’en n’était pas consciente, ce qui ajoutait encore à sa grâce.
Je marche dans le vent. Simona se matérialise à coté de moi. Elle est pieds nus sur le sable. Dans cette immensité océane qui n’est que le prolongement de sa beauté. Un moment, j’ai vraiment cru que la plage allait disparaître avec elle.
Sa voix est suave :
— Tu vois le rocher, là-bas.
— Oui.
— C’est là que j’allais jouer quand j’étais petite. C’est un blockhaus que les allemands ont laissé après la guerre. On va voir ?
— Je te suis.
Je n’aime pas trop marcher pieds nus dans le sable sec, je préfère le sable humide. Je retrousse mes pantalons. Simona court en riant.
Le blockhaus est un grand cube de béton posé sur la dune. Il pouvait résister aux tirs de mortiers ennemis. Le fait qu’on ne l’ait pas détruit, laisse imaginer son poids et sa solidité. On y rentre par une cavité étroite.
— Viens.
Simona me prend la main. Je me courbe pour entrer. Elle me tire, je tombe sur elle. Les parois sont remplies de graffitis laissés par les amoureux de passage. J’imagine les ébats, la nudité, les pollutions des muqueuses adolescentes qu’a vu ce nid inattendu. J’imagine aussi les corps déchiquetés dans leur treillis, des soldats allemands, en 1945.
Nous sommes à l’abri des regards. Elle m’enlace, nous nous embrassons comme des gamins. Elle s’enflamme, m’entraîne dans un vertige sublime. Nous faisons l’amour au rythme des vagues proches. Je ne peux me retenir. Elle semble heureuse.
— Tu vois ce qui est écrit là.
Elle me montre un graffiti sur une paroi.
— C’est moi qui l’ai écrit.
Je déchiffre : « Simona = ? ».
— Regarde…
Elle prend un caillou aiguisé sur le sol et grave une croix sur le point d’interrogation et ajoute « Édouard ».
J’avais pris l’identité d’un certain Édouard de Maulmain. Un dandy que j’ai fait disparaître en le momifiant. Je me suis vraiment passionné pendant une période de ma vie pour les sciences égyptiennes. La momification est un art difficile mais passionnant. Retirer le cerveau par une narine, extraire les abats et les remplacer par des grains de poivre ou des herbes rares, enduire de sel et faire sécher le corps dans un courant d’air, comme on le fait pour le jambon de Bayonne, et peu à peu, voir le corps se momifier, est une expérience très enrichissante, surtout dans le cas d’Édouard de Maulmain qui avait un compte en banque très bien garni. Je l’ai descendu un soir dans les catacombes en passant par une cave. Désormais, il est allongé dans une crypte sombre, au milieu d’une dizaine de milliers de squelettes. Quand je descends dans les catacombes parisiennes, j’y rencontre un nombre incroyable d’anciens amis qui ont en commun ce sourire édenté que l’on ne fait qu’à l’éternité et qui fait oublier le regard un peu vide qu’ils jettent sur leur passé.
Simona disparaît.
Dans le blockhaus, rien n’a bougé, on dirait qu’elle a gravé le graffiti hier. Il y a peut-être une odeur en plus, une puanteur même qui laisse présager que l’endroit a changé de fonction. De repaire pour amoureux, il est devenu chiotte pour touriste atteint de tourista. Décidément les temps ont bien changé.
Je rentre à l’hôtel. Au dessus de moi, des mouettes braillent.
C’est drôle, on dit que l’histoire ne se répète pas. Pourtant j’ai un sentiment de déjà vu comme disent les américains. La lassitude apparente de Laura m’attriste. Sa vie doit manquer cruellement de rêve et de sensations. Je suis persuadé qu’elle n’est pas insensible à l’exotisme que j’apporte.
Malgré moi, méticuleusement, je commence à tisser un piège autour d’elle. J’ai été surpris que ce soit elle qui m’apporte le petit déjeuner ce matin. En principe les serveuses en salle ou en terrasse ne font pas le « room service ». Cela en dit long sur la compression de personnel au Miramar. Faut dire que l’hôtel n’est pas plein, ça sent la fin de saison. On sent la nostalgie de l’automne et de l’été indien.
C’est la saison que je préfère.
12 :30
Je remonte sur la terrasse du Miramar. Un couple d’américains déjeune sous un parasol. Je m’assois à quelques mètres d’eux. Laura dépose la carte sur ma table. Elle arrange les couverts et met des pinces à la nappe, à cause du vent. Le maître d’hôtel n’est pas loin. C’est un vachard d’une quarantaine d’années, son œil est vicieux. Laura doit passer de sales moments avec un type pareil.
— Décidément, que serait cet hôtel sans vous ? lui dis-je.
— Nous ne sommes plus que deux au service, c’est la fin de la saison. Il y a du lapin chasseur au menu aujourd’hui. Il est servi avec une sauce aux champignons de Paris, des pommes de terres tournées, beurrées et persillées, petite rondelle de citron. En entrée nous avons un pâté de sanglier aux truffes du Périgord.
Elle pose une corbeille de pain.
— Va pour le lapin chasseur, le sanglier. Et mettez-moi une petite salade verte.
— Vous voulez un peu de vin ? Nous avons un Brouilly en vin du jour.
— Il est frais ?
— Oui.
— Alors, va pour un demi de Brouilly.
Elle est déjà repartie. Sa jupe noire gaine ses fesses. Il y a là une force d’attraction proche du trou noir, une zone d’entropie extraordinaire.
Le déjeuner s’avère excellent, on sent qu’il y a quelqu’un aux cuisines, je veux dire, un vrai chef. Le râble de lapin est charnu, gras, tendre. La sauce est exquise, elle a une bonne acidité, les champignons de Paris sont frais, on sent que les lardons ont été blanchis et sautés par un expert. Le petit canapé de pain de mie grillé qui éponge la sauce et son brin de persil achèvent de me combler. Laura est partout, avec gentillesse et sourire. C’est une perle. Elle vient faire les miettes sur ma table. Je la questionne :
— Vous prenez un peu de repos, cet après midi ?
— Oh oui, j’ai une pose jusqu’à 5 heures.
Sa voix tinte.
— Il n’a pas l’air commode votre maître d’hôtel.
— Non !
Ce « Non » en dit long. Je glisse discrètement un billet de dix euros sous ma tasse à café. Et je me lève. J’observe à la dérobée. Elle dessert ma table. Je suis rassuré, elle a trouvé mon billet. Je croise le maître d’hôtel qui me salut poliment. Je lui jette un regard neutre. Je sens une rivalité sourde.
Je dois me méfier de ce type, il a sûrement senti que je m’intéressais à Laura.
13 :30
Je monte dans ma chambre, par les escaliers.
La chaleur est suffocante. Je ne serais pas étonné qu’un orage éclate en fin d’après midi. Je m’accoude au balcon. Le soleil est au zénith. Quelques baigneurs se dorent sur la plage. Je me penche un peu. La terrasse du restaurant est juste en dessous. J’aperçois la table où j’ai déjeuné, elle est déjà nettoyée. Il n’y a plus personne. J’aperçois Laura qui a enlevé son petit tablier blanc. Elle traverse le parc et se dirige vers une baraque en bois cachée derrière une haie au fond du parc de l’hôtel. Je la suis du regard. Elle pousse une porte et entre. J’ai découvert son nid. Ils sont culottés les gérants du Miramar de loger le personnel dans des baraques de jardiniers. Elle est en pause, elle va dormir sûrement.
J’allume l’ordinateur. Je vérifie mes e-mails. J’ai un message de Riton, un vieux copain qui avait un restaurant autrefois sur le port. C’est vrai que je l’avais prévenu de ma venue.
Je décrypte :
« Cher vioque, passe me voir vers 16 h si tu peux aujourd’hui chez moi. Pour le plaisir. »
C’est vrai que, moi aussi, j’aimerais revoir ce vieux bandit. Je décroche le téléphone :
— Allo, mademoiselle, connaissez-vous le nom de l’hôtel le plus proche du Miramar.
La fille du standard réfléchit un instant :
— C’est le Florida, je crois…
— Savez-vous s’il est loin ?
— A trois cent mètres environ.
— Parfait, je vous remercie.
Je raccroche. Je compose le numéro des taxis du coin qui figurent sur un dépliant de l’hôtel :
— Allo, bonjour madame, je voudrais un taxi, je suis à l’hôtel Florida. Pour 15 heures. C’est noté ? Je vous remercie…
Je raccroche. Je préfère ne pas laisser de traces, les chauffeurs de taxis sont parfois trop bavards. Cela me fait plaisir de voir « Riton l’Élégant ». Il a raccroché il y a quelques années pour raison de santé. Il va alertement vers ses soixante quinze balais. On a fait les quatre cents coups ensemble dans le temps. Les terroristes basques étaient de bons clients. La pègre espagnole aussi. Une fois, pour la même exécution, on avait deux clients : deux payes pour un même travail.
C’était le bon temps…
15 :30
Je marche jusqu’à l’hôtel Florida où mon taxi attend.
Il me dépose un quart d’heure plus tard au 40, rue de la Plage. Je marche jusqu’au 85 pour brouiller les pistes. C’est au bout de la rue. Il est 16 heures pile. La taule de Riton est une villa typique du coin, style « Do Mi Si La Do Ré » ou « Mon abri côtier ». La maison est entourée d’un jardin potager. Il se fait encore ses fruits et ses légumes. Il n’a pas de voisin, c’est la campagne. J’appuie sur une sonnette fixée avec du fil de fer au portail. Ça sonne dans la maison. La porte s’ouvre. Riton apparaît. Il porte un large béret basque, il est vêtu d’un bleu de travail. Il me fait signe d’entrer. J’ouvre le portail.
Il vient vers moi, il marche avec une canne. Pauvre vieux, il a du mal… Je m’approche de lui :
— Vieille canaille… Comment vas-tu ?
Il me répond d’une voix un peu chevrotante avec son accent parigot:
— Oh, je n’ai plus vingt piges… Albert, toi tu n’as pas changé.
Il me donne une accolade.
— Rentre, il fait frais dedans.
Je rentre dans la maison. C’est vieillot, et ça sent bon l’oignon en train de frire. L’intérieur est kitch. La table est revêtue d’une toile cirée à carreaux verts. Un vieux « PC » trône sur un petit bureau. Sur l’écran, la page est ouverte sur eBay.
— Je me prépare un poulet à la basquaise pour ce soir. Tu vas rester dîner ?
— Non, mon pote, j’ai du taf ce soir, mais elle sent bon ta basquaise, Riton.
— C’est des tomates du jardin. Bon, tu vas boire un coup.
Il sort une bouteille de vin rouge sans étiquette du réfrigérateur et remplit deux verres qui attendaient sur la table.
— C’est du bon, tu vas voir. Moi, faut plus que je boive de pinard, j’ai la pendule qui débloque, cinq pontages ils m’ont fait…
Il passe une main sur sa poitrine puis il me tend une chaise.
— Assieds-toi. Ah, c’est bon d’être avec un affranchi. Tu sais, je ne vois plus personne. Le Mitan n’est plus ce qu’il était. Je ne connais même pas le blaze du taulier qui tient les rades ici. Ah ça, les poulets me foutent une paix royale. Je n’ai jamais eu de misères. Et toi ?
Je me suis assis sur une chaise paillée. Riton a gardé au poignet la Patek Philip que je lui avais offert. Je regarde le PC allumé :
— Je vois que Monsieur chatte sur les sites de cul…
— Ah ça, c’est l’arme absolue contre l’ennui. EBay c’est une invention géniale, je vends des vieux trucs…
— Allons, tu ne vas pas me dire que tu enchéris pour acheter des vieilleries inutiles… Toi, le plus grand truand que je connaisse.
— Non
Il devient sérieux.
— J’ai une dizaine de kilos d’explosifs qui me reste à la cave. De la belle époque… Ça se perd, tu comprends. Ça se gâte avec le temps. J’en mets de petites quantités en vente sur eBay, ça me rapporte un peu de sous et ça rend service à quelqu’un… Tu comprends. EBay c’est sûr, il suffit d’écrire comme on parlait au bon vieux temps. Les flics d’aujourd’hui ne comprennent plus rien… Je trouve des clients sérieux qui payent. Pour la livraison, ils se déplacent, je leur donne rendez-vous au restaurant de Camille sur le port. Et ils récupèrent la came dans un blockhaus de la plage après avoir payé cash. Vive eBay !
— C’est pas dangereux de planquer des pétards dans un blockhaus ?
Il éclate de rire.
— C’est beaucoup moins fréquenté que tu crois… Depuis que j’y chie…
Il rit de plus belle… Soudain, il s’étouffe, tousse, je lui tape dans le dos. Il crache. Un moment je crois qu’il va clapoter. Mais il se reprend, respire avec un bruit de soufflet de forge.
— Ce n’est rien, râle-t-il, ça va aller… J’y chie, tu comprends…
Je m’inquiète de sa santé.
— Tu es sûr que ça va aller ?
Soudain son visage se ferme, il devient bougon.
— Albert, j’ai une saloperie.
Je ne moufte pas, je l’écoute, je sens que les minutes qui suivent ne vont pas être une partie de rigolade.
— Je t’écoute.
— J’ai fait des tonnes d’analyses. Tu connais Tousseau. Le toubib de Bayonne ?
— Oui, peut-être…
— Il me donne quelques mois… Cancer du foie. Tu imagines ?
Un silence pesant s’installe, je ne sais pas quoi dire. Il regarde dans le vide en proie à une méditation funeste. Puis il tourne ses yeux vers moi, comme un cochon qu’on amène à l’abattoir.
— Tu ne veux pas me…
— Te quoi ?
— Me dessouder le crâne, que j’en finisse. Je ne veux pas mourir à l’hôpital. Je veux mourir ici. Moi, je n’ai pas la force de le faire…
— Écoute, Riton, j’ai pas la soudure, et puis, je suis en vacances, c’est mon premier jour. Je me suis juré de ne pas toucher à la mort…
— Je comprends, je te demandais ça comme un pote. Je n’ai pas les moyens de raquer un vrai killer. Et puis les jeunes, ils ne savent plus faire un travail proprement. Ils n’ont pas l’imagination.
En disant cela, il se met un doigt sur la tempe.
Je suis gêné. Bordel que c’est compliqué la vie…
J’avale le verre de vin rouge d’une traite, il fait de même. On s’essuie la bouche d’un revers de manche, en même temps.
Riton éclate de rire.
— Ça va aller, t’en fais pas.
Il me tape sur l’épaule comme si c’était moi qui étais à plaindre. Il me sourit. C’est le monde à l’envers ? C’est ça l’élégance de Riton. Ce n’est pas pour rien que c’est « Riton l’Élégant ». On ne finit pas sa vie avec un patronyme pareil sans le mériter.
Le temps passe, on dit des conneries. J’ai dit au taxi de m’attendre au 20 de la rue de la plage à deux cent mètres d’ici.
— Riton, ce n’est pas que je m’ennuie, mais j’ai à faire…
— Tu ne vas pas partir sans quelques provisions. Viens !
Il se lève. Je le suis, il pousse un vieux tapis qui dévoile une trappe. Il ouvre la trappe, je lui donne un coup de main. Un escalier apparaît. On descend. Il allume la lumière. La cave est spacieuse. Il y a de vieilles armoires rongées par l’humidité. Il ouvre l’une d’elle. Elle est remplie de bocaux.
— C’est de la confiture de pruneaux de l’année dernière. Elle est moins sucrée que cette année…
Il prend cinq bocaux qu’il range dans un carton. Puis il ouvre une autre porte.
— C’est des conserves de palombe en salmis…
Il m’en met cinq bocaux de plus.
Et ainsi de suite avec les cèpes, le confit de canard, le foie gras, les graisserons de canard.
— Riton, ça ira…
J’ai beau protester, il n’entend rien. Il ouvre enfin une dernière armoire.
— Là, tu vois, c’est le kérosène.
Elle est remplie de bouteilles d’Armagnac, 1976 est marqué au crayon sur l’étiquette. Il prend deux bouteilles et finit ainsi de remplir le carton.
— Faut pas déconner… Manger c’est bien, mais boire c’est mieux…
Il me tend le carton. Je le prends.
— Là, tu vois, j’ai la pyrotechnique.
Il me montre le fond de la pièce. Ce n’est pas dix kilos, mais au moins cinquante kilos d’explosifs qui sont posés là. J’apprécie son stock :
— C’est Verdun que t’as là.
Il est fier.
— Ça fait quelque chose… dit-il plein de philosophie.
On reste là quelques secondes à se recueillir. Riton a l’air heureux. Je repère une petite bouche d’air qui donne sur l’extérieur, une sorte de meurtrière. Elle donne derrière la maison. Un tout petit rayon de lumière vient de l’extérieur. C’est ce qui permet de respirer dans ce tombeau.
— Bon…
Il se décide à remonter, je le suis.
On remet la trappe et le tapis. Je reprends son dernier mot :
— Bon, merci pour tout.
— Mais de rien, t’es con ou quoi ?
— Riton, je vais repasser dans la semaine avant de repartir…
— Tu sais que tu es toujours le bienvenu.
Je l’embrasse sans poser mon carton. Fatigué il s’assoit. Je le sens à bout de force.
— Reste assis, je repasse jeudi, je t’amène manger chez Camille.
— Ouais. Il fait des moules comme personne.
Je lui fais un clin d’œil. J’ouvre la porte et sors. Le soleil m’éblouit. Je ferme la porte. Riton est resté assis, un peu hagard.
Sans perdre de temps, je fais le tour de la maison en visant le bas du mur. La haie autour de la propriété est épaisse, personne ne peut me voir. Derrière la maison, au ras du sol, je repère la meurtrière étroite qui aère la cave. Je pose mon carton. C’est bien là. Je prends la bouteille d’armagnac. Une chance elle a un bouchon à tête. Je la débouche avec les dents. Je verse l’Armagnac par la meurtrière, je vide la bouteille en prenant soin d’en mouiller le bord en ciment jusqu’en bas dans la cave. J’allume une cigarette avec mon Zippo. Je pose la cigarette sur le ciment imprégné d’Armagnac. Elle fume. J’attends cinq secondes. J’allume le Zippo, ce coup ci l’Armagnac chauffé par la cigarette prend feu. La flamme bleue descend dans la cave.
Je prends le carton et file comme un dératé. Je passe le portail, personne, la voie est libre. Je suis sur la route. Le taxi est à trois cent mètres. Je marche rapidement mais sans excès de manière à ce que le chauffeur de taxi ne me voie pas. Je monte dans la voiture et pose le colis sur mes genoux. Le chauffeur s’était assoupi.
— On rentre à l’hôtel Florida, chef.
Il démarre en baillant.
Soudain l’explosion est terrible. On est déjà loin. Le chauffeur s’énerve.
— Ils font vraiment n’importe quoi ! La semaine dernière un pilote de la base aérienne de Mont de Marsan s’est amusé à passer le mur du son à cinq mètres du sol avec un vieux Mirage IV. C’était dans le journal. A tous les coups il recommence…
J’ouvre la fenêtre de ma portière pour respirer un peu d’air frais.
Merde, j’aurais pu au moins récupérer la Patek. Je n’y ai pas pensé… Quel gâchis…
La voiture file dans la forêt landaise à vive allure. J’ai le spleen. Je caresse les bocaux dans le carton posé à côté de moi.
Sacré Riton…
18 :00
Je me console. Ce n’est pas grave, c’est juste un vœu qui ne se réalise pas… Ça arrive. Peut-être que le rayon n’était pas tout à fait vert. Des fois ils sont jaunes, on les confond. C’était, peut-être un rayon noir… Je prends machinalement une boîte de foie gras dans le carton. Cancer du foie. J’imagine dans quel état est le pauvre Riton. Il doit ressembler à un steak tartare, à l’heure qu’il est. Dieu ait son âme…
Le chauffeur me regarde dans le rétroviseur :
— C’est un très bon réflexe d’aller acheter directement chez les producteurs.
— Je vous demande pardon ?
Je ne comprends rien à ce qu’il me dit…
— Les produits régionaux, c’est quand même mieux de les acheter directement à la ferme.
Il m’a vu triturer les boîtes de conserve dans mon carton. J’abonde dans son sens :
— Ah, c’est sûr… J’ai fait le plein.
— Les supermarchés ont tué les petits commerçants. Et ils vendent de la merde… Regardez les tomates, rien ne vaut les tomates du jardin…
— Et oui, les petits commerçants meurent beaucoup en ce moment…
— Un couple de fromagers s’est pendu dans leur boutique l’année dernières à Bayonne.
J’espère pour eux qu’ils avaient bien préparé leur « cou » …
La voiture s’engouffre dans le parc de l’hôtel Florida. Les pneus crissent sur le gravier. Le chauffeur pile.
— Et voila.
— Merci.
Je lui tends un billet de 20 euros. Je prends mon carton et je descends. Il démarre en trombe.
Je me farcis les cinq cents mètres qui séparent l’hôtel Florida du Miramar, avec mon carton dans les bras. Il va faire de l’orage. J’arrive. La réception de l’hôtel est vide. Je monte dans ma chambre.
Je pose le carton sur la table. J’étouffe.
Un pli est posé près de mon ordinateur, bien en vue dans un petit plateau en argent. Intrigué, je décachette l’enveloppe. Je n’aime pas ça du tout.
Je lis :
« Monsieur.
La Direction de l’Hôtel MIRAMAR a le plaisir de vous informer qu’un Happy Hours a lieu à partir de 19 heures au bar de l’Hôtel.
Les cocktails et les longs drinks y sont à moitié prix. »
Je me marre…
Je me fais couler un bain. Dehors la pluie tombe à grosses gouttes, le vent se lève, l’orage tonne… Un éclair fabuleux strie le ciel sur l’océan vert gris. C’est le déluge. On dirait qu’il fait nuit.
Je plonge dans la baignoire. C’est wagnérien.
L’orage est calmé. Il est tombé des trombes d’eau. J’ai mis mon costume. Je me suis fait beau. Je dévale l’escalier pour descendre au rez-de-chaussée. Je m’affale dans un confortable fauteuil club en cuir du bar de l’hôtel. Je me sens heureux comme un gamin. C’est bon les vacances. Un air de jazz flotte dans l’air, Sarah Vaughan chante « April in Paris », une merveille. Le bar est chaud. Boiseries, vieux cuir, ambiance cool. Je suis le premier client. Laura m’aperçoit. Elle vient vers moi. Elle semble flotter dans l’air dans sa jupe noire. Plus belle que jamais. Elle est radieuse :
— Je vous sers un whisky Sour au Jack Daniels ?
— Non, exceptionnellement ce soir, à cause de la musique particulièrement sublime, je prendrais un Lagavulin avec un verre d’eau plate.
Elle sourit.
— Et des glaçons ?
Je sursaute :
— Non, Laura, surtout pas ! Il faut rester dans cette ambiance chaude… Vous avez des cigares ?
— Je vous amène la boîte.
Elle revient avec une énorme boîte à cigares qu’elle pose sur la table. J’ouvre, je prends sans hésiter un Cohiba Robusto. Il est humide comme il faut et sent bon Cuba. Je le coupe et l’allume. Laura reprend la boîte. Elle revient avec le Lagavulin et son verre d’eau.
— C’est parfait, lui dis-je.
Je sens son parfum, sans pouvoir en déterminer la marque. Peut-être le cigare masque-il la fragrance. Laura est plus que désirable. Suis-je devenu un mâle en rut ? Est-ce la saison de la reproduction ? Émet-elle des phéromones aphrodisiaques ? Toujours est-il que je ne la quitte pas du regard.
— Vous avez écrit ? Ose-t-elle.
— Écrit ?
— Vous écrivez un roman, n’est-ce pas ?
— Oh oui, mon roman (Je tire sur mon cigare). Je cherche la trame pour un polar.
— J’adore les romans policiers. Vous êtes ici à cause de la chambre 109 ?
— La chambre 109 ? Je feins l’étonnement.
— Vous n’êtes pas au courant ?
— Non.
Laura semble gênée.
— Je ne sais pas si je dois vous importuner avec ces histoires anciennes.
— Dites-moi, ça m’intrigue.
— Il y a une vingtaine d’années, un crime a eu lieu ici, à l’hôtel.
— Non ?
— Si…
Un couple s’installe sur un confortable Chesterfield près du bar. Laura s’empresse d’aller les accueillir. Cela met fin à notre conversation.
Je déguste mon Lagavulin. Si elle prête un intérêt à ma personne, elle se débrouillera pour rétablir le contact. Le Maître d’hôtel vient d’arriver. Je dois arrêter de la mater.
Ainsi, il y a encore une mémoire qui s’est transmise de génération en génération de personnel, vingt ans après. Je suis curieux de savoir ce que Laura a entendu comme histoire. C’est un peu comme le jeu des mimes. Un joueur mime un métier à un autre joueur qui, lui-même, doit mimer ce qu’il croit savoir au joueur suivant et ainsi de suite jusqu’au dernier joueur qui doit deviner le métier. Entre temps l’information s’est déformée. Je suis ce dernier joueur…
… sauf que je connais déjà le métier.
Je vais glisser un mot à Laura au moment de l’addition, il faut que je lui parle… Et je sens qu’elle aussi a envie de me parler. Je vide mon verre. L’alcool brûle délicieusement mon gosier.
Elle s’approche :
— Vous désirez autre chose ?
Je regarde la carte :
— Je vais prendre un club sandwich au foie gras avec un verre de « Vic Bihl » bien glacé. Et puis, Laura, je voudrais vous parler tranquillement. Quand vous aurez un moment…
Ça y est l’abordage a commencé, j’ai lancé une amarre… Je la sens surprise mais pas choquée. Au contraire.
— Je termine à minuit.
— On peut se retrouver sur la plage.
— Un club foie gras et un verre de Vic Bihl, ça marche.
Le maître d’hôtel nous regarde. Elle récupère la carte. Je parie qu’elle ira sur la plage à minuit dix.
Je déguste le foie gras, il est délicat et fond dans la bouche. La salle s’est remplie, Laura est partout à la fois.
Elle ira sûrement prendre une douche avant de me rejoindre.
Je mate les clients. Une jeune femme blonde est assise en face de moi, son mari me tourne le dos. Mine de rien, elle me scrute à la loupe. Je capte ses œillades. Je sirote mon verre de vin blanc pour me donner une contenance.
Soudain son mari se retourne et m’aperçoit. Je baisse les yeux un peu gêné. Il a dû se rendre compte que sa compagne me reluquait.
Il s’adresse à moi.
— Cher ami, voulez-vous vous joindre à nous pour le café ?
Il me montre une chaise vide à leur table.
La blonde me sourit.
Il insiste :
— Ça nous ferait plaisir. Plus on est de fou…
Je ne peux qu’accepter. Je vide mon verre de Vic Bihl, glisse un billet de dix euros sous mon assiette.
Je me lève et m’assois à leur table.
— Je me présente Charles André Rubens.
Il se lève et me tend sa main que je serre. Elle a la mollesse de son âge. Car il n’est pas jeune le Charles André.
— Et voici Fernanda, le soleil de mes nuits.
Il se rassoit, Fernanda me tend sa main. Je me lève, je la saisis et la baise, sans la toucher, avec classe et élégance. Je note la taille impressionnante du rubis qui allume la bague prisonnière de son index. Les doigts de Fernanda sont fermes et lisses. Ils sont comme des petites cuisses. Je me présente à mon tour.
— Paul Montebourg.
Charles André attaque :
— Ah, mais c’est vous l’écrivain dont nous a parlé le Directeur de l’hôtel.
Je sursaute :
— Le Directeur vous a dit que j’étais écrivain ?
Je les sens soudain gênés. Fernanda réplique :
— C’est moi qui ai insisté pour savoir qui était ce mystérieux jeune homme si solitaire et si séduisant…
Charles André lui emboîte la parole :
— Il faut pardonner Fernanda, elle est d’une curiosité maladive.
— Maladive, vous y allez un peu fort, Charles André, proteste-t-elle.
— Vous voyez elle est non seulement curieuse, mais susceptible aussi.
— Vous me trouvez susceptible, Monsieur Paul ?
Je la regarde dans les yeux. Je sens son genou se coller au mien.
— Non. Mais ne sommes nous pas tous susceptibles à certains moments plus qu’à d’autres ?
— Mais bien sûr, Monsieur Paul a raison, vous n’êtes pas plus susceptible que n’importe qui, chère amie.
Charles André essaie de réparer sa bourde. Fernanda me mange des yeux :
— J’adore les écrivains. Vous écrivez des polars j’espère.
Son pied se colle à mon pied.
— Bingo! dis-je.
— J’en étais sure… Tout en vous évoque le polar. Votre costume, vos yeux, votre démarche mystérieuse et élégante. Vos Ray Ban, j’adore vos Ray Ban… Et vos mains…
Laura vient desservir la table pendant que Fernanda énumère les parties de mon corps. Je sens son parfum. Je dégage mon genou et en profite pour amorcer une retraite.
— Ah, il est tard, le bar va fermer et j’ai un nouveau chapitre à écrire. Je vous prie de m’excuser, mes amis.
Je me lève.
Le visage de Fernanda fond :
— Mais vous n’avez rien bu ? Charles André faites quelque chose ! Ne laissez pas monsieur Paul nous quitter comme ça…
— Écoutez, ma chère, monsieur Paul a du travail et puis nous le reverrons demain.
— Oh, vous…
Je profite de leur logomachie pour m’éclipser. Fernanda est en manque c’est clair. J’espère que Laura n’a rien vu. Je lui adresse un regard en sortant. Elle me sourit. Ses yeux me disent que tout va bien…
22 :00
Je remonte dans ma chambre. Je suis impatient, c’est vrai. Il est 22 heures. Je me déchausse. Je sens les lames de parquet sous mes pieds. Je pense à la mort du Roi Soleil.
« Non, je ne touche pas à ça ! »
J’ai l’impression d’être un fumeur qui essaie d’arrêter de fumer. Laura me manque déjà et je sens monter en moi l’envie de la posséder. Les lames sont là sous mes pieds, étincelantes dans la sacoche. Je m’allonge sur le lit. J’arrête de penser. Je me laisse aller. Je respire…
Simona apparaît à mon coté :
— Tu es beau, tu sais…
J’ai vingt ans de moins. Je lui réponds :
— Toi aussi, tu es très belle.
— On est bien là. J’aime ton épaule, ton cou.
— Arrête, tu me chatouilles.
Elle rit, elle est nue contre moi, sur ce lit.
— Si tu me quittais, j’irais plonger dans l’océan, au fond des baïnes et je me laisserais aller, je ne reviendrais plus jamais. Je deviendrais un poisson.
— Je ne te quitterai pas cette fois-ci, Simona.
Je caresse ses longs cheveux noirs.
— Tu m’emmèneras avec toi ?
Elle m’embrasse dans le cou.
— Oui, je te promets.
— Mon cœur n’appartiendra qu’à toi.
— Rassure-toi, je saurai le prendre…
Elle m’embrasse. Sa bouche est ferme, sa langue sucrée.
— Je t’aime Simona. Tu vois, je suis revenu, et tu es toujours avec moi…
— Tu sais, j’ai un cadeau pour toi.
— Un cadeau ?
— Une surprise que tu dois mériter…
— Tu sais que je n’aime pas trop les surprises.
— Je sais. Embrasse-moi…
00 :00
Minuit : c’est l’heure.
Je sors.
L’orage est complètement dissipé. Les étoiles ont envahi le ciel, on est à quelques nuits de la pleine lune. Le bar est fermé. Personne. J’entends juste des éclats de voix étouffées qui viennent des cuisines. Sur la terrasse une brise tiède souffle doucement, elle est chargée d’iode. Je marche vers la plage, je descends les escaliers.
L’océan est là tout près, ce doit être marée montante. Le sable crisse sous mes pieds, c’est une belle nuit. J’attends Laura. Le silence me répond. Elle a dû aller prendre une douche.
A moins qu’elle soit trop fatiguée. Et si elle avait peur ? Mais non, elle ne peut pas avoir peur d’un écrivain.
Une étoile filante strie le ciel sur l’océan. Minuit et demi, c’est inquiétant. Une douche ça se prend en cinq minutes. Je vais du côté de la baraque où habite Laura. Je m’approche silencieusement. Rien, silence, toutes les lumières sont éteintes. Soudain, je sursaute : un chien se met à aboyer dans le chenil proche, près des baraques. Je reviens sur mes pas. Ou elle dort, ou elle n’est pas là. Elle est peut être sortie dans un night-club, c’est de son âge après tout…
Je reviens sur la plage. Je scrute la nuit. Il n’y a personne.
Je m’allonge sur le sable.
— Laura où es-tu ?
— Laura où es-tu ?
— Laura ?
Le silence me répond. Je finis par m’endormir sous une pluie d’étoiles…
III.
Mercredi 3 septembre
« Un Tueur au Paradis «
05 :00
Le premier rayon du soleil et la fraîcheur matinale me réveillent. Je suis allongé sur le sable. Les mouettes crient et tournent au dessus de moi. J’entends les vagues, l’océan est calme. Il va faire très beau. J’ai les yeux explosés par la lumière. Je regarde ma Rolex, il est 5 heures du matin. Laura n’est pas venue. J’ai l’impression d’être Robinson sur son île.
Je me relève péniblement, j’ai des courbatures partout. Du sable partout. Je rentre à l’hôtel en marchant comme un vieux, je n’ai plus l’âge de faire ces conneries.
Je regagne ma chambre et me jette sur le lit…
Je me rendors immédiatement…
08 :00
Quelques heures plus tard, on frappe à la porte :
— Room service !
C’est la voix de Laura. Bon sang, je me sens mal. La Rolex : il est 8 heures, je n’ai presque pas dormi. Je n’ai jamais demandé un petit déjeuner à une heure pareille. Je râle.
J’enfile une robe de chambre et ouvre la porte. Laura tient un plateau sur lequel fume un petit déjeuner copieux à côté du journal. Elle a les yeux rouges comme si elle venait de pleurer, je crois même voir des traces suspectes dans son cou.
— Entrez.
Elle va poser le plateau sur la table. Elle fond en larmes :
— Je vous demande pardon, suffoque-t-elle.
Je m’empresse de refermer la porte après avoir vérifié qu’il n’y avait personne dans le couloir.
— Asseyez-vous.
Elle s’assoit sur le lit, je m’assois à son coté. De grosses larmes coulent sur son visage. Je lui donne un kleenex. Elle les essuie et se mouche.
— Je vous ai attendu hier soir sur la plage, dis-je d’une voix douce.
Elle renifle.
— Je sais…
— J’ai même dormi sur la plage. C’est une expérience qui m’a rappelé mes 18 ans.
— C’est vrai ?
— Je vous jure.
Elle reprend peu à peu ses esprits.
— Je suis désolée.
— Oh, je ne vous en veux pas, rassurez-vous.
— Merci, j’ai eu un empêchement, bredouille-t-elle.
— Rien de grave, j’espère ?
— Non. J’ai été retenue. Contre mon gré.
— Contre votre gré ?
— Oui.
— C’est le maître d’hôtel ?
— Oui…
Elle refond en larme. Je la serre contre moi, pour la réconforter. J’imagine ce qui a pu se passer.
— Laura, il ne vous a pas violée ?
— Non, il n’a pas pu. Mais j’ai eu très peur. Et j’ai pensé à vous… Je ne peux rien faire contre lui, je ne veux pas perdre ma place. J’ai besoin de ce travail.
— Je comprends…
— Il faut que j’y retourne. Je suis désolée de vous avoir réveillé. Je ne savais pas où aller. Le petit déjeuner est cadeau.
Je lui souris.
— Laura, si vous avez le moindre problème, sachez que je suis votre ami. Faut oublier tout ça… Et puis il faut qu’on parle de mon prochain livre et de ce mystérieux crime qui a eu lieu ici.
Elle essuie son visage et se lève.
— Vendredi je suis de congé… Cet après midi, je vais dormir, c’est sûr. Ce soir, mais je n’ose pas vous le proposer.
— Écoutez, reposez-vous cet après midi. On peut aller boire un verre ce soir en ville, ça vous changera les idées. Et si vous avez un problème, ce ne sera pas grave en ce qui me concerne…
— Merci.
— Juste un mot, savez-vous où loge ce maître d’hôtel ?
— Il est à la chambre 505 au cinquième étage sous les toits.
— Et son nom ?
— Serge Doriac.
— Doriac, c’est parfait.
Elle s’inquiète :
— Ne faites pas de bêtises…
— Rassurez-vous.
— A bientôt…
Elle me sourit et sort. Je ferme la porte.
Il faut que je calme ce maître d’hôtel.
Je prends le petit déjeuner avant que le café ne refroidisse. J’ouvre les fenêtres, la lumière m’éblouit. Je m’installe sur le balcon confortablement et ouvre le journal Sud-ouest. Le titre est éloquent :
« Explosion mortelle dans une villa près du port. Henri Lacaze est décédé dans les décombres de sa villa. Il y avait une cache d’armes et des explosifs dans la cave. »
La photo est terrible : il n’y a plus de maison, tout simplement. L’article continue en page 4.
« Il semblerait que l’explosion qui a détruit complètement une villa, route de la plage, soit due à un accident. Les experts n’ont retrouvé aucun système de mise à feu. Les armes et les explosifs étaient cachés dans la cave. Henri Lacaze avait tenu un restaurant bien connu dans la région et avait gardé des contacts avec le milieu de la pègre locale.»
Je me ressers. Pauvre Riton… Les autres nouvelles parlent de l’orage qui a dévasté la côte.
Je décide de m’occuper de Doriac, une petite visite de sa chambre s’impose.
Je descends en salle, mine de rien, je vérifie que Doriac est à son poste et que la voie est libre. Il prépare la salle à manger, il semblerait qu’il y ait une sorte de banquet. Il va être très occupé jusqu’au service de midi.
Je monte au cinquième étage par l’escalier. Il n’y a que cinq chambres, Doriac occupe la dernière, la 505. Les quatre autres sont inoccupées car il y a un peu de poussière sur les poignées de portes. Je ne touche à rien.
J’écoute à la porte 505. La chambre est vide. Je sors un kleenex, j’entoure la poignée de manière à ne laisser aucune trace et presse pour ouvrir la porte. Sans grande surprise, je constate que celle-ci est fermée à clé.
Je redescends par les escaliers. Au troisième étage, une femme de ménage s’affaire à pousser un grand chariot rempli de linge. Je l’accoste :
— Excusez-moi, pourriez-vous ouvrir ma porte, j’ai égaré ma clé…
— Vous êtes au premier ? Je descends tout de suite.
Je la suis, nous prenons l’ascenseur. La promiscuité de la cage et son embonpoint nous rapprochent.
— Vous êtes l’écrivain?
— Vous avez deviné…
La porte de l’ascenseur s’ouvre. Nous traversons le couloir. Elle sort une clé passe-partout de sa poche et ouvre ma porte sans problème. Nous rentrons dans ma chambre. Elle voit le livre de poche sur la table : « Albert le Dingue ».
— C’est votre livre ? dit-elle en me montrant le bouquin.
— Oui.
— J’ose pas vous demander un autographe…
— Vraiment. Quel est votre nom ?
— Georgette.
Je signe une carte de l’hôtel.
« Pour Georgette. Très amicalement.
Paul Montebourg. »
Je lui offre l’autographe. Elle le regarde, médusée. J’en profite pour récupérer discrètement une paire de gants dans ma valise. Les gants étant des outils indispensables, j’en possède plusieurs paires.
Georgette est émue aux larmes.
— Georgette, pouvez-vous me prêter votre clé cinq minutes, je descends chercher les miennes, j’ai dû les oublier au bar, tout à l’heure. Je vous la rapporte à l’étage.
Elle renifle :
— La voici, pas de problème. Merci mille fois, monsieur Montebourg.
Je prends la clé. Nous sortons, elle tient l’autographe dans sa main sans oser plier la feuille. Je descends à pied, elle monte par l’ascenseur au troisième continuer son ménage.
J’attends une minute au rez-de-chaussée. Puis j’appelle l’ascenseur. Il est vide. Je monte au cinquième. J’introduis la clé dans la serrure de la chambre de Doriac. Elle marche. Je chausse les gants, je pousse la poignée. La porte s’ouvre. J’entre. Je fouille la chambre, je renverse les objets, soulève le matelas. Dans la salle de bain, je trouve dans un sac des photos de cul. Ce sont des tirages numériques, visiblement, elles ont été prises ici, je reconnais le décor. Il y a donc quelque part dans cette chambre un appareil photo numérique et des cartes mémoires. Méthodiquement je continue ma fouille. Dans l’armoire, sous une pile de serviettes, un Nikon SP 4500 et deux cartes mémoires MMS 512 mégas. J’observe les prises de courant dans la chambre. Sur l’une d’elle est branché le chargeur du Nikon. Je le débranche. Je laisse la chambre en désordre. Je n’emporte que l’appareil et ses accessoires. Je sors, je referme la porte à clé.
Je descends un étage à pied. J’appelle l’ascenseur. Je planque l’appareil sous ma veste. Et j’enlève les gants. Je m’arrête au troisième. Georgette, est là avec son chariot. Je lui tends la clé passe partout.
— Merci mille fois, j’ai retrouvé ma clé.
— Ah, tant mieux.
Elle semble soulagée. Moi aussi.
— Merci, encore.
Je descends les escaliers et rentre dans ma chambre. Je souffle.
Finalement c’était un jeu d’enfant…
10 :30
Je branche le Nikon. Je vais pouvoir récupérer les photos de Doriac sur mon PC portable qui est équipé d’une prise pour les cartes MMC.
J’allume la bécane et glisse une carte dans la fente. Je clique sur le dossier « Photos ». Les images se chargent.
La première apparaît sur l’écran : tiens, le groom en train de fumer un pétard. Il ne s’emmerde pas le petit personnel dans l’hôtellerie. Je passe à la suivante. Ah, le groom a sorti son artillerie, il est plutôt bien monté, il a le pantalon aux genoux. Ses yeux rouges lui donnent un air de vampire. Il a un air halluciné. C’est Doriac qui prend la photo.
Je clique.
« Mais il s’exhibe le grouillot ! Il a le gourdin. »
Je passe la cinquantaine de photos. En résumé, pour ne pas choquer, Doriac se fait le groom : fellations, sodomies, 69, le missionnaire, la roulette russe, le filet mignon, la cafetière italienne, et pour finir, la crème pâtissière.
La totale quoi…
Il a les fesses boutonneuses le maître d’hôtel. C’est le stress et l’alimentation. J’ai eu ce même problème il y a quelques années. Ça m’a fait peur, j’ai cru que mon corps se vengeait de ce que je lui faisais endurer. Trop de bons restaurants, trop d’alcools, trop de cigares et pas assez de sexe. Et puis j’ai lu qu’il fallait changer d’alimentation et se déstresser. Et bien, croyez-moi, aujourd’hui j’ai les fesses lisses et douces comme celles d’un bébé.
Là, le Doriac, on voit que c’est un grand angoissé.
— Je charge l’autre carte MMC.
Loading…
Mon sang ne fait qu’un tour, c’est bien ce que je craignais. Sur la première photo, Laura est allongée sur le lit, dans la tenue de travail qu’elle portait hier soir. On voit ses longues cuisses sous sa mini jupe noire. Doriac est à côté d’elle, un troisième lascar prend la photo. La date sur la photo est bien celle de cette nuit, l’heure indique 00:34. Doriac se marre, je zoome sur son visage, il est défoncé grave, ses pupilles rouges sang sont dilatées. Laura a des yeux mouillés de larmes. Elle serre les genoux. Je n’ose regarder la suite.
Il l’a bâillonnée avec du scotch large, elle doit crier, il a peur qu’on l’entende. C’était ça les traces du bâillon qu’avait Laura dans le cou. Il lui tire la jupe. On voit sa culotte, c’est un petit string rouge. Laura serre ses cuisses et semble se débattre. A la vingtième photo environ, il tente de lui enlever le slip. Le visage de Doriac est de plus en plus livide. Il a des poches sous ses yeux fracassés. Je zoome. Il y a des bouteilles d’alcool vides, les cendriers sont remplis de joints et de mégots, il y a un sachet de poudre blanche. Ils se sont défoncés. C’est la chance de Laura. Ils ont dû passer la nuit à négocier avec elle pour qu’elle consente.
Elle a tenu bon. Les dernières photos sont floues et sans intérêts. Ils sont bourrés… On voit juste sur l’une d’elle une belle paire de fesses. Ce sont celle du groom, je reconnais, la couleur beige d’un bout de slip
C’est minable.
Il n’empêche que Doriac est dangereux et pervers. A l’heure qu’il est, il doit être en plein service. Je planque le matériel photo du maître d’hôtel dans un sac en plastique blanc que j’attache à un bout de ficelle. Je suspends le tout sur un côté du balcon, le long du mur, en attachant discrètement la ficelle à un barreau en fer forgé. On ne voit rien. Là, ils pourront toujours fouiller. S’il pleut, pas de danger, le sac est étanche.
Je sors et descends à l’accueil. La standardiste est à son poste. Au restaurant le service s’affaire.
— Puis-je téléphoner tranquillement ?
La donzelle me sourit poliment.
— Il y a une cabine derrière vous…
Je me retourne, j’entre dans la cabine. Je vois la standardiste à travers la vitre. Je compose le numéro de l’hôtel Miramar. Je la vois qui décroche. J’entends sa voix dans le combiné, il y a un léger décalage avec sa bouche :
— Allo, hôtel Miramar. J’écoute.
Je masque ma voix, en la gonflant dans les graves, style Gabin dans « Touchez pas au Grisbi ».
— Allo, mademoiselle, puis-je parler à monsieur Doriac, Serge Doriac. C’est personnel et urgent.
— Hum, c’est de la part de qui ?
— Dites lui que c’est privé.
— C’est qu’il est en plein service…
— Écoutez, passez-moi Doriac, je suis obligé d’insister car c’est personnel et grave…
Mon ton l’impressionne.
— Bien, ne quittez pas.
Elle semble ennuyée. Elle compose un numéro. Elle discute. Se fait probablement engueuler de déranger le personnel pendant le coup de feu. Finalement, j’entends la voix de Doriac :
— Oui allo !
Il semble irrité. Moi je commence à jouir :
— Monsieur Doriac, c’est le nouveau détective de l’hôtel qui vous parle, je suis chargé de la sécurité des hôtels du groupe. Je me suis permis de perquisitionner votre chambre, la 505. Et je suis très contrarié d’y avoir trouvé des photos de viols, de fellations et de sodomies sur le personnel de l’hôtel, photos inadmissibles que j’ai confisquées. Vous comprendrez que je suis obligé de faire un rapport à la direction nationale de notre établissement. Je pense que vous recevrez une lettre de licenciement sous peu. Avez-vous quelque chose à dire ?
Il a raccroché…
Je sors de la cabine. La standardiste me salue. Soudain j’aperçois Doriac transpirant qui court comme un damné. Mon coup de fil l’a secoué. Les ascenseurs sont occupés, il prend les escaliers quatre à quatre. Il court dans sa chambre, vérifier qu’il a bien été perquisitionné. Lorsqu’il va s’apercevoir que son attirail photo a bien disparu et qu’on a fouillé partout, il va chier dans son froc et faire ses bagages. Je ne lui donne pas une heure avant qu’il disparaisse de l’hôtel, tout seul… Et définitivement.
Tiens, je croise le groom, il me salue discrètement d’un geste de la tête, je repense aux photos, à ses petites fesses, je ne pourrai plus le regarder comme avant…
Si j’allais déjeuner. Ces événements m’ont un peu creusé.
12 :10
J’entre dans la salle à manger. Laura m’aperçoit. Elle est aussi souriante que si elle avait dormi douze heures la nuit passée. Je l’admire. Elle a juste un bas qui a filé. Je m’assois à une table libre.
— Aujourd’hui le plat du jour, c’est de la raie aux câpres dans du beurre meunière avec des pommes de terre vapeur tournées et persillées, le tout arrosé d’un filet de citron.
— Dit comme ça, ça donne envie. Va pour la raie. Avec une petit verre de Sauvignon sec et frais…
Je vais me régaler. De la table où je suis, je peux voir par la porte, le hall d’entrée. Je ne tarde pas à voir passer Doriac en costume de ville et sa valise qui prend la tangente sans regarder personne. Le malfrat a la queue entre les jambes. Il doit fouetter de savoir que ses photos de partouses se baladent. Je vais les mettre sur Internet, comme ça tout le monde en profitera. Mais je garderai celles de Laura. On les détruira ensemble, ce soir.
Je déguste ma raie; l’acidité des câpres décape délicieusement mes papilles. Le persil sur les pommes de terre beurrées et citronnées me ravit. La dernière gorgée de Sauvignon est céleste. J’entame lentement ma digestion.
Laura s’affaire et me sert le café. Je lui annonce la nouvelle :
— Je crois que Doriac a démissionné…
Elle ne moufte pas. Je pense qu’elle n’a pas réalisé ma phrase.
Charles André Rubens, très élégant, se lève d’une table proche de la mienne et m’accoste :
— Monsieur Montebourg. Voulez-vous vous joindre à nous pour un petit cordial ?
— Mais comment donc.
Je me lève. Charles André me tend une chaise. Je m’assois en face de Fernanda qui frétille.
— Monsieur Paul, s’esclaffe-t-elle, nous parlions des « people », savez-vous qu’ils se reproduisent entre eux ? C’est devenu une race à part. On est « people » de père en fils aujourd’hui.
Charles André surenchérit :
— Mais, ma chère, les producteurs de tous bords recherchent le nom connu avant tout. Ils recyclent les « fils de… ». Ils veulent du sordide et du vécu. Moi qui croyais que l’art devait nous emmener là où on n’aurait jamais osé aller. Dans des zones inconnues où l’esprit de l’homme n’a jamais mis un neurone. Aujourd’hui le marketing a gagné et a définitivement décapité l’art. Le marketing nous amène là où tout le monde veut aller. C’est épouvantable. Les études de marchés auprès des consommateurs dictent aux constructeurs quelle voiture fabriquer : petite ronde, couleur vives. Résultats : tous les constructeurs de bagnoles sortent le même modèle issu des mêmes sondages d’opinion en même temps. Et c’est la même chose pour les livres qu’on lit, les repas qu’on mange. Qu’en pensez-vous, Montebourg, vous qui écrivez des polars ?
Fernanda me fait du pied. Je toussote :
— L’économie s’essouffle forcément, comme on ne crée plus rien, les chinois fabriquent moins cher que nous et nous nous appauvrissons irrémédiablement. Alors qu’il faudrait inventer des choses nouvelles. Que d’autres ne pourraient pas faire.
— Mais, vous avez raison, éructe Charles André, regardez la mode. C’est quoi la mode ? Le luxe, c’est juste des inventions inutiles, des parfums, de montres, des sacs. De l’invention. De l’argent. Des créateurs.
— C’est vrai. D’ailleurs, on tue beaucoup dans le luxe. Problèmes de succession, d’égo, de sexe. La couture est accoutumée des boutonnières. On s’y taille de sacrés costards.
— Comme vous êtes drôle Monsieur Paul vous parlez comme un polar.
— Bon mes amis, ce n’est pas tout. Mais j’ai à faire. Cette discussion m’a inspiré un nouveau chapitre. Je vous quitte. A ce soir.
Fernanda proteste. Je me lève, salue tout le monde et monte dans ma chambre.
Une petite sieste s’impose. Le vin blanc est un excellent soporifique. Je m’allonge sur le lit et me laisse aller dans les bras de Morphée…
18 :00
Je me réveille. J’ai bien récupéré. Je me sens en pleine forme. Je fais couler un bain, et plonge dans la mousse parfumée au Monoï.
Simona se matérialise en face de moi. Elle est nue dans la baignoire :
— Chéri, tu devrais aller te faire bronzer un peu sur la plage.
— Tu sais, il y a des gens pour qui le bronzage est une faute de goût, une vulgarité. Je suis de ceux là. Mon visage est buriné, il a vu tous les soleils, il a pris tout les coups possibles, laisse-le se la couler douce.
— Tu me trouves bronzée et vulgaire ?
— Non, ma chérie, tu es faite pour vivre au soleil. Tu dois capter la lumière pour mieux la restituer, la nuit, le samedi surtout, sous forme de fièvre. C’est toi mon seul soleil. C’est mon âme qui brunit et dore à ton coté.
Elle se coule contre moi.
— Je suis très amoureuse.
— C’est normal, c’est bientôt la pleine lune. Les soirs de pleine lune les loups sortent de leur repaire et hurlent. Les femelles le savent, instinctivement.
— Je t’aime, chéri.
Simona disparaît… Je prends vingt ans dans la tronche. Je sors du bain et enfile une robe de chambre. Je m’agenouille sur le sol et fais mes pompes quotidiennes. Je vais jusqu’à trente.
Le soleil est encore haut dans le ciel, à poil dans ma robe de chambre, je flemmarde sur la terrasse. J’ai hâte de retrouver Laura, j’espère que ce soir il n’y aura pas d’entrave à notre rencontre.
Comme j’ai le temps, je soulève la latte 17-15 du parquet. Je récupère ma précieuse sacoche. J’extrais délicatement les couteaux et les pose bien alignés sur la table. Un bon ouvrier doit entretenir et respecter ses outils. Du bout de l’index, je tâte le fusil à aiguiser, il a gardé tout son mordant, le manche est en corne de buffle. C’est de la bonne came. Je commence par le désosseur.
« Zip, zap, zip, zap… »
J’adore le bruit de la lame qu’on aiguise.
« Zip, zap, zip, zap… »
Je tue le temps…
Le couteau à désosser est le pilier central de l’équarrissage, autour duquel tournent toutes les autres lames, hache comprise. Je lui ai donné un surnom : le « Saigneur des Couteaux ». Il sert, certes, à l’épluchage de la viande, mais pris à pleine main, pointe en bas et lame contre soi, il permet d’aller chercher l’articulation de deux os au fin fond de la carcasse. Sa terrible pointe pénètre dans le cartilage et coupe les ligaments. Elle sépare les chairs et les os. Aucune articulation ne peut résister à ce fantastique outil, en quelques secondes on sépare un membre du tronc, une main d’un avant bras, une cuisse d’une hanche, sans avoir recourt à la hache qui projette toujours des particules désagréables d’os et de sang, qu’il faudra nettoyer avec le plus grand soin. Le désosseur est la lame absolue. Sa forme a nécessité des siècles et des siècles de coutellerie acharnée, des centaines de milliers d’animaux (voire des millions), réduits en steaks, côtes, tournedos, escalopes, rôtis, daubes, boulettes, gigotins et j’en passe. Au fil du temps, sa forme est arrivée à la perfection. Dans mille ans, on l’utilisera encore sous sa forme actuelle. Et qu’on ne me cherche pas en argumentant fallacieusement sur l’efficacité de futurs couteaux à lame laser. Certes dans les opérations de la cornée, le laser est d’une précision diabolique, mais jamais il ne remplacera la sensation unique, animale, je dirais presque orgasmique, que donne le couteau à désosser, le « Saigneur des Couteaux », à qui sait le prendre.
Un peu de suif sur la lame parachève le travail d’aiguisage. Je trouve dans la sacoche une vieille couenne de lard, dont j’ai oublié à qui elle a appartenue. Je la passe doucement sur le métal précieux. A voir la pilosité sur le coté épidermique de la couenne, ce n’est pas du porc, ce serait plutôt… Mais bien sûr, il y a un tatouage qui représente un serpent qui se mord la queue en forme de 8 : c’est Gluch.
Le docteur John Gluch refait surface peu à peu dans ma mémoire. C’est de l’histoire ancienne. Je me plonge dans mes souvenirs.
J’ai, à cette époque, des soucis d’argent, c’est le début de ma carrière. Je vis une vie plutôt dissolue. Je me nourris comme un goret dans les restaurants parisiens. Je viens de perdre une affaire importante, un écrivain russe que j’ai raté à cause d’un train suisse qui ne s’est pas arrêté au bon endroit, un certain Soljenitsyne, je crois… D’où stress, naturellement. Bref. J’ai de gros problèmes de transit. En ces temps là, je n’ai pas encore les relations que j’ai aujourd’hui. Avec le temps, je me lasse de ces moments passés, assis sur le trône, à souffrir de constipations chroniques, de tellurisme et de météorisme qui m’obstrue le gros colon. A bout, je décide de consulter. A cette époque, j’habite à Paris, près de la rue de Picpus, un petit appartement cossu. L’hôpital Rothschild est tout proche et a un service de gastroentérologie.
Rothschild, en principe, c’est du sérieux. Spécialisé dans la gérontologie, je ne peux qu’avoir confiance dans cette institution et dans son service de gastro-entérologie, car pour confier cette partie du corps, si sensible, si mystérieuse (c’est la seule partie de son corps qu’on ne verra jamais de visu, sans l’artifice d’un miroir ou d’une caméra), il faut avoir une confiance aveugle.
Je vais donc un matin dans la salle d’attente du docteur John Gluch, gastro-entérologue connu, chercheur diplômé, professeur émérite. Je ne sais pas alors quels sont les contours exact de la gastro-entérologie, cette science, cet art, que j’ai découvert depuis. Ma culture, à ce moment-là, s’arrête à la gastronomie qui est le pendant de la gastro-entérologie, l’un étant coté bouche, l’autre coté cul.
Mon tour venu, je rentre dans la salle de consultation. Je suis surpris de la sobriété de l’endroit. En lieu et place de machines sophistiquées, radio télescope au laser, écrans tridimensionnels et computers futuristes, il y a une simple table sur laquelle sont alignés des sortes de sonotones en métal, de diverses longueurs, dont je ne saisis pas tout de suite l’utilité.
Le docteur John Gluch est très antipathique. Petites lunettes rondes, d’un autre âge, blouse blanche immaculée, barbichette et fine moustache qui dénotent un sadisme aigu. Il a un je-ne-sais-quoi dans l’œil de vicieux qui vous fait immédiatement regretter d’être venu. En guise de bienvenue il me harcèle de questions :
— Quel âge avez-vous?
— J’ai la trentaine.
— Vous pratiquez quelle profession ?
— Je suis indépendant, genre profession libérale.
Il me jette un œil inquisiteur.
— Libérale ?
— Ben oui, libérale, quoi… Je suis à mon compte.
Il gratte son papier.
— Vous êtes vous fait sodomiser récemment ?
— Quoi ? Non !
— Combien de fois ?
— Je viens vous dire que je ne me suis jamais fait sodomiser, docteur.
La moutarde commence à me monter au nez.
— On dit ça, mais dans la réalité on sait bien que souvent, il n’en n’est rien, je suis bien placé pour le savoir. Comment sont vos selles ?
— Excusez-moi, je n’ai pas l’habitude d’analyser mes excréments, faut dire que les toilettes modernes ne s’y prêtent guère… Ce sont des merdes, qui puent… Rien d’extraordinaire.
— Analyser, vous avez dit « analyser », vous savez que l’étymologie de ce mot vient d’« anal » (il sourit de plaisir). L’anus, cher monsieur, est le centre de gravité de l’individu qui tient sur ses pattes arrière. (Il fronce ses épais sourcils) C’est un organe fascinant ! Souffrez-vous de flatulences et de ballonnements ?
— Parfois,
— Mastiquez-vous bien vos aliments ? Ouvrez la bouche !
Il s’approche de moi, j’ouvre ma bouche, il y plante son regard perçant.
— Vous mangez de quel côté ?
— Du côté de la gare du Nord, pourquoi ?
— Non, s’irrite-t-il, je vous demande de quel côté de la bouche vous mastiquez ?
— Ah, pardon, euh, plutôt à droite.
— Vous ne mastiquez pas assez, il faut couronner ces molaires. Bon, vous enlevez votre pantalon, votre slip et vous vous mettez à quatre pattes sur la table, on va regarder tout ça.
— Pardon…
Je ne sais expliquer la panique qui s’empare de moi. Je comprends maintenant à quoi servent les sinistres sonotones en métal. L’idée de me mettre en levrette pour que ce vieux vicelard me plante ses tuyaux dans le fion, me glace. Bien sûr, en échange il y a la rédemption, la guérison. Voir ces gros nuages qui obscurcissent mon horizon se retirer. Penser que j’évite une phase terminale horrible pendant laquelle j’aurais vu mes intestins pourrir et je me serais vu déféquer ma propre chair. Bien sûr le docteur John Gluch est insupportable mais il en a guérit plus d’un. Je m’exécute et opte, par la même, pour mon salut, au détriment de mon honneur. J’enlève mes vêtements et me mets dans la terrible posture.
— Tournez la tête et mettez bien la joue contre la table et levez les fesses.
Je me mets à transpirer à grosses gouttes. Je l’entends se mettre des gants en caoutchouc. La sensation qui suit n’est pas descriptible par des mots. Je fais un « oh ! » de surprise qui génère la réplique classique et irritée des praticiens à l’œuvre :
— Détendez-vous, là… Vous êtes trop tendu, je ne peux rien faire…
Je ressens une douleur aiguë. La suite est terrible, il m’est difficile de la raconter car, dans ma position, je ne peux assister à la scène. Je peux seulement tenter de reconstituer les choses d’après des sensations, des bruits. Sous toutes réserves donc, voici dans l’ordre ce que ce « nazi » pratique : outre un toucher rectal, il enfonce une sorte de canule pour prélever des matières qui obstruent le passage. Puis il enfonce dans l’appareil une sorte de corde à piano de plusieurs dizaines de centimètres de long, au bout de laquelle une minuscule pince coupante peut être actionnée, afin de prélever un peu de chair sur la paroi intestinale. Je suis prélevé à cinq reprises, à vif. A la fin de la séance, je crois m’évanouir.
Il me donne rendez-vous le vendredi suivant. Je repars en marchant, les jambes écartées, comme un infirme, en proie à une légère hémorragie. Et je marche ainsi au moins pendant trois jours.
Le vendredi suivant, je reviens à la consultation pensant avoir les résultats des analyses et savoir enfin si l’enfer de la chimio va commencer ou si au contraire le printemps de la vie va renaître…
Le Docteur John Gluch commet alors deux erreurs qui vont lui être fatales : il me pose une première question :
— Vous êtes vous fait sodomiser récemment ?
Devant ma perplexité, il ajoute :
— Bon, vous enlevez votre pantalon, votre slip et vous vous mettez à quatre pattes sur la table, on va regarder tout ça.
— Mais je croyais avoir les résultats des analyses ?
Je m’énerve. Je sens que je perds mon sang froid.
— Écoutez cher monsieur, vous êtes ici dans un centre de recherche, il va falloir des mois de patience pour, peut-être, faire un diagnostic précis. Je prélève au hasard, à l’ancienne… Mais si vous venez par vice, il faut me le dire…
Je crois que je vais l’étrangler.
J’explose :
— Écoutez, docteur, c’est vous qui allez vous allonger sur cette table.
Ma décision est prise. Je prends une paire de gants en caoutchouc qui traîne sur la table et je les enfile. Le docteur Gluch me regarde, stupéfait. Je le prends par le collet et le porte sur la table. Il ne pèse pas lourd. Il gigote, proteste et se débat. Une fois sur la table, je bourre sa bouche de coton. Je le déshabille complètement, puis je prends des bandelettes que j’ai repéré dans un carton et le ficelle de manière à ce qu’il ne puisse plus ni bouger ni crier. Calmement, j’enfile sa blouse blanche de praticien que je ramasse sur le sol. Il me regarde de ses petits yeux cruels.
Comment faire disparaître un gastro-entérologue avec élégance ? Il faut le saigner comme un poulet pendant que le cœur bat encore, c’est la base, sinon lorsqu’on va le découper on en mettra partout. Une hémorragie anale me parait être en bonne harmonie avec le gastro-entérologue old fashion qu’est le docteur Gluch…
En fouillant, je ramasse une bassine que je pose sur le sol. J’ouvre des tiroirs. Je trouve des outils, des couteaux, des scies de chirurgien, des scalpels.
J’entreprends de le vider de son sang. Je le retourne sur le dos. Il gigote et gémit. Il me fait penser à un lombric. D’un geste précis et rapide, à l’aide d’un bistouri, je tranche ses veines anales. Le sang noir gicle. Je le fais couler dans la bassine, en prenant soin de ne pas verser à côté. Je lui lève les pieds afin de le vider complètement. En se tétanisant, parfois, il arrive à stopper l’écoulement, mais ce ne sont que les spasmes bien compréhensibles de l’agonie. Je le maintiens assis sur la bassine. L’opération dure bien dix minutes. L’odeur est pestilentielle, à mon avis, il n’y a pas que du sang dans la bassine… Au fur à mesure qu’il se vide, il a moins de contractions.
A la fin, il est complètement détendu. Je l’allonge sur la table. Je verse la bassine pleine de sang encore chaud dans le lavabo. Puis je fais couler le robinet pour bien la rincer. Je reviens vers la table, mon patient a une sale mine. Je trouve des sacs poubelles dans un placard qui sert de buanderie, les lies ne sont pas jaunes, tant pis.
J’entreprends alors le découpage méthodique du docteur Gluch. Je remarque un tatouage sur son bras gauche, un motif difficile à lire, je découpe la peau de manière à récupérer une lanière contenant le tatouage. Je l’enroule dans un mouchoir et la glisse dans ma poche. Je l’étudierai plus tard.
Je m’affaire. L’odeur est insoutenable, je ne dois pas y penser. J’aime avoir un œil critique sur les choix de la nature. Si, dans le principe, je suis séduit par la logique des choses naturelles. Là, je suis dubitatif. D’habitude quand on parle de « Nature », on imagine quelque chose de sage, de respectable, de sain, de « bon » opposé au mauvais. Mais là, appliqué à ma besogne, j’observe le coté vicieux, cruel, je dirais même malsain, de cette même « Nature ».
Par exemple : avoir mis l’écoulement de l’urine et du sperme dans le même canal d’évacuation est choquant.
Autre exemple : l’anus positionné si près du vagin chez les femmes. Outre le fait que, sur le plan hygiénique, c’est limite, on peut considérer qu’il y a là une sorte de provocation, un appel au vice. Car il ne faut pas être chirurgien du cerveau pour comprendre que, de bonne foi, tôt ou tard, un sexe en érection va glisser accidentellement d’un conduit à l’autre. La « Nature » doit avoir des idées derrière la tête. Si elle a choisi ces solutions, c’est, à mon avis, pour offrir une alternative entre la vie à tout prix et le plaisir défendu. Les intégristes de tous bords devraient faire tourner soixante neuf fois leur fronde avant de jeter la pierre aux sodomites.
Bref, je passe sur les détails. Mais en vingt minutes, la totalité du docteur est dans deux sacs poubelles de cinquante litres, avec la toile qui recouvre la table, les bandelettes, ses vêtements et ma blouse qui est un peu souillée, elle aussi. La salle est d’une propreté impeccable. Du beau travail. Je lave les instruments de chirurgie à grande eau et les remets à leur place. J’enlève mes gants en caoutchouc et les jette dans un des deux sacs poubelle. Par précaution, je me lave les mains avec du savon bactéricide. J’ouvre une petite fenêtre pour aérer. Je mets les deux sacs sur un chariot qui traîne là, et sors en le poussant, comme si de rien n’était. Le groom automatique referme la porte derrière moi. Trois nouveaux patients attendent leur tour assis sur un banc couvert de graffitis, à mon avis, ils vont patienter encore un bon moment…
Je pousse mon chariot au hasard des couloirs. Je rencontre un employé de nettoyage et je lui demande, comme à un collègue, ou est le crématorium où on incinère les déchets.
C’est avec le plus grand naturel que je pénètre dans une cave noircie, équipée d’un gigantesque four où il règne une chaleur infernale. J’ouvre la lourde porte ronde du four. Les deux sacs passent tout entier dans le crematorium de l’hôpital. Tout, sauf ce bout de peau que je garde comme un scalp, un trophée qui a fini là, dans ma sacoche. Depuis, ce bon docteur John Gluch, ou du moins ce qu’il en reste, lubrifie mes lames et les protège de l’oxydation. Quand à mon cancer, il a préféré battre en retraite. Comme dirait Brassens :
« Moi, mon colon, il va très bien merci… ».
Tout est affaire de stress.
Quand je sors de l’hôpital, je vois, sur les toits, cette grande cheminée d’où s’échappe une épaisse fumée noire, qui n’est autre que l’âme acre de l’épouvantable docteur John Gluch.
La gastro-entérologie a beau être en deuil, je ne peux m’empêcher de marcher d’un pas alerte, presque joyeux.
La nuit est tombée. Il est temps que je me prépare. Je range ma sacoche dans son trou et remets la latte du parquet.
23 :30
Laura a bientôt fini son service. Je me rase. Costume strict noir. Chemise blanche sans cravate. Je prends la carte Gold de Paul Montebourg et trois cigares.
Je descends au rez-de-chaussée… Il reste deux couples de retraités au bar de l’hôtel, qui sirotent des cocktails, assis sur les clubs, en écoutant Sarah Vaughan. Je choisis une table à l’écart. J’allume un cigare. Il n’y a personne derrière le bar. Laura n’est pas là. Un instant, je suis pris d’un doute. Et si Doriac était revenu. Après tout une jolie fille comme Laura ne doit avoir aucun mal à trouver un amant. Je doute de mon sex appeal. Je ne suis plus aussi séduisant qu’il y a vingt ans. L’âge n’est plus un argument avantageux de nos jours. Autrefois les jeunes femmes aimaient le luxe, la sécurité, la force tranquille des tempes grise et les bouches qui ont embrassé goulûment la vie, les fronts plissés et brunis par mille soleils. Aujourd’hui, elles préfèrent la chair fraîche et le lait allégé.
— Monsieur Montebourg prendra un Lagavulin ?
Je me retourne, c’est elle. Je la reconnais à peine. Elle est coiffée, maquillée. Plus belle que jamais. Ce n’est plus une jeune fille, c’est une femme. Avec un grand « F ». Est-ce pour moi qu’elle a fait tous ces changements ? Ou est-ce le départ de Doriac qui l’a libérée ?
— Avec un verre d’eau, sans glace. S’il vous plait, dis-je un peu surpris.
Elle s’envole derrière le bar et s’affaire. Elle revient et pose son plateau sur ma table. Comme au premier jour, mon œil glisse sur son cou. Il se perd un instant dans son décolleté qui ne cache rien. Elle a des seins magnifiques. Son visage est angélique. Ses lèvres brillent. Son parfum me hante et m’exaspère car je n’arrive toujours pas à l’identifier.
— Vous êtes toujours d’accord pour ce soir ?
C’est exactement les mots que j’allais prononcer.
— Non, désolé, je suis pris, je sors avec Laura ce soir.
Elle ne comprend pas tout de suite ma plaisanterie. J’ajoute pour la rassurer :
— Vous lui ressemblez beaucoup. On part à quelle heure ?
Elle sourit.
— Dès que les clients seront partis, on pourra y aller.
— Je vais commander un taxi.
— Pas la peine, j’ai une voiture…
— C’est vous qui me sortez, alors ?
— Exactement.
Je sens une bouffée de bien-être m’envahir. La nuit s’annonce tropicale. Je déguste mon Lagavulin, sa brûlure est particulièrement excitante. Je me détends. La voix de Sarah Vaughan est comme un élixir érotique. Je me sens au sommet de ma masculinité. Comme j’ai quelques jours de repos au compteur, je sais que je peux compter sur la vigueur de mon vieux compagnon, membre éminent du cercle de mes bonnes relations, qui se frotte les mains, là, dans mon pantalon.
Le dernier couple de retraités américains se lève. Et signe la fiche que leur tend Laura.
— Bye !!!
— Bye…
Laura les accompagne à la porte qu’elle referme derrière eux.
— J’arrive tout de suite, me souffle-t-elle.
Elle disparaît dans l’office. Puis réapparaît quelques secondes après. Elle n’a plus son tablier, mais une robe noire cintrée qui gaine ses hanches. Je n’aperçois pas de trace de string ou de culotte. Elle est superbe.
— Je suis à vous, me lance-t-elle.
Elle tient un sac à main d’où elle extrait un trousseau de clé.
— Je préfère qu’on ne nous voie pas ensemble. Attendez-moi dehors, je suis garée sur le parking de l’hôtel.
J’acquiesce et sors. C’est une longue et chaude nuit d’été, comme dit la chanson d’Hendrix. Je fredonne :
« Long Hot Summer Night. »
Je marche vers le parking où il reste quelques voitures, des clients de l’hôtel. Ce soir c’est la danse de la reproduction qui va commencer :
« Le mâle s’approche de la femelle. Il a mis des sous-vêtements propres et a arrosé son corps de parfums épicés. La femelle a mis ses formes en valeur, surtout autour des zones érogènes. Elle a fait de sa bouche une muqueuse attirante qui émet de puissantes phéromones. La nuit venue, ils prennent une voiture et s’enfoncent dans la cité à la recherche d’un endroit obscur, enfoncé dans un sous sol, où la lumière est tamisée, où ils peuvent boire des alcools sucrés dont les vapeurs exacerbent leur sentiment et gomment les défauts de l’autre, car ces défauts pourraient les faire changer d’avis au dernier moment. Là, on entend des rythmes lascifs de percussions qui accélèrent le tempo du rythme cardiaque. Le cerveau va subitement être inondé :
1 : d’oxygène,
2 : d’alcool,
3 : de parfums et de phéromones,
4 : d’images excitantes et sublimées de l’autre
Cette chimie explosive fait alors simultanément péter le cortex « B » des deux hémisphères. Alors, sur la piste, les yeux injectés de sang, dans un rythme infernal, la femelle se déhanche, exhibant ses fesses et sa poitrine, le mâle lui tourne autour : la terrible danse de la reproduction a commencé. »
— Vous venez, c’est là.
Les phares d’une Twingo clignotent. Laura ouvre la portière. Je m’assois sur le siège passager. Elle met le contact et démarre en trombe. Je m’accroche à la poignée prévue à cet effet.
Nous traversons les landes dans la nuit, à vive allure.
— Où m’emmenez-vous, Laura ?
— C’est une surprise.
— Il n’y a pas de radar ?
— Non, ne vous inquiétez pas, je connais la route.
Elle roule vite.
— La journée n’a pas été trop dure ? Vous dormez très peu. Je me sens un peu coupable d’être en vacances.
— Vous savez, j’ai l’habitude. Et puis vous n’êtes pas tout à fait en vacances, vous avez un roman à écrire.
— Bien sûr…
Nous roulons, une dizaine de minutes sur une départementale avant de bifurquer sur un chemin.
— Je suis curieuse de savoir comment vous avez réussi à faire démissionner Doriac.
— Qu’est ce qui vous dit que c’est moi.
— Une intuition.
— Vous me prêtez des pouvoirs que je n’ai pas… Où m’emmenez-vous ?
— Je vous amène à l’Escargot.
— Un restaurant ?
— Non, une boîte sur la plage, en forme d’escargot.
— On descend dans une spirale sous terre ?
— Sous le sable. Et on entend la mer. Mais si vous avez faim nous pouvons manger au « Fin Landais », ajoute-t-elle, comme pour me rassurer.
00 :15
Nous arrivons sur un parking en plein air. Laura se gare. Nous descendons de la Twingo. Un alizé nous cueille, la mer est toute proche. Je suis Laura. Au loin un phare en érection lance son jet de lumière dans la nuit. Nous prenons un chemin bordé de bungalows qui mène vers la plage. On entend la rythmique sourde d’une musique.
L’entrée de l’Escargot est discrète. Laura sonne. La porte blindée s’ouvre. Un videur nous reçoit. Laura est une habituée. La musique bat son plein.
— Bonsoir, Alex. Ça va ?
— C’est cool ce soir, c’est les départs…
Nous descendons un escalier en colimaçon. La salle est quasiment vide. Ça sent la fin de saison. La lumière est tamisée. Une voix langoureuse chante sur un remix latino :
« Smooth operator… »
— Vous voulez que nous nous asseyions ici ?
Laura me montre une alcôve à l’abri des regards où deux fauteuils profonds nous tendent les bras. Nous nous installons ; les fauteuils sont confortables. Je regarde la carte des cocktails.
— Qu’est ce qui vous ferait plaisir ?
— Un Mojito bien glacé. Qu’en dites-vous ?
— Je vais prendre la même chose.
Laura appelle un serveur et commande les deux Mojitos.
— Alors Doriac ?
Elle est impatiente de savoir.
— D’abord, êtes-vous contente qu’il ne soit plus là ?
— Oui.
Ce « oui » de Laura est étrange, il ne sonne pas faux, mais il ne sonne pas vrai non plus. Elle se reprend.
— En fait je suis contente qu’il ne soit plus là, mais je suis mal à l’aise. Vous êtes allé dans sa chambre, n’est-ce pas ?
— Ça n’a pas été très difficile. Habitué aux scénarios de polar, c’était un jeu d’enfant de récupérer le passe partout pour entrer chez lui.
— Et vous avez trouvé quoi ?
Elle allume une cigarette avec mon Zippo.
— Je peux vous en prendre une ?
Elle me tend son paquet de Marlboro. Je prends une cigarette. Elle allume le Zippo. Je me penche vers elle et prends du feu. Je sens son parfum sucré et envoûtant. Je reste dans cette position propice aux confidences. Je n’y vais pas par quatre chemins :
— J’ai trouvé un Nikon numérique plein de photos pornos.
Je sens Laura mal à l’aise. Mais je veux crever cet abcès et passer à autre chose. Elle tire une bouffée de sa cigarette et souffle.
— Et alors ?
— Et alors, j’ai téléphoné à Doriac en me faisant passer pour le détective de l’hôtel. Je lui ai dit que j’avais perquisitionné sa chambre et que j’avais trouvé des photos compromettantes de sodomie et de harcèlement sexuels sur le personnel de l’hôtel. Et que j’allais en référer au siège.
— Sodomie ?
— Oui… Le Groom.
— Jean Christophe. Hou là…
— Des photos terribles prises par Doriac lui-même pendant qu’il sodomisait votre ami. Et il y avait des photos de vous aussi, Laura. Je comprends pourquoi vous n’êtes pas venue me rejoindre sur la plage hier soir…
Je la regarde. Une grosse larme chaude coule sur sa joue. Elle l’essuie d’un revers de main. Je continue :
— Doriac est un salaud, une petite ordure. J’attendais de vous voir et de vous en parler avant d’envoyer les photos à la police.
— Non ! Ne faites pas ça. Doriac est un salaud mais je n’ai pas envie que ces photos traînent. Et je pense que Jean Christophe non plus.
Elle renifle. Et se reprend.
— Je comprends, dis-je, elles sont en sûreté.
— A l’hôtel ? Il est capable de tout pour les récupérer.
Laura panique un peu. Elle est tout près de moi. Nos genoux se touchent. Je lui parle à l’oreille.
— Non, là où elles sont, il ne pourra pas les trouver. S’il fouille ma chambre, ce n’est pas grave, je n’ai rien à cacher, et il n’y a rien à voler, à part mon PC portable…
Je pose ma main sur les genoux de Laura. Le serveur nous interrompt et pose deux magnifiques Mojitos sur la table basse.
— On trinque ?
Laura se détend. Elle prend un verre et nous trinquons en nous regardant dans les yeux. J’essaie d’être rassurant.
— Laura, j’ai l’habitude de contrôler les situations. Oubliez Doriac, il ne vous importunera plus. Je vous remettrai toutes les photos et vous en ferez ce que vous en voudrez, avec le jeune groom. Je ne les ai pas toutes regardés. Le peu que j’ai vu m’a suffit. Je n’ai pas aimé du tout la souffrance qu’il vous a infligé. C’est criminel. Ça m’a mis en colère, c’est pour cela que j’ai réagi.
— Je comprends. Je vous remercie. Vraiment.
Elle me jette un regard très tendre. Elle ajoute :
— Je me sens en sécurité avec vous, Paul.
— Vous savez, on se connaît à peine. Je suis peut-être un vieux pervers qui drague les jeunes filles à la sortie des écoles…
— Je ne crois pas.
— Qu’est-ce que vous en savez !
— Je pense que vous êtes quelqu’un de généreux. Que vous êtes un vrai gentleman. Et qu’un homme comme vous doit avoir beaucoup de femmes autour de lui.
— Détrompez-vous. Je suis un solitaire.
Je laisse planer un silence. Laura a compris qu’un secret allait lui être révélé.
— La solitude ne vous pèse pas trop ? me demande-t-elle d’une voix plus grave.
— Vous savez lorsqu’on a perdu l’être qu’on aimait, même si on est solitaire, on n’est plus jamais seul. Jamais…
— Vous ne voulez peut-être pas en parler.
— Laura, nous sommes là pour boire et nous détendre. Je ne veux pas voir ces beaux yeux tristes. Parlons du roman.
Nous buvons une gorgée de Mojito simultanément. Je crois que j’ai gagné sa confiance. Elle se détend. Son rimmel a coulé dans ses yeux et lui fait un regard profond, encore plus émouvant.
— Je suis trop vieux pour danser, par contre j’aimerais vous voir sur la piste, onduler sous les lumières.
— Je n’aime pas trop danser moi non plus, avoue-t-elle. Il faut que je sois noyée dans la masse. Que la danse devienne comme une transe.
Je lui souris :
— Qu’allez-vous faire après la saison ?
— Je vais reprendre mes cours au mois d’octobre à Bayonne.
— Vous étudiez ?
— Le droit.
— Ah, le droit. C’est une matière très complexe.
— En fait, je travaille à l’hôtel pour payer mes études.
— Et vous n’avez pas un petit ami ?
— Non, je n’ai pas de petit ami. Je n’aime pas trop les garçons de mon âge, ils sont trop machos. Je suis une solitaire, moi aussi, dans mon genre.
Au fur à mesure que notre conversation passe, je me rends compte que rien ne vient troubler notre intimité. Nous sommes dans une bulle.
— Parlez-moi de ce meurtre qui a eu lieu au Miramar.
— C’est de l’histoire ancienne. Il y a près de vingt ans. C’est le chef cuisinier qui me l’a racontée. Une jeune femme a été trouvée morte dans une chambre.
— Vous savez laquelle ?
— Oui. La 109.
— Brrr, je ne sais pas si je vais rentrer dormir à l’hôtel ce soir…
Je frissonne.
— Je ne veux pas vous faire peur, mais on raconte que l’assassin a mangé le cœur de la jeune femme.
— Vous vous moquez de moi… Vous avez une imagination de romancière, on va bien s’entendre !
— Non, je vous jure que c’est vrai ! Je vous jure !
— Ce n’est pas possible. C’est horrible. Comment peut-on faire une chose pareille ?
— C’est un fait divers… Vous savez, des choses horribles, il en arrive tous les jours.
— Je vais demander à ce qu’on me change de chambre.
— Je suis désolée, je n’aurais pas dû vous raconter ça.
— Vous n’auriez pas dû ? Et comment. Vous avez bien fait. Je trouve cette histoire terrible et incroyable. Il faudrait que vous cuisiniez le chef.
— Que je cuisine le chef…
Elle rit.
— A-t-on retrouvé l’assassin ?
— Non.
— C’est incroyable.
Elle avale une gorgée de Mojito. J’en fais de même.
— A notre roman, lui dis-je en lui montrant mon verre.
— A votre roman… Je vous demande pardon, je vais aller aux toilettes.
— Mais je vous en prie. On peut peut-être se tutoyer. Ça me gène que vous me disiez « vous ».
— Ok.
Elle se lève et passe devant moi. Elle disparaît. Je prends une cigarette dans le paquet qui est resté posé sur la table et l’allume. Que se passe-t-il dans la tête de Laura. Nous sommes là, dans un club, à une heure avancée de la nuit, à nous faire des confidences. Ce n’est pas un hasard. Elle doit penser la même chose que moi.
Je jette un regard dans la boîte, il y a une dizaine de personnes accoudées au bar. Une fille danse sur la piste, sublimée par la lumière noire et la fumée. Elle se déhanche sur « Roxane » du groupe Police. Elle ondule comme une algue. Ça sent la mer et la chair. C’est l’heure où le désir monte. La chimie interne opère. La solitude et la tristesse inversent les pôles du magnétisme, il faut impérativement entrer dans la bulle de la danse. Les musiciens sont des pêcheurs, qui ramènent dans leur filet des blocs bien compacts de plaisirs, de rythmes et d’harmonies incantatoires, qui modifient la chimie interne du cerveau de ceux qui l’écoutent. Je ressens cette chimie en me laissant pénétrer par le « beat » impeccable de Stewart Copeland et les gémissements magiques de Sting. J’ai presque envie de danser. Je vais être ridicule. Tant pis j’y vais…
Ça y est je danse.
La piste est magique. La lumière et l’ombre, le son fabuleux des basses qui écrase délicieusement mes deux tympans me font passer dans une autre dimension.
Waouh ! Mes hanches sont un peu raides.
Je gueule:
— In the red light… Roooxane…
La fille me regarde en souriant. Elle est encore plus belle de près. A cet instant, j’aime tout le monde.
Laura revient. Elle s’assoit et me regarde un peu éberluée. Je ne peux pas la laisser seule. Au bout d’un moment je la rejoins.
Elle prend une cigarette. Ce coup-ci, c’est moi qui allume le Zippo. La flamme éclaire son visage.
— Merci, murmure-t-elle en soufflant la fumée. Vous dansez super bien.
Je ne dis rien. J’attends qu’elle prenne la parole.
— C’est bizarre, dit-elle, mais je crois que je vais avoir du mal à vous tutoyer.
— C’est pourtant facile, il suffit de dire « tu » : Laura, tu es belle.
Je la provoque.
— Vous voulez me faire rougir.
Elle tourne son beau regard vers moi.
— C’est terrible, Laura, j’ai envie de vous. J’en suis désolé. Je pense que vous avez dû entendre ça souvent. Je vous demande pardon. Mais je n’ai pas l’habitude de taire ce que je ressens.
Je tire sur ma cigarette. Je me suis jeté à l’eau, un peu sèchement.
— Moi aussi je suis bien avec vous. Ça va un peu vite, c’est tout.
Je ne m’attendais pas à cette réponse. Mais c’est elle qui a raison. J’aurais dû attendre. Elle étend ses jambes et pose sa tête sur le bord du fauteuil. Elle fume en me regardant. Ses yeux sont comme des portes qui ouvriraient sur un bout de paradis, un endroit mystérieux, intime, qui me fascine et où j’aurais envie de me blottir pour toujours. Je n’ai pas le choix. Son corps est une exhibition permanente.
Je pose mon regard dans ses yeux de papillon de nuit.
Je pose ma main sur le duvet de sa main.
Comme un starfighter à bout de carburant, j’ai envie de me poser…
Mais son regard devient soudain insoutenable, j’ai l’impression de planter mes doigts dans une prise électrique. Il faut que je les retire. Je suis incapable de l’embrasser. Pourtant, ce n’est pas l’envie qui me manque, mais je sens, au fond de moi, que c’est une comédie que nous nous jouons. Je baisse les yeux. Il ne se passe rien. Un silence s’installe. Puis elle finit par chuchoter :
— De toute manière, nos destins sont opposés. Vous repartez dimanche dieu sait où. Si je me donne à vous, vous allez penser que je suis une fille facile. Un béguin de passage.
— Vous avez raison. Mais d’un autre côté, le destin est entre nos mains. Et la vie est si courte, Laura… Ces minutes qui passent sont un repli du temps. Elles n’appartiennent qu’à nous.
— C’est vrai. La vie est une vacherie. Je repense à la pauvre fille qui est morte. Si ça se trouve, il ne l’a pas faite souffrir. Elle était amoureuse. Elle s’est blottie dans ses bras et il l’a tuée. Peut-être par amour…
— Laura, je pense que vous êtes déjà assez surmenée. Il ne faut pas que des idées pareilles vous traversent la tête. Par contre, ça me donne une matière fabuleuse pour le roman. Vous serez mon héroïne. Comme cela je ne vous quitterais pas.
— Vous allez me jeter dans les bras d’un « serial killer ».
— Oui, mais je vous sauverais.
— Et lui ?
— C’est vous qui le tuerez. A la fin. Ça vous plait ?
— C’est pas mal.
Je sens que Laura accuse la fatigue.
— Vous voulez qu’on bouge ? demande-t-elle, en avalant la dernière gorgée du Mojito.
— On peut rentrer, demain vous vous levez tôt…
— Demain est un autre jour. Je crois que j’aimerai marcher sur la plage.
Elle me jette deux petits yeux fatigués.
— Allons-y. Je vais payer.
— C’est déjà fait.
— Vous avez payé ? Ce n’est pas bien Laura. Il faut laisser les hommes payer. Croyez-moi.
Elle sourit. Nous nous levons. Traversons la boîte vide. Je la suis. Elle remonte les marches en colimaçon. Ses longues jambes accrochent mon regard.
Le videur n’est plus là.
C’est normal, la boîte est vide…
03 :00
Dehors l’air est plus frais. Nous marchons en silence. Je lui offre mon bras, elle le prend. Bientôt nous foulons le sable. Le phare infatigable ensemence encore la nuit de son rayon lumineux. Le ciel est étoilé et la lune, presque pleine, éclaire l’océan de ses rayons argentés. Les vagues nous accompagnent et rythment nos pas. L’air est doux. Respirer devient peu à peu un plaisir sublime. Elle finit par rompre le silence :
— Quelle étrange soirée, j’ai l’impression d’être sur une autre planète… J’aime tellement la mer. S’il existe un paradis, il ne peut que ressembler à cette plage.
— Vous n’avez pas froid ?
— Un peu…
J’enlève ma veste et la pose sur ses épaules.
— Et vous, vous allez attraper la mort.
— Ne vous inquiétez pas, la mort, j’en fais mon affaire.
— Pourquoi ne m’avez-vous pas embrassée tout à l’heure ? N’importe quel homme à votre place aurait sauté sur l’occasion.
— J’ai eu peur.
— Peur ?
— Oui, peur, de mal vous embrasser. Peur de tout gâcher. Peur de mourir de plaisir aussi…
Elle s’arrête et s’assoit sur le sable. Je m’assois près d’elle. Nous regardons l’infini de l’océan, comme deux enfants.
— C’est magique, souffle-t-elle.
Elle respire profondément en fermant les yeux pour mieux goûter l’instant. Elle fume sa cigarette. Puis elle s’allonge complètement sur le sable.
— Paul, vous avez dormi sur le sable en m’attendant ?
— J’ai compté les étoiles jusqu’au petit jour…
— Je pense que personne ne m’a attendu aussi longtemps.
Je pose mon coude sur le sable et tiens ma tête sur la paume de ma main. Je suis tout près d’elle, allongé moi aussi. On est bien. J’observe son visage. Les contours de ses yeux. Ses lèvres retroussées. Son menton a la ligne pure. Sa peau si jeune. Je crois voir Simona. En plus triste. Il y a des ombres derrière ce regard, il faudra que j’aille les voir. Du bout des doigts, je caresse sa joue. Laura ferme les yeux. Elle sourit à peine. Du bout de l’index, j’effleure sa bouche. Ses lèvres sont sanguines. J’approche mon visage et je l’embrasse très doucement. Sa bouche me répond. Je passe et repasse mes lèvres, caresse son nez, ses paupières. Puis je m’aventure dans son cou où je trouve un gisement de volupté et de tendresse. Je mange sa peau. Je frisonne.
Suis-je au paradis ? Il faudrait que le temps s’arrête.
Et il s’arrête.
Combien de temps, je ne saurais le dire.
Mais longtemps en tout cas.
IV.
Jeudi 4 septembre
« Chambre Froide »
06 :30
Aux premières lueurs de l’aurore, j’ouvre les yeux. Laura dort contre moi. L’image de son visage a changé. Il émet une lumière douce, irréelle. Il est paisible, rayonnant des lumières pourpres de l’aurore. Je ne pense pas qu’il existe une chose aussi belle dans ce monde que cet instant. Je flashe ma mémoire pour ne jamais l’oublier.
Elle ouvre les yeux. Elle sort doucement du sommeil. A ce stade du réveil, l’expression de son regard ne peut que refléter la vérité de ses pensées. Elle me sourit. Je l’embrasse doucement.
— Bonjour, lui dis-je.
— Paul.
Elle passe sa main sur mon visage et m’attire à elle pour un nouveau baiser. Ma barbe est drue.
Soudain elle s’avise.
— Il faut que j’aille travailler !
— Tu as le temps.
— Tu n’as pas froid ? s’inquiète-t-elle.
— Un peu, maintenant que tu le dis…
— Viens, je t’offre un bon café et des croissants.
Nous nous levons. Je suis moins courbaturé qu’hier. Nous marchons dans le sable en titubant, ivres d’un bonheur nouveau qui vient tout juste de naître et à qui on apprend à marcher. L’un contre l’autre.
Au dessus de l’océan, l’aurore explose de mille rayons.
Dans le silence, nos ombres mesurent des kilomètres, sur le sable blanc.
07 :00
Quelques minutes plus tard, nous sommes attablés dans une brasserie. Laura a de petits yeux. Nous ressentons comme une ivresse. Moi, j’appelle ça :
« Les petits matins blêmes ».
C’est un moment magique, quand, après une nuit blanche, le jour se lève. Nous baignons dans une brume qui embellit tout, dans la lumière pourpre de l’aurore. Un peu comme dans ces photos floues de David Hamilton. Cela me fait penser au « Purple Haze » de Jimmy Hendrix. Ces brumes violettes qui m’ont bercées jadis. J’ai l’impression de revivre mon adolescence.
Devant nous, deux grands cafés fument. Les croissants sont chauds. Laura mord à belles dents dans le sien. C’est un matin comme je les aime. Bien que, je ne sais pas pourquoi, je sens que ce serait encore plus beau si nous étions en hiver.
Elle me prend la main droite. Et la caresse.
— Il te manque un doigt, remarque-t-elle.
— Juste une phalange de l’index, j’ai eu un accident quand j’étais gosse. J’ai une prothèse. Ça ne t’effraie pas ?
— Non pas du tout. Paul, je n’ai pas envie d’aller travailler… soupire-t-elle.
— Comme je te comprends. La journée va être longue.
— Ce n’est pas tellement la fatigue. C’est de passer la journée sans toi.
— C’est gentil.
— Je pourrais te rejoindre pendant ma pause.
— Je vais tuer le temps. Je vais écrire en t’attendant.
Le café chaud nous fait du bien. Le café est une des plus belles inventions de la nature. L’arôme délicieux, le goût délicat, la sensation d’excitation qu’il procure. C’est peut être le meilleur café de ma vie que je bois avec elle. Je profite de cet instant. Peu à peu nous reprenons contact avec la réalité. Il faut y aller. Nous retournons au parking où la Twingo nous attend. Laura démarre en trombe.
Je ne brusque rien, je me laisse porter. Cette première nuit restera dans mes souvenirs, marquée d’un caillou blanc. Le soleil brille là-haut dans le ciel. Il est déjà 8 heures.
Laura pénètre sur le parking de l’hôtel, elle se gare sur une place libre.
— Il ne faut pas qu’on nous voie ensemble.
Elle coupe le contact et se tourne vers moi.
— Merci pour cette belle nuit. J’ai retrouvé le goût d’une sorte de bonheur que j’avais un peu oublié.
Elle se coule contre moi. Je la serre fort.
— Je dois y aller, Paul.
— Ok… Je serai là tout près de toi…
— Descends le premier…
Nous nous embrassons une dernière fois. J’ouvre la portière et je descends de la Twingo. J’écoute le silence. La voie est libre. Je lui fais un dernier petit signe de la main et entre dans le hall de l’hôtel.
Elle me manque déjà…
Il n’y a encore personne à la réception. Je regagne ma chambre sans être vu. J’ai une petite appréhension en ouvrant ma porte. Doriac est-il venu régler ses comptes ? Non, tout est en ordre. Ce serait un bien grand risque pour lui, de violer l’intimité d’un client de l’hôtel. Les photos que je possède peuvent le faire tomber plus bas qu’il n’est, s’il se montre agressif.
Je m’assois sur le lit. Je suis fourbu. Mais j’ai ce que je voulais. Comme aux échecs. Le prochain coup sera sur mon terrain, dans ce lit. Il faut que je justifie le fait que je veuille rester dans la chambre 109, après ce que j’ai dit à Laura cette nuit. Logiquement, elle devrait faire le nécessaire pour me changer de chambre. N’importe quel client normalement constitué ne trouverait pas le sommeil dans une chambre, sur un lit, où a eu lieu un crime. Je ne veux pas dire par là que je ne suis pas normalement constitué, entendons-nous bien… Si je reste dans cette chambre, je risque d’éveiller les soupçons de Laura. A moins que je fasse un double de la clé. Et que je change de chambre. Vu l’occupation de l’hôtel il n’y aura personne dans la 109 avant que je parte. Je pourrai y revenir quand je veux. Je peux même rendre la chambre inutilisable en détériorant la plomberie de la salle de bain, en créant une fuite compliquée à réparer.
J’examine la baignoire. Il y a une plaque dans le carrelage du coffrage, sur le coté. Elle bouge. Je l’enlève. Sous la baignoire, il y a du gravier et la tuyauterie. Je prends une table à repasser que j’ai repérée dans une armoire. J’enfonce un pied de la table dans la bonde de la baignoire, le trou où s’écoule l’eau. Et je tape un coup sec pour désolidariser le tuyau de la baignoire et provoquer une fuite. Au troisième coup je sens le tuyau qui cède. Je range la table et remets la plaque à sa place.
Je téléphone au standard :
— Allo ?
— Allo, monsieur Montebourg, que puis-je pour vous ?
— Hum, je crois qu’il y a une fuite dans ma baignoire, j’aimerais changer de chambre si c’est possible ?
— Une fuite, je vais vous envoyer quelqu’un. Pour la chambre je vais voir ce que je peux faire.
— Merci.
Je raccroche.
Soudain, je ressens un léger vertige. C’est la fatigue. Je ferais mieux de m’allonger, ne serait-ce que pour mieux profiter de Laura tout à l’heure.
Je me laisse aller sur le lit.
Simona apparaît à coté de moi. Elle porte une nuisette blanche, très sexy, sur sa peau bronzée. Elle me regarde :
— Alors, elle-aussi tu vas la tuer ? La prendre dans tes bras de « Serial Killer » et lui manger le cœur ?
— Simona, je suis en vacances. Et je me sens si seul.
— Elle aussi, il faudra qu’elle soit consentante.
Je n’aime pas quand Simona est comme ça. Je suis un être humain normal. J’ai juste une religion différente. Des croyances différentes. Je crois qu’il n’y a rien après. Je ne supporte pas d’être malheureux. Le chagrin me fait faire des bêtises. Je baisse la garde. Et je me fais prendre comme un débutant. Ils attendent : la meute de chiens veut dévorer le loup. Le moindre faux pas et je tombe. Chaque jour est un exploit. Ma vie est une œuvre d’art, car je suis un professionnel qui n’a jamais été pris ou soupçonné. Malgré les caméras, les micros, les analyses ADN, les chiens, les meilleurs détectives, l’armée de flic à mes trousses, je suis toujours là. Le seul détective qui m’ait démasqué, par accident, ne peut le répéter à personne, car il n’a plus de bouche, plus de mains, plus de tête. Il n’est plus rien. Je l’ai transformé en néant. Je l’ai « erasé » de la liste des vivants. Je crois que jamais un être humain n’a été coupé en autant de petits morceaux. Des morceaux… De la pâtée broyée fine qui a fait le bonheur des animaux du zoo de Bâle, en Suisse. J’aurais pu repeindre les murs avec. Je suis avant tout un loup qui a envie de mordre.
Je m’emporte :
— Tu es injuste, Simona. Tu es jalouse ?
— Non, Édouard, cela me parait incroyable, mais je ne suis pas jalouse.
— Non. Parce que nous ne sommes plus qu’un, personne ne peut nous séparer. Tu l’aimes comme moi. Tu as envie d’elle, comme moi. Et je vais te l’offrir sur un plateau.
Simona se couche sur moi. Nous nous embrassons follement. Je bande…
…Soudain elle disparaît, comme si elle était entrée en moi. Je reste là, sidéré. Je ferme les yeux. J’imagine Laura qui s’affaire en bas. Pense-t-elle à moi ? A-t-elle envie de moi ?
— Laura, j’ai envie de sentir ton souffle encore. Ton souffle chaud. Il est comme un oiseau que je tiens dans ma main…
Le soleil inonde le lit, je m’endors…
12 :30
Il est midi et demi à ma Rolex quand je me réveille. Je m’étire sur la terrasse. Mes pompes ! Je me mets à plat ventre sur la terrasse et hop ! Une, deux, trois… Je me sens un peu rouillé. Je m’arrête à vingt quatre.
Le soleil est au zénith, c’est l’heure du déjeuner. L’océan brille et m’éblouit. Je me souviens vaguement que, dans mon rêve de réveil, je faisais l’amour à Laura. Je vais pisser. En voyant mon jet d’urine tendu, je pense qu’il faudrait que je perde un peu de poids. Que je surveille mon cholestérol, mes transaminases. Mon foie. Ma surcharge pondérale.
Je me prépare et descends déjeuner. Une table au soleil m’est réservée dans la salle du restaurant. La voix de Laura sonne comme une musique :
— Nous avons, en plat du jour, des cœurs de canards sautés accompagnés d’une poêlée de cèpes en persillade et un cœur de laitue en salade.
— Cela fait beaucoup de cœurs ? Vous ne trouvez pas.
Laura me sourit.
— Il ne faudrait pas que cela vous écœure, plaisante-t-elle.
— Va pour les cœurs de canards. Je salive déjà. Mon cœur vous savez, il est pris. Mais que vais-je boire ?
Je regarde la carte. J’exulte :
— Vous avez du Léoville las Cases, 89.
— Oui, ce n’est pas le moins cher…
— Oui mais c’est le meilleur, Laura.
Elle sourit et disparaît. La salle est pleine. Laura est toute fraîche. Elle ne semble pas ressentir la fatigue de notre nuit blanche à la belle étoile. Elle rayonne, comme disait un ami qui travaillait dans une centrale nucléaire. Je suis de bonne humeur, je me fais rire tout seul. Je ne remarque pas tout de suite un jeune homme qui déjeune à deux tables de moi et qui ne me quitte pas du regard. Lorsque nos regards se croisent, j’ai immédiatement un voyant rouge qui s’allume. Instantanément, mon cerveau sécrète une chimie puissante, car il sait que je vais le solliciter et lui demander d’être au top de sa puissance. Mes cortex A et B ont l’habitude. Ce gars a un regard qui me dit qu’il sait quelque chose. Je sens des ondes terribles tourner autour de lui.
Laura dépose sur ma table un joli plat en cuivre étamé sur une petite chauffeuse. Elle enlève le couvercle. Les cœurs de canards frémissent encore dans un jus qui a l’air délicieux. Le parfum des cèpes aillés et persillés emplit mes narines. Je jouis en salivant. C’est probablement la chose la plus évoluée de l’univers que j’ai devant moi. J’en suis convaincu. Quand je pense aux milliards d’années qu’il a fallut au monde pour qu’il se constitue. Ces milliards d’étoiles, d’explosion de plasma, de soupes primitives en ébullition, sans oublier l’énergie et la matière noire. L’évolution et le hasard qui ont fait disparaître les dinosaures pour qu’apparaissent enfin l’homme avec un grand « H » et le canard avec un grand « C ». Et cette course folle pendant des millions d’années, qui voit le canard rester sur ses pattes palmées pendant que l’homme se redresse fièrement sur son cul. L’homme qui finit par élever le canard et par le gaver. Le canard qui comprend qu’il doit développer son foie, ses magrets, ses abats, en affiner le goût, la tendresse, pour satisfaire les muqueuses buccales et nasales de son prédateur. Je jouis aujourd’hui d’être cet homme qui mange des cœurs de canards, sous les étoiles, alors qu’il s’en est fallu d’un cheveu pour que ce ne soit le canard qui, assis confortablement à cette table, ne soit en train de se lécher ses pattes palmées en dégustant le mien.
— Merci, ça a l’air tout simplement délicieux.
Elle me répond par un sourire. Je mets ma serviette autour du cou. Et attaque les cœurs. Quand je porte à ma bouche le verre de Léoville et que d’une gorgée, j’inonde mes papilles, je tombe dans un puits de plaisir oral complexe. Une sorte de vertige qui me fait tourner de l’œil. C’est tout simplement divin.
Mais cela ne me fait pas oublier ce regard qui épie mes moindres gestes. Le gars finit par se rendre compte qu’il est grillé. Il se lève de table et se dirige vers moi. Il m’accoste :
— Monsieur Paul Montebourg ?
— C’est moi.
Ses jeans, ses baskets, son tee-shirt, ses cheveux gras en disent long sur la galère qu’est sa vie. Ce type n’a qu’une idée en tête : survivre. Mais apparemment, il ne sait absolument pas comment s’y prendre.
— Je me présente, je suis Daniel Desprat, journaliste à Sud-ouest. Je suis passionné de romans policiers. Excusez moi, je vous importune, vous êtes à table…
— Oh, ça oui… Vous m’importunez, jeune homme. Je suis effectivement à table. On se connaît ?
— Non, mais j’ai absolument besoin de vous parler. J’ai des révélations à vous faire.
— Quoi des révélations ? Des révélations sur quoi ?
Je m’énerve un peu. Il s’approche de moi et chuchote :
— Des révélations sur Albert le Dingue.
Incroyable, ce jeune coq veut m’apprendre des choses, à moi.
— Albert le Dingue… C’est dingue, dis-je effaré.
— Peut-être que vous allez écrire un autre tome de votre livre? Je peux m’asseoir ?
— Je vous en prie.
— Je savais que j’allais vous intéresser. Figurez-vous que j’enquête sur la mort d’un parrain local qui a explosé dans sa villa avant hier.
Je ne tressaille pas.
— J’ai lu ça dans le journal. Il n’en restait pas grand-chose…
— Son nom ne vous dira rien, il s’appelle Henri Lacaze. Il est plus connu dans le milieu sous le nom de Riton L’Élégant. Il tenait un restaurant dans le coin autrefois.
— Et quel est le rapport avec ce cher Albert ?
— Ils se connaissaient.
— Et alors ? Je suppose qu’un tueur aussi raffiné qu’Albert le Dingue a des relations dans tout le milieu de la pègre de province. Mais qu’est ce qui vous permet de dire que ce Riton connaissait Albert ?
— Parce que Riton me l’a dit.
— Il vous l’a dit ? Je croyais qu’il était mort.
Là, je sais que je l’énerve.
— Il est mort bien sûr. Je l’ai interviewé dans le cadre d’affaires locales, lorsqu’il avait encore son restaurant. Il n’était pas très bavard, il m’a quand même donné quelques détails sur la personnalité d’Albert le Dingue.
— Des détails ? Tiens donc…
Le jeune homme se penche vers moi et parle plus doucement, sur le ton de la confidence :
— C’est un monstre sanguinaire, froid comme un serpent, sans cœur et sans états d’âme. Il m’a même affirmé qu’il mangeait le cœur de ses victimes.
— Non ! Vous vous n’avez pas lu mon livre !
Il ne se décontenance pas :
— Comme il me donnait ces précisions, je lui ai demandé s’il connaissait personnellement Albert. « Et comment que je le connais, m’as-t-il répondu, il vient manger ici toutes les semaines ».
— Ici ? dis-je en fronçant les sourcils.
Je l’énerve…
— Non, dans l’ancien restaurant de Riton…
— Ah…
— Votre livre n’était pas encore paru à l’époque. Vous n’avez pas peur qu’il se venge de ce que vous racontez ?
Nous y voilà… l’interview de trop. Ce monsieur Daniel Desprat devient gênant, il prêche le faux pour connaître le vrai, il colporte des ragots qu’on a entendus mille fois et il insulte Riton…
— Cher ami, si je suis ici incognito, c’est en partie pour ma sécurité. C’est pour cela que je ne veux pas ébruiter ma présence. Vous comprenez que je ne réponde pas à la presse.
— Je comprends. Mais oublions la presse. Ce n’est pas vous qui m’intéressez, c’est Albert le Dingue ! Il va y avoir l’enterrement de Riton, samedi matin, au cimetière Talouchet à Bayonne. Et je suis sûr qu’il sera là.
Il me fait un clin d’œil…
— Qu’est-ce qui vous fait penser ça ?
— Vous connaissez les truands comme moi. Il y a des choses sacrées entre eux. Un respect. Ces gens là vont aux enterrements de leurs collègues, ce n’est pas comme dans la presse. Je paris qu’ils seront tous là.
— Écoutez, jeune homme, ce que vous racontez m’intéresse. Mais je ne souhaite pas en parler ici. Si vous voulez que nous continuions cette conversation, je vous donne rendez-vous vers dix sept heures. Disons, sur la plage, près du blockhaus, vous voyez ? Ce sera plus discret…
— Très bien.
— Maintenant, je vais terminer ces cœurs de canard avant qu’ils ne refroidissent. Vous permettez ?
— A tout à l’heure.
Il a l’air satisfait. Il se lève et quitte la salle.
17 heures, c’est l’heure où Laura reprend son service. J’aurai deux petites heures pour m’occuper de lui, avant le dîner. Il faudra qu’il me raconte tout ce qu’il sait. Ce type ne me plait pas.
Je sauce, avec un morceau de pain, la dernière goutte de jus de canard dans mon assiette et je déguste l’ail rôti, confit dans sa gousse. C’est délicieux. Je bois la dernière goutte de Léoville las Cases 89. L’ivresse légère que je ressens est d’une qualité exceptionnelle. Un habile mélange de bonheur, de perspicacité et de joie, légèrement tinté d’une cruauté jouissive, à la manière d’un très long « retour en bouche ».
Je me lève, Laura est occupée en cuisine. Je quitte la salle et monte dans ma chambre. Il fait très chaud.
14 :30
Tout est en ordre. Dans la salle de bain, je me fais une toilette, je me brosse les dents, vigoureusement, je me rase sans me couper, au rasoir à main. Je passe un after-shave sur ma peau en feu, j’aime cette sensation de brûlure. Je pisse. Puis, sur le balcon, je récupère le sac en plastic qui contient le Nikon. Je le range dans ma valise. Je vérifie mon courrier électronique sur l’ordinateur portable. Rien à signaler. En passant, j’efface le mail que m’avait envoyé Riton et je lance un petit programme qui broie les données et les détruit définitivement sur le disque dur. On n’est jamais trop prudent. Puis, comme je dois quitter la chambre, je pousse le lit afin de récupérer ma sacoche, je pourrais bien en avoir besoin. A quatre pattes, je défais la latte du plancher qui correspond aux rangées 17-15, la mort du Roi Soleil. La précieuse sacoche est là, je la glisse dans ma valise et remets le tout en place.
Il fait très lourd. Sur la terrasse, le soleil darde des rayons chauffés à blanc. Quelqu’un frappe à la porte. Il est quatorze heures quarante. Je vais ouvrir : c’est Laura. Elle n’est pas seule, il y a Georgette et son chariot avec elle.
— Monsieur Montebourg. Vous avez demandé de changer de chambre. Nous vous donnons la 110 qui est une suite juste à côté. Si vous voulez bien, Georgette va procéder au transfert de vos affaires.
— Merci, dis-je, un peu surpris du ton très professionnel de Laura.
Elles entrent et procèdent à mon déménagement. En quelques minutes toutes mes affaires sont enlevées. J’ai bien fait de récupérer mon matériel. La suite 110 est beaucoup plus spacieuse que la 109. La décoration est quasiment identique. Georgette range consciencieusement mes affaires dans l’armoire, Laura s’occupe de la salle de bain. Une grande baie vitrée donne sur la terrasse qui est beaucoup plus grande elle aussi. Il y a une chaise longue au soleil, une table en bois et un joli Parasol rouge marqué Coca-Cola.
— Vous allez être bien mieux ici pour écrire, me souffle Georgette, qui tape sur mes oreillers du plat de la main pour leur donner une belle forme.
Au loin, l’océan semble moins pacifique que ces jours derniers.
— C’est drapeau rouge, dis-je en regardant vers la plage.
— Oui, c’est orageux. Les baignades sont interdites, précise Georgette.
Laura me regarde à la dérobée. Elle s’adresse à sa collègue :
— Georgette, vous pouvez y aller, je vais terminer.
— Tu es sûre ? Bon… Au revoir, monsieur Paul.
— Merci, Georgette.
Elle sort, plutôt satisfaite d’aller enfin en pause. Je ferme la porte à clé sans faire de bruit car je sais que Georgette a l’ouïe fine. J’ai gardé la clé de la chambre 109.
Aussitôt, Laura me saute dans les bras. Nous nous embrassons. On roule sur le lit. Sa fraîcheur et son parfum me grisent. Elle est heureuse. Ses lèvres sont souples, lubrifiées par son brillant à lèvre parfumé à la framboise. Elle mange goulûment ma bouche. Je sens des effluves de sensations transmises par le contact de nos bouches.
Je suis persuadé qu’un jour, un grand savant, qui aura pour ça le prix Nobel, démontrera que le baiser n’est pas qu’une simple caresse destinée à émouvoir les amants, mais est une véritable connexion entre deux êtres. A la manière d’une prise USB ou firewire d’ordinateur. Et qu’il transite par ce contact, des milliards de tera-octets d’informations techniques entre les deux organismes. Des négociations de protocoles pour vérifier la compatibilité des organes, par exemple. Des vérifications généalogiques sur plusieurs générations de manière à anticiper les problèmes de consanguinité. S’il y a problème de consanguinité, un warning sera envoyé et les corps essaieront de se raisonner : il se pourrait que deux cousins qui s’embrassent se mettent à avoir une haleine pestilentielle, j’ai des souvenirs qui vont dans ce sens… On n’a jamais fait d’études sérieuses sur ce sujet. Les muqueuses sont un énorme champ d’investigation scientifique, car elles ont, non seulement, une fonction de simple connectique, mais aussi une fonction de capteur érogène. Sans elles pas de sexe : des bouches et des vagins sans lèvres, des glands impossible à décalotter, des anus comme des trous d’oreilles et des seins ronds sans tétons… A ce sujet, il est surprenant de constater que la nature n’a pas été très généreuse en quantité de surfaces érogènes. Elle aurait pu en mettre un peu partout sur le corps, de manière à démultiplier les plaisirs érotiques. Voire même à en couvrir le corps entier… Je me demande si à la place de la peau on peut greffer des muqueuses, sans risque de rejet ? A mon avis les rejets ne pourraient atteindre que les « culs bénis ». Je me vois bien, sur la fin de mes jours, terminer ma vie, greffé de la tête aux pieds, couvert de muqueuses suintant en permanence, au moindre frémissement, au moindre contact, dans des gémissements de jouissance jubilatoires.
Il faudrait pour cela rebaptiser les mouroirs, les appeler les « Jubiloirs » par exemple :
— Papy on va t’emmener au jubiloir !
— Hein ? Quoi ?
— On va t’opérer et après tu vas prendre ton pied…
A ce propos, quid des gastéropodes ou des mollusques ? Ils sont bien entièrement couverts de muqueuses. Ressentent-ils la même chose que nous ? N’est ce pas pour cela que la nature les a asexués ? Ils dégoulinaient tout le temps de bave et gémissaient…
Et les trilobites ?
Je délire pendant que Laura m’embrasse follement… Passe sa langue dans ma bouche. Elle rit et prend son pied.
Mais ce n’est qu’un jeu, dès que je passe une main sur ses fesses, je sens une esquive coquine. Nous finissons par nous calmer. Elle se love contre moi.
— Paul, je suis bien, souffle-t-elle.
Je passe mes doigts dans ses cheveux doux et parfumés. Quelques minutes plus tard, elle dort profondément. Avec les nuits blanches qu’elle a passées, ce n’est pas étonnant. Je ne bouge pas, pour ne pas la réveiller. Je profite de ce moment, je respire son parfum, caresse ses cheveux. Bien sûr, j’ai envie d’elle, et je sens quelqu’un qui pousse dans mon pantalon. Mais je ne tente rien. Je me laisse aller…
— Laura tu es si tendre. J’ai envie de te protéger. Te sentir toujours là, près de moi.
Je m’endors à mon tour…
Après un certain temps de cette sieste coquine, je sens Laura qui se réveille. Elle est probablement serrée dans ses vêtements de travail. Je fais semblant de dormir. Elle enlève son tablier, sa jupe, son collant et termine en petite culotte. Puis elle se glisse sous le drap et en position fœtale, replonge dans le sommeil. Doucement, comme un serpent, je me glisse à mon tour sous le drap. Quelques minutes plus tard c’est une Laura toute chaude et toute fine, à moitié nue, qui se colle à moi. J’entrevois un bout de paradis… Elle se rendort.
A 17 heures pile, elle me réveille.
— Paul, je dois aller travailler.
Elle m’embrasse encore. Je passe mes mains sur son dos musclé, caresse sa taille fine, ses hanches. Elle n’esquive pas. Grimpe sur moi. Ma main s’aventure sur ses petites fesses. Elle est bouillante. Elle m’embrasse de plus belle. Je caresse de « moites enclos » à travers le fin nylon. Nos cœurs se mettent à battre la chamade. Soudain elle sursaute.
— Je dois y aller, Paul.
Son visage exprime le regret. Elle s’assoit sur le bord du lit et se rhabille. Ce que je vois de son corps à moitié nu, de ses petits seins, est plus que ravissant. Elle est sublime. Une fois habillée, elle me jette un baiser sur sa main, s’enferme quelques secondes dans la salle de bain. Je l’entends faire pipi avec le bruit chuintant, caractéristique que font les filles. Elle tire la chasse d’eau et s’échappe en riant.
17 :15
Je me retrouve seul dans mon grand lit. Je respire ma main. Son parfum est là, élixir sublime rempli de sortilèges. Phéromone divine. Substance hallucinogène. Je lèche mes doigts comme une chatte. J’ai envie d’elle…
Je reprends peu à peu mes esprits. Il est 5 heures passées. Je pense à mon journaliste qui m’attend près du blockhaus. Dehors la chaleur atteint son paroxysme. Un orage se prépare.
Je me lève. Ouvre la valise et sort ma sacoche. Les lames sont là, étincelantes. Je prends « le Saigneur des Couteaux », le couteau à désosser, je le glisse dans ma ceinture sous ma chemise. Il ne faut pas que je laisse la sacoche ici.
Je sors dans le couloir avec la sacoche, il n’y a personne. J’ouvre la porte de la chambre 109. Je pousse le lit, enlève la latte du plancher et glisse dans le trou la précieuse sacoche. Je remets la latte en place.
Puis je sors de la chambre, donne un tour de clé. Je descends. Je traverse la terrasse vide. Une bourrasque se prépare, le personnel s’affaire à rentrer les nappes, les parasols et les chaises longues. Personne ne me voit. Je descends vers la plage. Le vent souffle, mes cheveux volent. Et ma chemise flotte comme un drapeau. L’orage gronde. La mer est démontée. Je marche dans le sable vers le blockhaus. Soudain je reconnais la silhouette du journaliste, il est exact au rendez-vous. Je lui fais un signe, à son tour, il me reconnaît et s’avance ver moi.
— Ça va souffler, me hurle-t-il, une tornade se prépare.
— Une tornade, vous croyez, c’est un petit grain. Comme ça nous ne serons pas dérangés…
Soudain, un éclair fulgurant strie le ciel de part en part. Au dessus de l’océan, les nuages sont verts foncé. En quelques secondes la nuit est tombée. Il pleut d’énormes gouttes chaudes.
— C’est l’Apocalypse.
Je hurle pour qu’il m’entende.
Le vent redouble de violence. Nous courons sur le sable vers le blockhaus. Lorsque nous nous engouffrons dans l’entrée étroite de l’immense cube de béton, c’est un véritable déluge, nous sommes trempés de la tête aux pieds. Nos visages ruissèlent.
Dans le blockhaus, nous assistons à l’apocalypse. Nous ne pouvons pas parler.
Je vais profiter de cet environnement favorable pour régler un problème délicat. Ce jeune journaliste représente un danger mortel. Il est assis sur le bord de l’ouverture du blockhaus et semble fasciné par le spectacle de l’apocalypse. Le vent souffle en rafale, l’orage éclate comme des tirs de mortiers, c’est la guerre. Je ramasse une grosse pierre sur le sol du blockhaus. Je sens le saigneur dans ma ceinture, je sais qu’il ne va pas me trahir. Je vois la tête ronde du journaliste devant moi. Il me tourne le dos. La pierre fait un bon poids dans ma main, il ne va pas souffrir. Je n’ai pas le choix. Je suis « l’ange exterminateur ». Je lève la pierre et d’un geste précis, en même temps qu’un coup de tonnerre phénoménal, je lui fracasse le crâne. Il pousse un cri terrible, étouffé. Je le sens qui s’affaisse. Ses forces le lâchent instantanément. Sans perdre de temps, je pousse le corps hors du blockhaus. Je saute à mon tour sur le sable. Je suis pris dans un tourbillon de vent et de pluie hallucinant. Mais je réunis mes forces, saisis les pieds du cadavre et le tire vers la plage. J’ai besoin de toute mon énergie pour lutter contre le vent. Je sens enfin les vagues près de moi, elles se mélangent à la pluie. J’ai bien fait vingt mètres. Les éclairs éclatent partout. Je sors mon couteau à désosser de ma ceinture et, plaqué sur le sol pour ne pas que la tornade m’emporte, j’empoigne les cheveux, je tranche la gorge à la base du cou, en espérant que le cœur batte encore. Le terrible couteau pénètre la chair comme dans du beurre. Tel un puits de pétrole, le sang gicle au rythme du cœur :
« Tchac, tchac… »
Je n’ai plus qu’à attendre qu’il se vide complètement. Je reste là sans bouger. Le déluge nettoie tout, l’eau est rouge autour de moi. Mais je sais qu’à la fin de la tornade, il n’y aura plus une goutte de sang visible sur la plage.
Dix minutes plus tard, l’hémorragie s’arrête peu à peu. Les vagues sont maintenant sur nous, c’est marée montante. La tornade redouble de violence. Je me relève et tire le corps vers le blockhaus. J’utilise toutes mes forces et le hisse par l’entrée étroite puis je l’allonge sur le sol en béton. Sans perdre de temps, je le déshabille complètement et fouille ses poches : elles sont vides. Je roule le pantalon et le tee-shirt en boule avec les baskets. J’entreprends de le débiter. Le geste sûr, je coupe, je tranche, je désosse. L’orage explose toujours, il pleut des hallebardes, mais je n’entends plus rien tant je suis concentré.
Je revois toutes ces années de travail. Dès cinq heures le matin, je mettais le tablier blanc immaculé jeté sur l’épaule et enroulé, serré, autour de la taille. Je buvais mon verre de sang frais avec les autres, pour prendre les forces nécessaires à la lourde tâche qui m’attendait. Les livreurs déchargeaient des bœufs entiers, encore chauds, venus de l’abattoir proche. Et là, commençait l’aiguisage des outils : le métal du fusil qui mordait les lames :
« Zip, zap, zip, zap… »
Puis sur le billot propre, les couteaux parlaient. La corne bien serrée dans nos poings solides et velus, le saigneur faisait son travail. Peu à peu, la bête devenait « boucherie ». Nous pouvions débiter comme cela des tonnes de viandes par semaine. Dans le silence du ronron des chambres frigorifiques.
Je revois mon père, ficeler les rosbifs à une allure surnaturelle. La perfection du maillage de la ficelle faisait l’admiration des apprentis dont je faisais partie.
Jusqu’au jour où le carnage nous a submergé. Le matin funeste quand, j’avais dix sept ans, je trouvais mon père éventré dans le laboratoire. Les problèmes d’argent, la faillite, la concurrence déloyale des machines à débiter et des grandes surfaces l’avaient poussé à l’acte extrême, mais si simple, de déplacer la lame du saigneur de quelque centimètres vers l’intérieur, afin qu’elle morde sa propre chair. Il s’était littéralement éventré. Ma mère, qui n’a pas supporté le drame, l’a suivi quelques jours après ; elle s’est pendue. Tout cela me semble irréel, pourtant c’est la vérité. Il faut dire qu’en ce temps-là, ces choses étaient relativement banales. Il n’était pas rare de trouver un pendu dans la cabane au fond du jardin. J’ai appris peu après qu’il se savait condamné par un cancer. Condamné, décidément la langue française est cruelle. Être « con » et être « damné », n’est ce pas être condamné.
De cette époque, j’ai gardé cette envie de mordre et ce froid intérieur qui me fait hurler la nuit.
Deux heures plus tard, dans la pénombre, le journaliste Daniel Desprat est débité, en filet, cube, rôti, côtelette. J’ai même désossé sa tête. Rien ne laisse supposer que cet étalage de viande fut journaliste d’investigation. A coté, un tas d’os parfaitement nettoyés me fait penser qu’il y a un chenil à l’écart, dans l’enceinte de l’hôtel. Il n’était pas épais, le journalisme ne nourrit plus son homme. Le respect se perd…
Néanmoins, je suis fier de mon travail…
19 :30
La tornade s’est calmée. Je prends les vêtements du mort, ses baskets. Je remets le couteau à désosser dans ma ceinture et sors du blockhaus. La plage est déserte. Personne ne viendra ici ce soir.
Je vais laver mes vêtements et les siens, dans l’océan. Je roule ses baskets dans le tee-shirt et les jeans. Puis je rentre à l’hôtel. Je remonte vers la terrasse. Les dégâts semblent importants. Il n’y a plus d’électricité. Il y a d’autres touristes sinistrés, trempés, agglutinés dans le hall. L’effervescence règne. On s’éclaire à la bougie. J’aperçois Laura qui s’affaire, mais elle ne me voit pas.
Georgette est appuyée à la porte des cuisines, elle récupère de ses émotions. Je l’accoste :
— Georgette, vous n’auriez pas quelques sacs poubelle à me donner, des gros si possible, mes affaires baignent dans l’eau.
— Mais si bien sûr, monsieur Paul, quelle catastrophe, vous avez vu, même le toit de l’hôtel a bougé !
— Ah bon ! dis-je effaré.
J’entre dans les cuisines avec elle, un groupe électrogène ronronne, les congélateurs marchent. Une lampe tempête accrochée au plafond éclaire d’une lumière blafarde la grande pièce. Je repère les lieux, la chambre froide à l’air tout à fait convenable. Elle me tend un rouleau de sacs avec lies jaunes, de 50 litres. C’est formidable, ce sont ceux que j’utilise d’habitude.
— Merci madame Georgette.
— Oh, mais il n’y a pas de quoi, monsieur Paul. Tenez prenez aussi des bougies, je ne sais pas quand ils vont remettre l’électricité.
— Oh, merci. Que ferais-je sans vous ?
— Mais de rien…
Je sors de la cuisine et monte discrètement dans ma chambre, à tâtons, par l’escalier. A mi-chemin, j’allume une bougie. Le dîner de ce soir semble compromis.
La baie vitrée est grande ouverte. Le vent a arraché les rideaux, le sol est trempé, l’eau s’est infiltrée dans le parquet. Il y règne un désordre indescriptible. Dans la salle de bain, les carreaux de vitres sont cassés. Sur la terrasse, il n’y a plus rien, tout s’est envolé.
Je bourre un sac poubelle des vêtements et des baskets du journaliste. Je noue les lies. Je sors dans le couloir, ouvre la porte de la chambre 109. Ici, tout est en ordre. La fenêtre a tenu. Je défais la latte de parquet et glisse le paquet de vêtements dans le trou, à côté de la sacoche. Je remets tout en place. Puis je reviens dans la chambre 110.
Je me change et enfile des vêtements secs. Je récupère une lampe électrique dans ma valise que je glisse dans ma ceinture à coté du couteau. Je cache le rouleau de sacs plastiques sous mon pull-over. Je suis paré pour terminer mon travail.
Je descends au rez-de-chaussée en tenant ma bougie. La confusion règne parmi les clients de l’hôtel. L’électricité n’est toujours pas revenue. Je dois profiter de cette aubaine. Je pose la bougie. Je m’éclipse discrètement et descends vers la plage en prenant soin de ne pas être vu. Je retourne au blockhaus en m’éclairant de la torche que j’ai enroulée dans mon mouchoir afin d’atténuer la lumière au minimum pour ne pas être repéré. Autour de moi c’est la nuit noire, le vent souffle encore en rafale, la mer est particulièrement démontée. Dans le blockhaus, j’ai divisé les morceaux du cadavre en trois tas : les ossements non reconnaissables, les déchets trop humains (doigts, visage, cheveux, crâne), et la viande consommable qui ressemble à du veau de boucherie. Je remplis trois sacs poubelles de chaque tas, en prenant soin de ne rien laisser dans le blockhaus, la marée montante se chargera de nettoyer le sol. Je prends deux sacs : les ossements et les déchets reconnaissables. Courbé, je les porte sur mes épaules en marchant dans le sable. C’est très pénible. Le vent me déstabilise. Je remonte vers l’hôtel. Et me dirige vers le chenil qui est un peu à l’écart du bâtiment. Il y a trois chiens loups captifs et personne dans les parages, les bêtes aboient, mais les roulements de l’océan et du vent couvrent leurs jappements. Je m’approche. Je leur jette des morceaux de déchets reconnaissables, un par un. A chaque jet, ils se battent, celui qui l’emporte avale avidement les morceaux. En pratiquant de la sorte, je suis sûr qu’il ne restera pas un gramme de journaliste oublié dans le chenil. Je jette les bouts de mains, de visage.
Je fouille les environs et trouve un billot qui sert à couper le bois. Il y a toujours une hache à proximité d’un billot. Je fouille, il y a une cabane. J’aperçois soudain une hache dans le faisceau de ma torche. Je m’empare de l’outil. Je sors la tête de mort du sac plastique et la pose sur le billot. Je lève la hache le plus haut possible et assène un coup terrible. Deux morceaux volent, je l’ai coupée en deux, net, comme une pomme. On est vraiment peu de chose. Le crâne est parfaitement obsolète à l’ère du téflon, notre cervelle est en perpétuel danger dans un truc pareil. Je répète l’opération, ce coup-ci c’est comme du beurre. Enfin je jette les quatre morceaux aux chiens qui n’en font qu’une bouchée. En quelques minutes, il n’y a plus rien. Je trouve un tuyau d’arrosage vissé à un robinet. Je tourne le robinet. Un jet d’eau jaillit. Je saisis le tuyau et nettoie consciencieusement la hache, le billot, le sac plastique et toutes les taches que je trouve. Une fois certain que tout est propre, je range la hache et remets les choses en place comme elles étaient. Je roule le sac vide sous mon pull et récupère le sac chargé d’ossements. Je retourne vers l’hôtel, côté cuisine. Là où sont entreposées les poubelles. Je trouve le container des déchets alimentaires. Il est presque aussi haut que moi. J’ouvre le couvercle, c’est une infection. Je vide mon sac d’ossements. Les tibias et les vertèbres du journaliste ne dépareillent pas avec les carcasses de crustacés pourris, les pattes de canards, les épluchures de pommes de terre, les déchets des assiettes de clients trop bien nourris et les myriades de mouche vertes qui vibrent et pondent des asticots affamés. J’y jette également les deux sacs poubelles. Tout ça partira dans un camion broyeur à la décharge où l’incinérateur finira le travail.
Reste le dernier sac que je me réserve pour la « faim ».
Je retourne sur la plage, au blockhaus. La marée monte, les vagues lèchent déjà le béton du blockhaus. Je me dépêche. Je récupère le sac sur mon dos et remonte vers l’hôtel. Je vais bien dormir ce soir. C’est un bon petit entraînement que je fais là. C’est important de ne pas perdre la main, même pendant les vacances.
J’arrive dans le hall. L’électricité n’est toujours pas revenue. Des bougies éclairent le bar et la salle de restaurant. J’aperçois Laura qui s’affaire dans la salle. Je pose le sac de viande dans un coin discret, où personne ne le remarquera. Je m’approche. Elle prépare des sandwiches qu’elle distribue aux clients sinistrés.
— Laura ?
— Vous voilà ? J’ai eu peur pour vous.
— Je suis là, tout va bien. Ma chambre est dans un état…
Je me glisse près d’elle, les gens font la queue et attendent leur tour comme dans un self service.
— Vous voulez un sandwich, nous avons du foie gras, des rillettes de canard.
— Du foie gras, c’est parfait.
Elle glisse une énorme tranche de foie gras dans un morceau de pain.
— Il y a du vin blanc là.
Je prends un verre de vin blanc sur la table.
— C’est parfait. Merci Laura.
Je vais m’asseoir un peu plus loin sur une chaise et mords avidement dans mon sandwich. Quand j’aperçois une poivrière sur une table. Je ne peux résister, je m’empare de la poivrière et tourne cinq ou six tours de moulin sur mon foie gras. Je le préfère quand il est bien relevé… Du coin de l’œil je surveille mon sac poubelle posé près de l’entrée. Il est en sécurité. Cette tornade m’a donné faim.
Je mastique encore la dernière bouchée de mon sandwich quand je décide d’aller faire un tour vers les cuisines avec mon sac poubelle. Personne. Sans électricité les cuisines modernes sont comme des Cadillacs en panne sèche dans le désert. Il y a là des couteaux de bonne facture, de la ficelle. Je cache mon sac dans la chambre froide.
Soudain, Georgette me tombe dessus.
— Oh, mon pauvre monsieur, vous avez vu votre chambre… Je n’ai pas eu le temps de fermer la baie vitrée. Je vais vous déménager, la 109 vous conviendrait ?
Retour à la case départ…
— Écoutez si c’est possible, j’aime autant dormir dans un lit sec, va pour la 109.
— Je vais faire le déménagement, vous changerez votre clé à la réception.
— Merci, Georgette.
Je retourne au salon. Je m’installe dans un fauteuil club du bar et je m’allume un cigare que j’ai pris discrètement dans la boîte à cigare. Laura me sert un whisky. Je ressens la fatigue de cette journée. J’attends, peu a peu, tout se calme autour de moi. Laura range les victuailles puis elle s’approche :
— Exceptionnellement on m’a donné une chambre. Ma cabane a volé en éclat…
— Moi, on m’a remis à la 109, la 110 est complètement trempée.
— Je crois que je vais aller dormir ce soir, Paul, je suis très fatiguée.
— Bon…
— Vous n’êtes pas trop déçu ?
— Un petit peu, mais je comprends…
Elle me sourit.
— Bonne nuit, demain je suis de congé. Je serai toute à toi… me chuchote telle.
— Bonne nuit.
Elle s’échappe. Je ris un peu jaune. J’étais persuadé que nous allions dormir ensemble ce soir. C’est la faute à cette tornade et à ce journaliste. Peu à peu le bar se vide. Bientôt l’hôtel est silencieux. Je reste seul dans l’obscurité. Il n’y a pas de veilleur de nuit ce soir. L’hôtel est fermé.
Je ressens une sorte de tristesse dans mon ventre.
01 :00
J’entre silencieusement dans la cuisine où la lampe tempête est restée allumée. Je me mets un tablier de cuisine que je trouve sur un buffet. J’ouvre la chambre froide, malgré moi, je frissonne de plaisir. Je prends mon gros sac poubelle et de longues tranches de barde roulées dans du papier gaufré que je trouve sur une étagère. Je pause un gros morceau d’épaule sur le billot. Je saisis mon couteau à désosser à ma ceinture. Avec le fusil que je trouve sur le billot, je l’aiguise consciencieusement :
« Zip, zap, zip, zap… »
Puis je tranche la viande tendre. Dehors le groupe électrogène ronronne.
Je prépare quelques rôtis que je ficelle dans de la barde.
Puis je tranche des escalopes dans un long filet bien tendre. Enfin je coupe en gros dés les morceaux de troisième catégorie pour faire un sauté. Et ainsi de suite, toute la viande journalistique termine en étalage de boucherie, je n’ai pas perdu la main, c’est du très beau travail. On va se régaler demain.
Je range mes viandes parfaitement préparées : une partie dans un congélateur qui contient déjà des rôtis et des côtes de bœufs et l’autre partie dans la chambre froide près des steaks et des entrecôtes. Je fais en sorte que le chef ne remarque pas un arrivage qui serait démesuré. Il pourrait téléphoner à son boucher pour lui rendre la marchandise. Je me lave les mains et mon couteau avec du savon de Marseille. Je jette le sac poubelle et nettoie le billot de travail. Tout est parfait. Dans l’office, j’ouvre un tiroir qui contient une dizaine de clés, ce sont les clés des femmes de chambre, elles sont toutes identiques. Ce sont des passe-partout. J’en pique une, on ne sait jamais, on n’a jamais trop de clés.
Je peux monter me coucher. Dans la chambre 109, Georgette a délicatement rangé mes affaires. Elle a posé sur la table de nuit le colis de Riton comme s’il s’agissait d’une chose importante et précieuse.
Je range le saigneur sur l’armoire. Il ne faudrait pas que Laura trouve cet objet, cela pourrait lui mettre la puce à l’oreille.
Je me déshabille et me couche.
J’ouvre le livre et lis à la lueur de la bougie :
« Albert le Dingue et les femmes.
Bla bla bla… »
Je rêve…
« Comme Adolf Hitler, il aime voir les femmes déféquer sur lui. »
Il a dû coucher avec Hitler le Montebourg.
« L’anus est le centre de son problème. »
L’anus ! Le centre de mon problème, mais que vient faire mon cul dans tout ça ?
« Psychologie, Albert se masturbait. »
Évidemment que je me masturbe, pauvre imbécile, et heureusement…
« Albert a été violé »
La seule fois ou j’ai été violet, c’est quand j’ai retenu ma respiration pendant trois minutes pour battre mon record…
« Albert aimait trop sa mère. »
Mais, on n’aime jamais trop sa mère, ses parents… Ce mec est fou !
« Albert s’est coupé la première phalange de l’index droits en la passant dans un hachoir à viande.…»
Mais comment a-t-il pu savoir ça ?
Je n’aime pas ce racisme qui consiste à me diaboliser. Les droits de l’homme sont pour TOUT le monde, pourquoi en serais-je exclu ? J’ai quelques défauts, mais jamais personne ne pourra dire de moi que je suis un raciste. Je le jure : j’ai tué autant de juifs, que de nazis, que d’arabes, que de blancs, que de noirs. Et je témoigne : ils ont tous la même odeur pestilentielle quand on les débite.
J’ai peut-être été parfois un peu plus cruel avec les catholiques. Mais c’est pour des raisons personnelles qui n’ont rien à voir avec le racisme. Je voulais leur faire avouer des trucs. Sur ce putain de « Da Vinci Code » et toutes les conneries qu’on y raconte. Ça n’a rien à voir avec le racisme.
Je suis en colère, voila…
Je souffle la bougie.
Demain il fera jour…
V.
Vendredi 5 septembre
« Les Griffes du Mal »
09 :00
J’ouvre un œil… Pas de room service ce matin. Pas de nouvelles de Laura. Elle doit faire une grasse matinée méritée. J’essaie d’évaluer les heures de sommeil qui lui manquent depuis le début de la saison. A ce rythme, cette petite va s’abîmer très vite. Je me souviens de la vie que je menais à son âge, ce n’était pas de tout repos non plus. Je me levais à cinq heures et ne me couchais jamais avant minuit. Dix heures par jour dans la boucherie. Le samedi j’allais au bal, je rentrais au petit jour et buvais mon verre de sang, comme un élixir de jouvence, qui gommait instantanément les traces de fatigue. Je me rappelle les après-midi, quand mes oreilles bourdonnaient et que ma tête éclatait d’épuisement. Je ne me retournais jamais sur les heures passées, tellement la douleur était insupportable. Je me disais que, bientôt, je récupérerais, par une grasse matinée salvatrice que je n’ai jamais faite…
J’ouvre la baie vitrée. Un flot de lumière envahit la chambre. Il pleut. La grisaille a envahi l’horizon. Je me sens gris moi aussi. Je n’ai même pas envie de faire mes pompes. J’ai besoin d’un bon café bien chaud. Je m’habille et descend prendre mon petit déjeuner en salle. Je me sens pâteux. L’hôtel a retrouvé un semblant de propreté après la tornade d’hier. Je m’assois à ma table habituelle.
Le journal parle de la « tornade catastrophique », les photos sont éloquentes. Plusieurs bateaux de marins ont disparu en mer.
Georgette fait le service.
— Monsieur a bien dormi ?
— Oh oui. Ce sera un double express et une orange pressée. Vous êtes au service aujourd’hui, Georgette ?
— Oui, ma collègue est de congé, mais demain c’est mon tour…
Elle a l’air fatiguée, Georgette. Dehors la pluie ruisselle. Il fait de plus en plus gris. La chaleur qui règne dans la salle de restaurant est réconfortante. Les vieux clients ont sorti les pulls en laine. Il ne reste plus que des retraités à l’hôtel. Georgette pose une cafetière fumante et une orange pressée sur ma table. L’odeur du café me réconforte immédiatement. Je lance des regards vers l’entrée, je m’attends à voir Laura à chaque instant. Elle me manque. Je me rends compte que je suis devenu addict. Cela ne me plait guère et va compliquer ma vie. Je dois me désintoxiquer de cette fille, si je ne veux pas faire un voyage en enfer.
Je déjeune, seul. Puis je vais faire un tour dehors. Mine de rien je me promène vers l’arrière des cuisines. Tout semble normal. Je m’approche de l’endroit où sont rangées les poubelles de l’hôtel. Elles ont été vidées, les camions de la déchetterie municipale ont tout ramassé. C’est ce que je voulais voir. Rassuré, je rentre dans le hall et remonte dans ma chambre par les escaliers. Je trouve un pli qui a été glissé sous ma porte. Je me baisse pour le ramasser. Je rentre, je me sens fébrile, comme un adolescent qui reçoit son premier billet doux. Je décachette :
« Paul, je ne suis pas sûre de moi. De mes sentiments envers toi. J’ai envie de te voir, mais je ne veux pas souffrir. Je serai peut-être à l’hôtel vers 15 heures. Je suis à la chambre 204, provisoirement, vu que la tornade a dévasté ma chambre.
Laura.»
Sommes-nous jamais sûrs de nos sentiments ? Cette tornade et ce journaliste ont pris mon attention hier et cela a suffi pour que Laura glisse entre mes doigts. C’est insupportable. Quinze heures. J’ouvre une boîte de Xanax et avale deux pilules. Elle a une belle écriture, régulière et arrondie, avec quelques jolies terminaisons de mots, très graphiques. Je ne vois pas la trace de cette force obscure qui semble l’habiter parfois.
— Tu n’as rien compris à cette fille.
C’est Simona qui est apparue. Elle est allongée dans le lit, nue sous le drap.
— Qu’est-ce qui te fait dire ça, Simona ?
— Elle t’a caché qu’elle avait un amant et celui-ci revient à la charge.
— Hum.
C’est fort possible. Auquel cas, je suis échec et mat. C’est étrange, mais je n’arrive pas à y croire.
— Elle subit peut-être un chantage comme l’autre soir. Le Maître d’hôtel est peut-être revenu, dis-je sans conviction.
— Tu ferais mieux de t’occuper de moi.
Simona fait glisser le drap sur le sol, elle est complètement nue. Elle m’offre son corps sans pudeur. Je m’approche et m’assois sur le lit près d’elle.
— Tu as sûrement raison. Je deviens dingue…
— Tu as bien travaillé hier. La manière dont tu as fait disparaître ce journaliste est un cas d’école. C’est dommage qu’il n’y ait pas d’université pour tueurs, tu aurais fait un excellent enseignant.
— Mais il y a des universités où on apprend à tuer, c’est dans les écoles de police. J’y ai pensé pour mes vieux jours.
Je ris de bon cœur…
Simona passe sa main sur ma cuisse. Et la pose sur mon membre. Je la regarde. Elle est malicieuse et délicieuse.
— Heureusement que je t’ai, Simona. Sans toi je serais déjà mort.
Elle penche son visage sur mon ventre et défait mon pantalon. Lorsque je ressens sa caresse, je tombe en arrière sur le lit. Je regarde le plafond. Je jouis. De subtiles sensations secouent mon corps et créent une cascade de plaisir dans mon ventre. L’animal qui est en moi se réveille peu à peu. Je deviens loup. Je fonce à une vitesse folle dans des paysages sensoriels. Je tombe parfois à la limite du vertige éjaculatoire. Mes yeux se révulsent. Je redresse le manche et comme un Messerschmitt en 40, je fais une vrille dans le ciel étoilé, en lâchant dans la nuit un fumigène lumineux multicolore. Je me crache sur une île paradisiaque du Pacifique Sud. Les ukulélés s’énervent, le ventre des vahinés frétille, leur peau brille au soleil. Elles sont enduites de monoï, elles me jettent des pétales de fleurs tiaré. Leur corps suinte de plaisir. Je m’échappe. Je taille la brousse avec ma serpe. Je me fraie un passage dans la toundra.
Pendant ce temps je vois Simona qui avale entièrement mon sexe (je ne veux pas dire par là que j’ai un petit sexe, disons qu’elle a une grande bouche). Mes yeux se révulsent.
Là, devant moi ! Un tigre du Bengale. Énorme. Fantastique. Génial. J’épaule mon fusil. Je le vise. L’animal me regarde et grogne dangereusement. Du bout de l’index j’appuie lentement sur la gâchette. J’arrête de respirer…
C’est insoutenable…
— Ahhh…
— Quoi ? hurle-t-elle.
— Stop, Simona, faut que je garde mes cartouches !
— Quoi, que tu gardes tes cartouches ?
— Simona je suis désolé.
Furieuse elle disparaît.
Je remets mon pantalon qui est tombé à mes genoux. Je me sens piteux.
Je dois garder mes cartouches pour Laura…
12 :15
Le déjeuner est plus triste que d’habitude sans Laura, mais 15 heures approche… Pourvu que je la voie.
Georgette se tient près de ma table en souriant, j’ai la cote…
— Aujourd’hui en plat du jour, nous avons des côtes charcutières. Avec de la purée de pomme de terre maison.
— Je pourrai faire un trou et mettre du jus dans la purée ?
— Mais certainement, je vous amène une saucière de jus. Vous allez vous régaler, c’est ce que j’ai mangé tout à l’heure, la viande est délicieuse.
— Je n’en doute pas…
D’autant qu’il n’a pas subit de stress, pas d’interrogatoire musclé, pas de séquestration prolongée. Les conditions idéales. Autour de moi, deux couples de retraités américains semblent se régaler malgré la grisaille du temps dehors.
Georgette apparaît avec un plateau dans les mains. Elle pose une assiette fumante devant moi :
— Attention, c’est liquide, monsieur Paul, ne vous brûlez pas…
— Je vais faire attention.
— Et pour boire, avec ça ? demande-t-elle.
— Avec ça, Georgette, vous allez me servir un Chasse spleen 96. J’ai vu que vous en aviez sur la carte.
Je déplie ma serviette, je salive comme un chien de Pavlov. Je prends une cuillérée et je fais comme une petite fontaine dans la purée. Je prends la saucière et je verse quelques gouttes de sauce dans ma fontaine. C’est très joli et très bon, je fais ça depuis que je suis tout petit, dès qu’on me sert de la purée.
Je coupe un morceau de viande, elle est très tendre. La sauce charcutière a l’air parfaite. Les cornichons sont hachés comme je les aime. Je goutte. Je mâche. Mes papilles réagissent. Je viens d’ouvrir une vanne de plaisir. Un véritable fleuve coule en moi. Je tourne presque de l’œil. Le tigre du Bengale est couché, il fait semblant de dormir, en fait, il fait la gueule. Je l’emmerde…
J’ai tout mangé, je sauce la dernière goutte, la dernière trace dans mon assiette. Je bois ma dernière gorgée de Chasse spleen. Je me sens beaucoup mieux.
Je bois un café italien. Et déguste le chocolat noir qui l’accompagne.
J’ai éjaculé dans mon pantalon. J’en suis gêné.
Il me reste deux heures à tuer. Charles André Rubens se lève de sa table et s’approche de la mienne.
— Monsieur Montebourg, faites nous le plaisir de vous joindre à nous pour le café. Un siège vous attend à notre table.
— C’est que…
— Ma femme serait tellement heureuse.
— Bien. Je vous rejoins tout de suite.
Il s’éloigne. Je ferme ma veste pour cacher une éventuelle tâche sur mon pantalon. Je me lève de table et me dirige vers celle des Rubens.
— Madame.
Je me courbe un peu pour lui signifier mon salut. Elle me fait signe de m’asseoir d’un geste très élégant. Je m’exécute. Elle est ravissante. C’est une vraie bombe anatomique.
— Alors votre livre, monsieur Paul ?
Je remarque son décolleté qui laisse entrevoir un terrible précipice.
— J’écris dix pages par jour. J’ai atteint ma vitesse de croisière, et le vent souffle dans la bonne direction.
— Comme vous avez le sens de l’image : le vent souffle… J’adore les polars, l’odeur des cadavres littéraires m’enivre. Vous pratiquez des autopsies, j’espère.
Elle m’excite. Georgette apporte les cafés. Elle pose le plateau sur la table. Fernanda Rubens lui prend la main.
— Vous direz au chef que sa viande est délicieuse. Elle fond dans la bouche, je n’en n’ai jamais mangé d’aussi bonne. C’était du veau n’est-ce pas ?
Georgette bredouille :
— Euh, je ne sais pas, je vais lui demander, mais je pense que c’était du porc.
J’imagine la viande fondre dans la bouche de Fernanda. Son visage de blonde pulpeuse, sa bouche, tout son corps semble fait pour les plaisir de la chair. Elle aiguise mon appétit sexuel. Elle me regarde :
— Du porc ? Non, c’est au moins un petit veau élevé sous la mère… Qu’en pensez-vous, Monsieur Paul ?
— Vous savez, Fernanda, on fait des miracles aujourd’hui avec la sélection génétique. C’était une viande exceptionnelle, dévorée par une femme exceptionnelle. C’est tout ce que je peux vous dire.
Elle me jette un regard de chatte. Nos regards s’accrochent pendant que Charles André nous rejoint et reprend sa place à côté de Fernanda.
— Charles André, éclairez-nous, avons nous mangé du porc ou de veau ? A votre avis ? Monsieur Paul penche pour du porc.
— Écoutez, ma chère, il suffit de regarder la carte. Ou de demander au chef.
Je commence à trouver que la fixation de Fernanda sur la nature de la viande prend une tournure dangereuse. Il faut que je mette fin à cette conversation :
— Fernanda, croyez moi, l’origine de la viande importe peu, c’est tout simplement un animal qui n’était pas stressé, qui a été abattu par surprise.
— Ah voila l’explication, Monsieur Paul a tout à fait raison, argumente Charles André, le stress est l’ennemi de l’organisme. Les animaux stressés par de la maltraitance sécrètent des acides et des substances qui sont de véritables poisons.
— Ah le stress, c’est le mal du siècle, chante Fernanda, on voit que vous n’êtes pas stressé, vous, Monsieur Paul.
— Vous savez, chère amie, mon remède contre le stress, c’est le travail, rien que le travail.
— Mais il faut vous détendre de temps en temps, mon pauvre ami…
— Le travail ! D’ailleurs, il faut que j’y aille, mon roman m’attend.
Fernanda me jette un regard désespéré :
— Déjà ?
Je me lève et les salue en claquant des talons.
— Le travail, madame…
Je m’éloigne, j’entends Charles André qui chuchote dans mon dos :
— Il me plaît, ce garçon…
Pendant que Fernanda soupire.
14 :00
Je monte dans ma chambre. Je me lave et me change. J’ai un besoin irrépressible de voir Laura. J’allume l’ordinateur portable. Je regarde ses photos prises dans la chambre du Maître d’hôtel. Sur l’écran, j’analyse et je scrute. Je zoome sur sa peau. Je ne sais pas ce que je cherche. Une trace, une preuve, une évidence, une explication. J’ausculte son corps comme un médecin légiste. Je repère ses grains de beauté. Pas de tatouages. Juste les oreilles percées. Ses jambes et son bassin sont merveilleusement dessinés, son corps est une harmonie, un piège à regard, qui inspire immédiatement une érection, une fascination, une jouissance. La courbure de ses fesses est un puits où je tomberais volontiers. Le désir est partout, sur sa bouche, dans ses yeux, ses seins tendus, ses cuisses, son ventre. Je me rends compte à quel point je suis voyeur, la vision est presque plus forte que le toucher. La sensation du toucher est plus animale. J’apprécie la moiteur, la transpiration, la palpation, la pollution des muqueuses…
La vue est complètement différente : c’est le rêve, l’esthétique qui peut aller jusqu’au sublime. Comme si l’image du cul, le galbe des hanches étaient une lame qui inciserait le réservoir qui contient un concentré de plaisir comprimé, près de la glande qui le fabrique, un peu comme la bile et le foie. Il suffit que l’œil se promène sur ces formes magiques pour que cette vanne s’ouvre, ce ballon se crève et le plaisir se diffuse comme un venin dans l’organisme, provoquant le coït. Parfois j’arrive à tromper mon cerveau, quand j’imagine, quand je projette, ces formes métapsychiques sur l’écran de mes nuits blanches, comme le chantait si bien Monsieur Claude…
Ce mystère que j’appelle « Le Mystère du Trou du Cul », je l’explique en partie par le fait que la Nature a placé judicieusement le cul derrière l’individu, j’insiste sur le mot « derrière ». Ainsi tout le monde peut le regarder, sauf l’intéressé qui le possède. C’est diabolique, génial et terriblement efficace : je ne peux pas voir mon cul, et je ne sais absolument pas quel impact il peut avoir sur mon entourage. C’est quand j’ai le dos tourné que les regards s’accrochent immédiatement à ses formes. Et que la magie s’opère, ou pas… à mon insu.
Je peux affirmer sans sourciller que je suis capable de dresser un portrait psychologique très précis d’un individu rien qu’en voyant ses fesses, si possible en mouvement, quand l’individu marche dans la rue, par exemple. Il y a les fesses coincées, serrées, les fesses relaxées, les petits culs imbus d’eux mêmes, les fesses généreuses, les concaves, les convexes, qu’on vexe d’ailleurs très facilement… Les culs rabotés, les culs désynchronisés, les culs gélatineux. Et puis il y a le cul impeccable, le cul parfait, dont la fermeté est à point, dont le mouvement oscillatoire met en valeur le sourire des joues. Qu’il soit compressé dans un jean, à l’aise dans un kilt, ficelé dans un string, le cul parfait fait toujours de l’effet.
Je change de logiciel. Laura ne va pas tarder. Je relis son message, posé sur le bureau.
« Paul, je ne suis pas sûre de moi, etc.…»
Peut-être va-t-elle m’annoncer qu’elle ne veut pas poursuivre notre idylle. Elle ne veut pas souffrir, mais elle a envie de me voir, les femmes sont toutes les mêmes. Je dois me préparer au pire. Il ne faut pas que nous restions dans la chambre 109, cette histoire de crime doit la terroriser. Il faut que je l’emmène ailleurs, que je lui fasse vivre un moment exceptionnel.
Je me fais couler une douche. J’enduis mon corps de mousse au monoï et me savonne vigoureusement. Ça réveille, c’est tonique. Je me rince. Mon corps se reflète dans un miroir sur la porte de la salle de bain. Je suis plutôt bien membré. Et pas si mal foutu que ça. Je bande mes muscles. Pas mal non plus. J’ai de beaux restes…
Je m’habille, j’enfile un caleçon bleu pâle, un pantalon noir et une belle chemise blanche. Chaussettes en fil, chaussures en croco. Je brosse mes dents. Je me rase et me parfume légèrement de Fahrenheit. J’ai l’impression d’être dans une jungle entouré de singes. Je glisse mes Ray Ban dans ma poche. En quelques minutes, je suis un nouvel homme.
Je me tomberais facilement dans les bras…
Je délire, comme tout les latin lover dans leur salle de bain.
16 :00
Quelqu’un frappe à la porte. Mon cœur se met à battre.
J’ouvre.
— Laura ? Je t’attendais.
Elle entre sans rien dire. Elle a deux grands yeux fatigués. Elle porte un joli haut rose qui laisse voir son nombril et une jupe courte en jean, très sexy.
— J’étais inquiet.
— Je te demande pardon, souffle-t-elle.
— Assied-toi. J’étais en train d’écrire, dis-je en montrant l’ordinateur portable allumé. J’ai trouvé ton mot…
— Déchire-le…
Elle regarde par le balcon le ciel tourmenté.
— Tu dois te sentir à l’aise avec moi, Laura, je ne veux en rien compliquer ta vie. J’aimerais seulement t’apporter mon amitié et enlever ces vilains nuages qui passent parfois dans tes yeux. Je me rends compte que je tiens beaucoup à toi.
— Je sais.
— Je t’ai préparé les photos de Doriac. Elles sont là. Si tu veux, je peux effacer les cartes mémoires. A moins que tu veuilles les voir ?
— Juste pour me rendre compte…
Je prends une carte mémoire et l’introduit dans le lecteur. La première photo du groom apparaît. Elle s’assoit devant l’ordinateur.
— Je te préviens c’est plutôt « hard ». Tiens, prends la souris. On clique là, pour faire défiler les photos.
Laura prend la souris, elle manipule l’ordinateur comme une experte. Les photos défilent lentement sur l’écran. C’est vrai qu’il est mignon le groom. Il semble parfaitement consentant, il prend même son pied. Les images deviennent scatos, gros plans sur les parties génitales, pénétration. Laura ne moufte pas. Son regard est magnétisé par l’écran. Elle s’attarde parfois sur un détail, une expression. Arrivée à la dernière photo, elle décroche son regard.
— Il l’a fait… murmure-t-elle.
— Ça pour le faire, il l’a fait. Dis-je.
— Jean Christophe est homo. Il n’était jamais passé à l’acte. Mais il en rêvait.
— Il aurait pu mieux choisir son partenaire. Tu ne crois pas ?
— Est-ce qu’on choisit son partenaire ?
Elle a raison, c’est l’occasion qui fait le larron. Elle ne m’a pas choisi, c’est clair.
— Non, bien sûr. Mais il aurait pu mettre une capote.
— C’est pour ça qu’il est mort de trouille.
Elle introduit l’autre carte mémoire. Les photos défilent plus rapidement.
Laura en a assez vu, elle interrompt le diaporama.
— Quelle horreur, j’ai honte. Il faut effacer tout ça…
— Vas-y, tu sais comment faire.
Laura clique, en quelques secondes les photos sont effacées. Elle éteint l’ordinateur.
J’ose une question :
— Laura, ça te dirait de changer d’air ?
Elle me regarde un peu surprise, mais ne semble pas choquée par l’idée.
— Je connais un endroit très chic, pas très loin d’ici, au bord de la mer…
Elle me regarde un peu médusée.
— Trois quarts d’heure de voiture. A 18 heures, on prend l’apéro aux Colonnes. Puis on se promène sur la jetée, ensuite on sable le Champagne dans notre suite de l’Hôtel du Palais. La suite Édouard VII, ou la suite Alphonse XIII. On va dormir dans le lit où ont dormi Victor Hugo, Sacha Guitry, la reine Hortense, l’Impératrice Eugénie. Ça te tente ?
— Tu es fou…
— Non je ne suis pas fou, je suis un peu dingue peut-être, j’ai tout simplement besoin de décompresser moi aussi.
— Mais ça coûte une fortune.
— Bon, je réserve ?
Laura hausse les épaules. Elle me sourit. C’est gagné. Je décroche le téléphone et appelle l’hôtel du Palais à Biarritz. Quelques minutes plus tard, une suite est réservée.
— Je vais louer une voiture, ou appeler un taxi…
— Ce n’est pas la peine, j’ai toujours la Twingo, le copain qui me l’a prêtée à disparu.
— Disparu ?
Je tressaille, ce copain, ce ne serait pas mon journaliste au moins…
Elle rectifie :
— Il est parti quelques jours à Bordeaux avec sa femme, il ne m’a pas dit quand il rentrerait… Je suppose qu’il va passer le week-end là-bas.
Pourquoi Laura me mentirait-elle ? De toute manière elle connaît probablement ce journaliste, tout le monde se connaît ici.
— Bon, va pour la Twingo. Comme cela les responsabilités sont partagées, moi je m’occupe du couchage et toi tu t’occupes du transport.
Elle me sourit. Je la regarde. Elle tombe dans mes bras, je la serre contre moi et lui caresse doucement les cheveux.
— Pardon, Paul, murmure-t-elle. Je ne sais plus où j’habite.
Elle m’embrasse. Nos bouches se mangent. Je sens un frisson parcourir tout mon corps. Je la retrouve.
— Ne perdons pas de temps… Va te préparer.
Elle est tout sourire.
— A tout de suite. Je prends juste un pull.
Elle sort.
Je saisis mon sac, j’y range deux ou trois affaires de toilettes. J’embarque le Nikon, on fera quelques photos. J’hésite un instant, je regarde le haut de l’armoire. Un couteau ça peut toujours servir… Sur la pointe des pieds, je prends le saigneur sur l’armoire et le glisse au fond du sac.
Je mets ma veste, et jette un pull sur mes épaules. Dehors on dirait que la pluie a cessé.
L’horizon, sur la mer, laisse entrevoir quelques rubans bleus.
18 :00
Une demi heure plus tard, Laura conduit sur l’autoroute. Le ciel s’est encore éclairci, mais les essuie-glaces balaient le pare brise à cause des projections d’eau causées par les poids lourds qui nous précèdent. En quelques minutes nous sommes à Biarritz. On sent la fin de saison.
— J’ai amené l’appareil photo, j’aimerais te photographier. Tu as déjà posé pour un photographe ?
— Non, je veux dire, pas pour un vrai photographe.
J’ai l’impression d’avoir commis une bourde, je repense aux photos de Doriac. Je me rattrape :
— J’ai été photographe dans le temps, c’était mon premier métier. J’aurais continué si je n’avais pas été tenté par l’écriture. C’est très agréable de faire de belles images, d’exprimer la beauté des choses. De capturer la lumière. J’étais particulièrement doué pour capter la mélancolie des regards. Et l’ombre…
— Je ne sais pas si je suis un bon sujet…
— On va le voir de suite… Un sujet qui accroche la lumière, c’est magique et inexplicable, il y a des sujets magnifiques qui sont toujours moches en photos. C’est un talent rare. Il faut essayer pour voir.
Nous arrivons avenue de l’Impératrice, devant l’entrée de l’hôtel, un valet nous ouvre le portail électrique.
L’hôtel du Palais porte bien son nom. C’est un magnifique bâtiment. Nous roulons jusqu’au parking. Laura semble charmée par le luxe inouï qui nous entoure.
— Tu sais, Laura, tu ne dois pas te laisser impressionner par le luxe des grands hôtels. Ce ne sont que des lieux de passage, des petites parenthèses dans une vie. Il n’y a personne qui soit chez lui ici.
Nous occupons une suite royale qui n’usurpe pas son nom. Le lit est une œuvre d’art. Par le balcon, j’observe que les nuages se sont levés, au loin le ciel a pris une couleur rouge sang.
Laura s’appuie sur un fauteuil et regarde autour d’elle. Je la questionne :
— Alors ?
— C’est trop…
— Trop ? Je pense au contraire que ce n’est pas assez. Si je devais t’emmener dans un endroit à la mesure de ce que je ressens, Laura, celui-ci te paraîtrait ridicule.
Nous visitons la salle de bain, elle hallucine devant le jacuzzi.
— Je peux prendre un bain ? me crie-t-elle. Comment ça marche ?
— Tu allumes là, et ça va se mettre en marche tout seul.
J’ouvre les robinets. La baignoire se remplit. Nous continuons la visite. Les grandes fenêtres s’ouvrent sur l’océan d’un côté et sur les jardins de l’autre. Un salon attenant déploie ses fastes napoléoniens.
— Ouah, c’est magnifique, s’exclame-t-elle en caressant les objets du bout des doigts.
— C’est un peu pompeux, mais ça fait son effet.
Elle se tourne vers moi :
— Paul, merci !
Je la prends par la taille. Et lui sourit :
— C’est moi qui te remercie, dès la première seconde de notre rencontre, j’ai eu l’impression de renaître. J’ai retrouvé des sensations que j’avais oubliées. Grâce à toi je reprends confiance dans la vie. J’ai envie d’aller plus loin dans mon métier. Je me sens plein d’énergie. Je me sens redevenu un guerrier, un conquérant.
Elle rit et se colle contre moi. Je la prends dans mes bras :
— Tu es belle Laura, comme un vers de Baudelaire…
— Tu es fou.
— Je suis fou de toi.
On s’embrasse follement. Soudain, elle se reprend :
— Mon bain ?
Elle file dans la salle de bain, en quelques secondes, elle est nue et plonge dans l’eau bouillonnante.
— C’est génial, me hurle-t-elle.
Je m’étire de bonheur. J’en profite pour faire mes pompes sur le tapis.
Quelques minutes plus tard, c’est une Laura toute mouillée, emmitouflée dans une énorme robe de chambre blanche qui vient se vautrer sur le lit. Je me glisse près d’elle. Nous sommes tous les deux allongés sur les coussins. Le peignoir laisse entrevoir un peu de la chair de son ventre. Je l’embrasse.
Je fais un voyage sur son corps. Comme un aventurier, je parcours les milliers de kilomètres qui séparent son cou de son pubis. En repoussant l’éponge douce et parfumée du peignoir, je libère de l’oppresseur les vallées et les monts du magnifique paysage de son corps. Je conquiers des territoires, des nouveaux mondes où souffle un alizé plein de parfums hallucinogènes. Puis c’est la descente en parapente dans le voluptueux canyon. Je tombe. Le plaisir est comme un vertige. Une bombe de jouissance explose dans mon estomac. C’est la guerre, l’attaque. Elle écarte ses jambes et je plonge mes lèvres sur ses lèvres. J’embrasse avec la langue, je respire des parfums interdits. Son corps se tend comme une arbalète. Elle geint, elle râle. Je m’allonge sur elle. Je la pénètre.
— Stop. Paul !
Elle hâlette. Elle a saisit mes épaules, en proie à une frayeur soudaine.
— Paul, j’ai des capotes dans ma trousse de toilette.
— Mais bien sûr, tu as raison. Où ai-je la tête ?
— Si tu savais où tu avais la tête !
Nous rions. Elle saute hors du lit et court, nue, dans la salle de bain, elle revient aussitôt avec le petit sachet qu’elle ouvre avec ses dents. Elle se penche sur moi et retire mon pantalon. Je me retrouve bientôt nu comme un ver. Laura se met alors à me branler très lentement. Elle enfile la capote sur ma verge, avec sa bouche. J’hésite entre : tourner de l’œil, chanter une tyrolienne ou me convertir au chamanisme et entrer en lévitation transcendantale. La sensation est délicieuse. Enfin elle me monte dessus et, lentement, elle s’empale sur moi, comme un supplicié qui serait sorti d’une peinture d’El Gréco.
Le plaisir est presque douloureux. Elle est déjà au paradis. Nous faisons l’amour pour la première fois et c’est au-delà de notre imagination. Il n’y a plus de mots pour décrire ce que nous ressentons, il n’y a plus que des râles, des bruits de forges, des miaulements, des grognements rauques, des hurlements de loup. Il n’y a plus enfin que de sublimes mots grossiers :
— Salope !
— Oui !
— Chienne !
— Oh oui…
— Ah !
Puis vient le sommet tant convoité. La position du missionnaire. Les derniers mètres de l’escalade. Je ressemble à une foreuse pétrolifère en mouvement, je perce la nappe phréatique. Les violons vibrent dans les aiguës. La locomotive à vapeur s’emballe sur le chemin de fer. La fusée Apollo s’arrache du sol dans un fracas supersonique. Je transpire des cascades et des chutes niagaresques. Je meurs de mort violente. Enfin, je balance la purée. La petite mort me secoue. Je suis pris de spasmes. Suis-je dans l’au-delà ? Le canon crache. Je mitraille. Je vide mon chargeur…
Là… doucement, je respire. Mon cœur pompe deux coups dans le vide… Il a failli me lâcher. Laura dégouline. Je reprends peu à peu mon souffle.
Mon esprit erre comme un feu follet…
Le destin s’est accompli.
Comme je plains ces gens pour qui le passé était le bon temps. Les réactionnaires, qui ne voient autour d’eux que la dégénérescence, la mauvaise vie. Qui pensent que la jeunesse est pourrie. Que tout fout le camp.
Personnellement je me dis qu’on n’a jamais autant éjaculé que de nos jours. Je suis sûr que la quantité de foutre produite par l’homme civilisé s’est multipliée par dix ces vingt dernières années. L’état devrait faire des crédits d’impôts contre le don de sperme. Le sperme devrait être comme l’or ou le dollar. On devrait pouvoir spéculer sur lui. Le cours du sperme monterait inexorablement dans une spirale profitable. Les pauvres qui ont souvent de grosses couilles pourraient vendre quelques gouttes de la précieuse crème pour nourrir les bouches affamées de leur progéniture. On stockerait tout ça dans des containers empilés dans les coffres forts des banques. On pourrait presque imaginer des systèmes de paiements en liquide. Des trayeuses installées à coté des distributeurs de billets, sur les trottoirs, où déambuleraient les prostituées.
J’ai envie de tirer un coup, je me fait exciter par la pute, j’éjacule dans la trayeuse qui me renvoie une liasse billets dans le distributeur, que je partage avec la dame : ça marche… Ça c’est de l’entropie…
Bien sûr il y aura toujours des mauvaises langues pour cracher dans la soupe et dire que le sperme n’a pas le même goût qu’autrefois. A ceux là je dis : regardez la jeunesse, elle n’a jamais été aussi belle. Aussi rieuse, aussi insouciante. Les terrasses de bar prolifèrent. Preuve que la qualité du sperme est plutôt en progression.
Vraiment, qu’y a-t-il de plus précieux dans l’univers que notre semence, dans la mesure où la principale loi de la nature dans l’univers est : « Croître et multiplier ». Que fera-t-on de l’or ou des diamants le jour où l’humanité voudra passer aux choses sérieuses et ensemencer la galaxie.
Je pense que les vieux (ou les jeunes) réactionnaires le sont parce qu’ils ne savent plus séduire la jeunesse. Ils se croient supérieur et veulent imposer leur volonté au plus jeunes. De ce fait, ils deviennent obsolètes, dans le sens technologique du terme. Ils sont dépassés par une évolution qu’ils combattent de manière aveugle. Et ils se masturbent, tirent la chasse sur leur foutre, en refoulant des images obscènes dans la poubelle de leurs souvenirs. Alors qu’il leur suffirait de séduire une femme (ou un homme) dans la fleur de l’âge pour retrouver les merveilleuses sensations de l’amour primitif. L’obscénité deviendrait amour pur, puis santé, puis joie, puis générosité, puis famille et enfin patrie… La nation et le drapeau reprendraient tout leur sens. Et ils mourraient en chantant la Marseillaise, enveloppés dans un linceul tricolore.
Je m’égare…
Laura s’est endormie. La lumière descend doucement dans le soir pourpre. On entend les vagues au loin par la fenêtre grande ouverte. Et des cris d’oiseaux. Le beau temps est revenu. Et avec lui le bonheur.
Laura est sur le dos, les bras en croix. Sa chevelure coule sur l’oreiller. Elle n’a pas froid. Sa beauté est idéale. Elle n’a pas de gros seins. Mais leur courbe est parfaite à mon goût.
Je plains ces femmes qui cèdent aux sirènes de la chirurgie plastique. Moi qui ai l’âme d’un boucher, je devrais faire l’apologie du découpage, du scalpel, des greffes de peau. Pour les vieux, je ne suis pas contre, quitte à être moche autant être drôle. La fantaisie gérontologique ne me gène pas. Non, le carnage, c’est quand de jeunes femmes se font mettre des ballons en plastique dans les seins. Sous prétexte que les gros seins vont faire tomber les hommes comme des mouches. Cette vision américaine des mamelles me glace et, clairement, me fait débander. Pour ma part je préfère mille fois des petits seins ou même pas de seins du tout, à ces ballons grotesques qu’on voit sur la couverture des magazines pour hommes. La garçonne est encore bonne. C’est pareil pour les grosses bites, les monstres n’ont rien de bandant, si je puis dire. Une bonne petite queue, un gland qui se déchausse avec élégance, des couilles qui pendent, mais pas trop. Voila des friandises qu’on aime à l’heure du thé. Les dames me comprendront.
— J’ai une faim de loup, chuchote Laura.
— Moi aussi. Tu veux que j’appelle le room service, ou bien préfère-tu que nous sortions ?
— J’aimerais sortir.
— Que dirais-tu d’aller chez Camille ? Sur le Port des Pécheurs, manger un plateau de fruits de mer, des langoustines, des huîtres avec un vin blanc bien sec et bien frais ? C’est un ami.
— Tu me donnes faim. Allons-y.
Laura saute du lit. Et s’habille.
Je fais de même.
21 :00
Quelques minutes plus tard, nous marchons, bras dessus, bras dessous, sur le font de mer. Une légère brise souffle l’air du large. La mer clapote dans la lumière irréelle du soir. On se croirait dans une carte postale.
— Merci Paul. J’adore ces moments passés avec toi. Je voudrais tellement être digne de toi.
— Digne de moi ? Tu plaisantes, j’espère, c’est plutôt moi qui devrait m’interroger.
— C’était un peu comme la première fois, tout à l’heure.
— Souvent les premières fois ne sont pas les meilleures. Tu sais… Il faut apprendre à se connaître. Nous n’avons pas tous les mêmes sensations. Tu vois par exemple, moi je suis très chatouilleux, une chatouille involontaire au mauvais moment et c’est le naufrage, la débandade. Après il y a le côté virtuose du mâle qui joue du corps de la femme comme d’un stradivarius, mais ça c’est du marketing pour les zozos, les touristes, c’est de la littérature de gare.
— En tout cas, j’aime quand tu pinces mes cordes sensibles, dit-elle malicieusement.
— Le pizzicato, c’est très excitant, en effet.
Nous arrivons chez Camille où une table nous attend.
Il fait très bon. Il y a du monde. Camille me saute dessus. Il m’embrasse :
— Alors vielle canaille, t’es en vacances.
— Et oui, mon pote, faut bien refroidir la machine de temps en temps si on ne veut pas que la pendule s’arrête. Je te présente Laura mon amie.
Camille s’extasie :
— Vous êtes chez vous ici. Je vous ai préparé une table à l’écart, c’est la table des amoureux…
— Des amoureux ou des truands… je précise.
Il rit. Nous traversons la salle. Les fesses de Laura accrochent le regard des hommes attablés. Moi ils ne me regardent pas, visiblement ils me prennent pour son père. Nous nous assoyons confortablement. Camille apporte les cartes dont la lecture finit de nous affamer. Ce sera une soirée poisson :
Soupe et sa rouille.
Plateau de fruits de mer.
Un vin d’Irouléguy.
Du grand classique. Laura adore les fruits de mer. C’est bon d’être insouciant. Je lui prends les mains. Son visage est irréel, je n’arrive pas à croire que je ne rêve pas.
— Il est sympa ton ami Camille, murmure-t-elle.
— C’est un vieux routard, il a de la bouteille. Mais parlons de toi.
— Il n’y a pas grand-chose à raconter.
— Tes parents ?
Un voile traverse son regard.
— Je n’ai pas connu mon père et ma mère est morte. Je ne l’ai pas connue elle non plus.
— Tu es orpheline ?
— En quelque sorte. J’ai été élevée dans la famille de mon oncle. Il n’a pas d’enfant, sa femme est très gentille. Ils m’ont adoptée. Ils me traitent comme leur fille. Je ne peux pas dire que j’ai souffert.
— Je comprends.
Je nous sers une rasade de vin. Je goutte, il excite merveilleusement mes papilles.
— Moi, je n’ai plus de famille non plus depuis longtemps. Je n’ai pas eu d’enfants, avec mon métier c’est compliqué. J’ai eu quelques amours qui m’ont fracturé. Je ne voudrais pas te faire souffrir Laura.
— Pourtant, je crois que c’est parti pour…
— Qu’est-ce qui te fait dire ça…
— Tu repars dimanche. Moi je reste à l’hôtel à trimer. Je déteste cet hôtel.
Ses yeux se chargent soudain de larmes.
— Je n’en peux plus Paul. Je craque. Que va-t-il me rester ? Je ne peux pas pleurer en faisant le service.
De grosses larmes chaudes coulent sur ses joues.
— Je ne te laisserais pas, Laura. Je te le promets.
Je prends ses joues dans mes mains, j’approche mes lèvres et bois ses larmes.
— Ne pleure pas. Tu as ma parole. Je crois que c’est pareil pour moi. Je ne pourrai pas vivre loin de toi.
Elle renifle.
— Excuse-moi…
Elle se lève et se dirige vers les toilettes. Elle va se repoudrer.
Je reste songeur.
« C’est vrai que je suis un égoïste. Mais je ne te laisserai pas tomber. »
Elle revient quelques minutes plus tard. Son regard a changé. Ses yeux sont toujours rougis par les larmes. Elle renifle.
— C’est passé, excuse-moi.
Elle a un petit sourire forcé. Elle repasse encore ses doigts sur ses narines rougies. Je plonge mon regard dans son regard. Ses pupilles sont contractées. Je viens de comprendre que Laura est un papillon de nuit qui se poudre les ailes. Elle est allée renifler une ligne de coke aux toilettes ou je ne m’y connais pas. Mon cœur se met à battre. J’ai presque peur qu’elle l’entende. Car cela veut dire qu’il y a un dealer qui la tient, qu’il l’a programmée comme un robot pour qu’elle revienne toujours manger dans sa main. Je connais la chanson. Cette idée m’est insupportable. Cela représente un réel danger pour nous deux.
Le serveur pose une soupière fumante sur la table. Avec des croûtons aillés, du fromage râpé, un bol de rouille. Laura se frotte les mains.
Je lui souris :
— Bon appétit.
— Bon appétit, me répond-elle en souriant à son tour.
Le serveur a rempli nos verres de vin. On trinque en se regardant dans les yeux. Je sens que Laura va beaucoup mieux, le coup de spleen a disparu.
J’avale une cuillérée de soupe avec un croûton, je me régale.
Je n’en continue pas moins ma méditation. Je dois résoudre ce problème. Je veux la conserver près de moi, en exclusivité. Pour cela, dans un premier temps, je dois devenir son dealer et éliminer l’autre. Je suis attristé de savoir Laura dépendante. Et la colère monte en moi quand je pense à l’argent qu’elle gagne durement et qui finit dans la poche d’un marlot d’opérette.
Il y a des salauds partout. J’ai une idée…
— Je reviens, tout de suite.
Laura mange sa soupe. Je me lève et traverse la salle. Camille est derrière le bar. Il m’aperçoit. Je m’accoude. Il parle avec un client, un touriste anglais visiblement :
— Vous avez des chambres, s’il vous play?
Camille se frotte le crâne :
— A cette heure-ci. Il ne me reste plus que la chambre froide.
Le client interloqué sort… Camille m’aperçoit et éclate de rire :
— J’ai pas envie de louer à ce pingouin…
Puis il me souffle à l’oreille :
— Dis-moi, Albert, tu viens à l’enterrement de Riton demain ?
Il s’enfonce une allumette entre deux dents.
— J’y serai.
— C’est à dix heures au cimetière Talouchet. Pauvre Riton. Remarque il n’a pas souffert.
— Non, il n’a pas souffert. Par contre je serais curieux de savoir ce qu’on va enterrer demain, car il ne devait pas rester grand-chose.
— En tout cas c’est un beau geste qu’a fait celui qui l’a soulagé.
— Et comment… Dis-moi, Camille, tu pourrais me rendre un petit service ?
— Mais t’es couillon… bien sûr.
— J’ai la petite, là, c’est une gamine, tu sais comment ils sont à cet âge là ?
— Oh la la, ne m’en parle pas…
— Elle a besoin d’un peu d’inhalation, mais de la bonne, tu vois ?
— Ça peut attendre le dessert ?
— Bien sûr.
— J’ai ce qui te faut. De la bonne. Faut juste que j’envoie un garçon à côté.
— Merci, Camille.
— Allez va, régale-toi…
Il me tape sur l’épaule. C’est bon de pouvoir compter sur ses amis. Je rejoins Laura. Elle a fini sa soupe.
— Je me suis régalée, m’avoue-t-elle.
— Tant mieux, dis-je sur un ton jovial.
Le plateau de fruit de mer qui suit est consciencieusement décortiqué, sucé, avalé, léché, mastiqué. Nous nous en mettons partout. C’est un plat de paradis.
Les rinces doigts sont bienvenus. Nous sommes repus.
Camille s’approche.
— Je vous offre le café. Voici l’adition.
Il pose un petit panier en forme de raquette de pelote basque. Discrètement, j’ouvre le panier. Il y a un sachet d’au moins quatre cent gramme de poudre blanche. Et pas de note…
Je récupère discrètement le sachet. Je laisse quelques gros billets dans le panier en guise de pourboire. J’avale le café, Laura a l’air fatiguée. On rentre. Je remercie encore Camille de sa gentillesse.
Nous sortons. Il fait plus frais, l’air est chargé d’iode, la nuit est tombée.
Le phare jette toujours son dard de lumière dans la nuit. Je serre Laura contre moi.
01 :30
Nous arrivons à l’Hôtel du Palais, nos pas crissent sur le gravier. Le hall est vide. Nous prenons l’ascenseur.
Laura se jette sur le lit. Morte de fatigue. Je l’aide à se déshabiller comme je peux. Elle s’enfonce sous les draps. J’avale le chocolat qu’on a posé sur l’oreiller.
Je téléphone à la réception pour qu’on nous réveille à sept heures du matin avec un petit déjeuner anglais, en chambre : saumon, bacon and eggs, saucisses, fruits, café, thé et viennoiseries, céréales et fromage blanc.
-Ce sera tout…
Je raccroche. Laura ronfle déjà. J’en profite pour fouiller ses poches. Je ne me suis pas trompé : elle a sa paille et un sachet de quelques grammes. Je lui pique sa paille. Dans la salle de bain, je verse un peu de la poudre de Camille sur le bord du lavabo. Je plante la paille dans mon nez et sniffe un bon coup.
« Pouah ! »
Ça va me faire dormir. Et la poudre de Camille ce n’est pas du coupé. Je le vérifie aussitôt…
Mes aïeux !
VI.
Samedi 6 septembre
« Le Saigneur des Couteaux »
07 :00
La porte s’ouvre, j’ouvre l’œil qui ne dormait pas. Une serveuse pousse un chariot près de la table. Sous les couvercles en argent un déjeuner royal nous attend. Je rabats le drap sur les fesses de Laura. La serveuse entrouvre un rideau pour faire rentrer un peu de lumière. Puis elle s’en va, sans un mot, comme elle était venue.
Je mets un pied à terre. Il faut que je pisse. J’enfile un peignoir. En passant, je jette un coup d’œil dehors, le ciel est bleu. Incroyable comme la couleur du ciel, le matin au lever, programme ma chimie interne pour la journée. J’ai dix fois plus d’énergie quand le ciel est bleu comme aujourd’hui. J’ai plus d’envie, plus d’appétit. En parlant d’appétit, je regarde le chariot du petit déjeuner. C’est grand. Il y a bien cinq cent grammes de saumon fumé pêché à la ligne, en Écosse, probablement dans le Loch Ness. C’est un saumon qui a côtoyé le monstre. Je le regarde avec respect. Je prends la paille que j’avais laissée dans la salle de bain. Je la mets près du bol sur le plateau. Tant que j’y suis, je verse quelques grammes de coke dans la petite cuillère. Je range mon sachet de poudre dans ma poche. J’en connais une qui va être surprise. Je la regarde, elle est si belle, sur ce grand lit.
J’attrape le Nikon numérique. Je la cadre, sans flash, je fais la mise au point. Je la mitraille. Des fesses au cou, en passant par les cuisses. Le soleil joue sur son corps. C’est torride. Je pose l’appareil au moment où elle ouvre un œil. Elle fait la levée du corps et s’assoit au bord du lit, je m’assois près d’elle :
— Tu as bien dormi ?
— Ça va.
— Il fait très beau, ça va être une très belle journée.
Elle s’étire.
— J’ai pas envie d’aller travailler, Paul.
Elle se coule contre moi. On s’embrasse. Elle me caresse très doucement. Je fonds. Elle aperçoit le Nikon :
— Tu as fait des photos ?
— Oui, la lumière est magnifique ici.
— Je peux voir ?
— Mais bien sûr.
J’allume l’appareil, les photos apparaissent sur le petit écran. Elle regarde.
— Tu es un cochon…
— Tu es si belle, Laura.
Elle rit.
— Ce sont de belles photos. C’est vrai.
— Tu as faim, ma chérie ?
— Oui.
— Il y a un petit déjeuner d’anthologie qui nous attend.
— Je vais aller faire pipi d’abord.
Elle se lève, titubant presque. Je ne peux m’empêcher de la caresser encore du regard, de la tête aux pieds. Je bande et j’ai faim.
Je me mets à table. Les couverts en argent, la porcelaine, le tissu impeccablement blanc de la nappe et des serviettes laissent présager que ce petit déjeuner restera dans ma mémoire.
Laura vient s’asseoir en face de moi. Elle glousse de plaisir, elle a enfilé son peignoir.
Du bout des doigts, elle déguste en déchirant les tranches de saumon, elle presse un demi citron qui gicle et dégouline de son jus. Pour ma part, je fais un détour sur les œufs frits au bacon. Ce sont des œufs vraiment frits, entièrement cuits dans une vraie friture avec un bouquet de persil, frit lui aussi. Je donne un petit coup de couteau. Le jaune se répand dans l’assiette, je sauce une mouillette. Le bacon est doré à point. Les toasts sont bien chauds. Hum, quelle bonne idée d’avoir mis quelques champignons sautés légèrement aillés. Cela me fait penser à la sauce ragougnasse de ma grand-mère qui était liée à la mie de pain et au vinaigre.
Les recettes anciennes sont merveilleuses de simplicité. J’ai une dévotion particulière pour les œufs au vinaigre, ce sont des œufs à la poêle sur lesquels on jette une réduction de vinaigre à l’ail. C’est facile à faire : on coupe une gousse d’ail en tout petits cubes qu’on fait dorer dans la poêle, puis on ajoute 3 cuillères à soupe de vinaigre qu’on fait réduire une minute, enfin on jette le tout sur les œufs frits, salés et poivrés. Ça prend trois minutes et c’est un délice.
Le jaune d’œuf est sublimé par le vinaigre, lui-même galvanisé par l’ail, qui, bien doré, ne donne pas mauvaise haleine, contrairement aux idées reçues.
On s’en met partout. Soudain Laura me jette un regard noir :
— C’est quoi ça ?
Elle me montre la paille et la petite cuillère remplie de poudre.
— Ben, c’est une petite ligne, j’ai pensé que ça te ferait plaisir, ma chérie.
— Tu me prends pour qui ?
— Comment, je te prends pour qui… On n’apprend pas au vieux singe à faire des grimaces. Mais je ne te reproche rien. Par contre, je casserais bien la gueule au salaud qui te pique ton argent contre tes saloperies coupée. Ça c’est de la bonne et elle est gratos. Tu peux me croire.
Sur ce, je sors mon paquet et le pose sur la table. Laura ouvre de grands yeux.
— A la tienne ma chérie, je lui tends mon verre de cocktail de fruits frais.
— De temps en temps je ne crache pas dessus, mais c’est tout, bredouille-t-elle.
Elle prend son verre et trinque. Médusée.
— Je t’avoue que je m’en suis fait une petite ligne hier soir pendant que tu dormais, elle est terrible… Je n’ai pas osé te réveiller.
Elle rit.
— Pardon pour hier au soir. Je n’aurais pas dû. Ça se voyait tant que ça ? s’excuse-t-elle.
— Tu sais, j’ai un sixième sens pour ces choses là. Le problème, en plus de la dépendance à la drogue, c’est la dépendance au dealer. Tu deviens un robot : « Va chercher l’argent, rapporte-le, je te donnerais ton su-sucre. Sinon, va faire un tour en enfer, voir si j’y suis… »
Laura me regarde, elle me mange des yeux avec appétit.
J’avale mon café. Elle a déjà la paille dans le nez. En un trait, il n’y a plus de poudre dans la cuillère. Snif…
Je me lève, je la prends par la main et la tire vers moi. Je l’embrasse et la pousse doucement sur le lit.
— J’ai extrêmement envie de toi, Laura.
Elle plante ses yeux dans les miens. Nos bouches se happent.
Ce qui suit est unique et total. Je crois que, de mémoire, je n’ai jamais aussi bien baisé…
… Quelques minutes plus tard, après cet empalement digne des plus grands supplices de l’histoire, Laura est détachée de la croix, comme un jésus, son corps est couvert de sueur et de salive, dans un état d’épectase proche du reset.
Elle souffle :
— Il faut que j’aille travailler, Paul ! Je vais être en retard.
— Et oui, tu vas être en retard, mais tu vas dire à ton chef qu’il n’a pas les moyens de te payer cette heure de retard, car il n’est pas assez riche. Même s’il te donnait l’hôtel en salaire. Et puis, cette heure, elle n’est pas à vendre, point.
Laura me regarde comme si j’étais un extraterrestre.
— Je n’avais jamais pensé comme ça !
— Ah, bon ?
— Non, mais tu as raison, cette heure, je ne leur vends pas. Après tout ?
— C’était bon ! Qu’est-ce qu’on baise bien tout les deux ? Hein ?
— Tu sais t’y prendre.
— Je crois que je n’ai jamais pris autant de plaisir à faire l’amour.
— Moi non plus, Paul.
On s’embrasse comme des gamins.
— Tu prends ta douche en premier ?
— Non, je ne prends pas de douche, je veux garder ton parfum toute la journée sur moi.
— Tu as raison, moi aussi. On se fout des douches. Et des palaces.
Je joins le geste à la parole. Je jette les coussins les draps, je mets tout sens dessus dessous dans la chambre. Laura hurle :
— Non Paul ! Pas ça…
— Comment pas ça ?
Je fais un arrêt sur image.
— Il faut respecter le travail des femmes de ménage. Et laisser les lieux propres…
Elle remet tout en place. Elle a raison, je suis un peu con parfois…
Je l’aide.
Nous finissons de nous habiller. Je récupère mon sachet de poudre. Je dresse mon pouce, ce qui a pour effet de former un creux entre les deux tendons reliés au poignet, creux dans lequel j’étale une petite lichette de poudre. Je sniffe, comme si c’était du tabac à priser. Je glisse le sachet dans mon sac.
La reniflade me revigore.
Quelques minutes plus tard, je paie une note plutôt salée à la réception du rez-de-chaussée.
09 :30
Je m’accroche dans la Twingo. Et nous filons sur l’autoroute. Je chausse mes Ray Ban. Le soleil tape. L’enterrement de Riton est dans une heure.
— Chérie, tu peux me laisser à Bayonne en passant ? j’ai quelques courses à faire. Je rentrerai plus tard en taxi.
— Dans le centre ville ?
— Parfait.
Quelques minutes plus tard, comme un touriste, le sac sur l’épaule, je déambule dans les rues commerçantes de la ville. Le vieux Bayonne a beaucoup de charme.
Je me renseigne auprès d’un marchand de journaux, j’achète Libé. Vingt minutes de marche plus tard, j’arrive au cimetière Talouchet, juste à l’heure.
Je remarque quelques voitures de police stationnées près de l’entrée du cimetière. Les flics ne bougeront pas. Il y a des règles qu’on ne transgresse pas, qu’on soit flic ou voyou, les cimetières sont des zones franches, des zones sacrées où seuls les morts ont la parole. Il semble bien que ce vieux Riton ait attiré du monde, ça se bouscule devant l’entrée. Quand je dis « ça se bouscule », c’est façon de parler. Disons qu’il y a une cinquantaine de personnes qui attendent. Beaucoup de mantilles noires, ses maîtresses sont venues, c’est rassurant. Je salue discrètement tout ce monde en prenant la mine qui convient. Mes Ray Ban me protègent de ces regards interrogatifs. Nous marchons sur une allée de gravier entre les tombes. L’ambiance est sinistre. Si Riton était là, il rirait jaune.
Je déteste enterrer mes amis. Surtout quand ils sont morts. Et encore plus quand je les ai fait passer de vie à trépas. La mort est une saloperie qu’il vaut mieux affronter que subir. Je ne sais pas pourquoi je déteste les cimetières, alors que je me sens parfaitement à l’aise quand je débite un de mes semblables sur un billot de boucher. Ce sont ces croix et ces caveaux qui sonnent creux, ces tombes qui évoquent le temps qui passe et emporte tout. Ces cercueils en bois (et puis je déteste être mis en boîte). Ces feuilles mortes, cette lumière qui viole nos pupilles et fait rougir nos yeux. Ces grands arbres qui se croient malins parce qu’ils ont une vie plus longue que la nôtre, ils bougent leur feuillage pour nous dire :
« Hou, hou, bientôt ce sera ton tour et je serai encore là. Hou, hou… »
Pauvre imbécile, t’as pas vu que tu es un arbre ! Les pieds plantés dans le sol. Comme tu dois te faire « chier » mon pauvre. La nuit, le jour, attendre que la pluie tombe. Est-ce que ça t’excite, au moins, quand un chien te pisse sur les pieds ? Non, tu restes de bois.
Mais qu’est ce qu’on fout, tous, dans ce monde. Qui a dit qu’on serait heureux ailleurs ?
Il n’y a pas d’autre monde ! C’est scientifiquement prouvé ! Le paradis a été inventé pour effrayer les foules et les faire marcher droit :
« Si t’es méchant, quand tu seras mort, tu vas aller brûler en enfer. Par contre si t’es gentil, t’iras tout droit au paradis ».
Non mais, faut être demeuré pour avaler une pilule pareille. Et puis, le paradis ce serait quoi ? Une sorte d’Hôtel du Palais avec de la coke dans tous les tiroirs ? Un billot en acajou et des couteaux en acier de Tolède. Un room service de folie, avec du canard gras à tous les repas ? Des filles pulpeuses qui attendent leur tour, dans le couloir, toutes plus sublimes les unes que les autres ? Une énorme chambre froide où pendraient des abatis impeccables. Et Jimmy Hendrix avec sa guitare qui jouerait « Red House » assis dans un coin sur un tapis d’Aubusson, en me roulant des pétards, juste pour moi ?
C’est quoi le paradis ? C’est une branlette éternelle ?
« J’y crois pas ! »
Par contre, je croirais plus volontiers à une histoire d’extraterrestres, les « EUX ».
« The THEM » en anglais.
(Le cercueil arrive… Mon dieu, c’est pitoyable. Le curé chante « Gloria »…)
C’est une vieille théorie que je trimballe dans mes souvenirs depuis l’adolescence :
« AU DEBUT IL N’Y AVAIT RIEN ET A LA FIN IL Y AURA TOUT… »
On naît. Nos parents nous nourrissent. Adolescent, on a des boutons. Puis un jour on se déhanche légèrement en écoutant une musique à la mode, ce sont les premiers symptômes des spasmes de la terrible « Danse de la Reproduction ». Très vite on va en boîte. On se parfume. On cherche la femme (ou l’homme). On fume, on boit, les conditions de la « Reproduction » se réunissent peu à peu. On se trouve enfin, on s’engrosse, au camping sous la tente. Neuf mois. Ça y est, un bébé braille. Alors on s’agite, on crée de l’entropie. On est prêt à sacrifier ses amis, ses parents pour une promotion ou une part d’héritage. Les enfants grandissent. Puis un jour ils ont dix sept ans. Ils mettent du gel dans leurs cheveux, ils se percent les sourcils, et commencent à se déhancher à leur tour. Horreur, ils piquent même la bagnole pour aller en boîte. Ils sont pris par la folie du dance floor. Boîtes et musiques à la mode, ils se déhanchent, piquent nos parfums. Le mâle trouve une femelle et vice versa. Entre deux danses, ils s’accouplent, parfois dans des voitures… Bientôt la femelle est grosse. Branle bas de combat. Travail. Famille. Patrie. Péridurale. Césarienne. Sage-femme. Couche culottes. Il va falloir que le fiston trime pendant des années pour nourrir les bouches affamées de sa progéniture. Le plus terrible c’est qu’il n’a rien appris, il est aussi « con » que ses parents, parfois plus. Il refera les mêmes erreurs.
Et pendant ce temps, on a vieilli, bon pour la casse, un énorme trou noir nous tend les pelles.
Quid des somptueux hôtels qu’on a construit, par notre travail ? Des bagnoles de folies, des robots, des ordinateurs qui bossent toujours plus et toujours mieux ? Quid de toutes les richesses, les inventions, les évolutions que nous avons patiemment développées pendant des milliers d’années, nous les humains ?
On n’est plus là pour en profiter, puisqu’on est mort :
« LES DERNIERS ARRIVES SERONT LES MIEUX SERVIS. »
Je l’affirme :
« Il y a « quelqu’un » quelque part qui attend le bon moment pour récupérer et profiter de toutes nos richesses. »
Ce « quelqu’un » attend que l’humanité ait atteint un niveau de compétence, au delà duquel elle sera caduque, obsolète. A ce moment là « RAUS ! » dehors les humains !
« ILS » descendront du ciel pour s’installer sur terre et « ILS »profiteront éternellement de nos palaces, de nos villes, de nos bagnoles, de nos robots et de nos ordinateurs, de nos DVX de cul et de nos MP3 gratos.
Nous devons réagir :
Si tous les hommes se donnaient la main et posaient leur cul par terre. Si tout le monde arrêtait de travailler, de se reproduire, de se laver. Ça les paniquerait. C’est sûr…
Un énorme warning rouge se mettrait à clignoter avec un terrible et angoissant bruit d’alarme :
« TOOT, TOOT, TOOT… »
« Que se passe-t-il sur terre ? » crierait une voix.
« Tout s’est arrêté, ce n’est pas normal. Nous devons intervenir ! Chef ! »
« Très bien, envoyez le cargo pyramidal Ramsès 2018 dans le système solaire, voir ce qu’il s’y passe ! »
« Bien Votre Majesté… »
Et on les verrait arriver : les « EUX ». The THEM.
« Gloria ! »
Une magnifique pyramide volante obscurcirait le ciel, elle serait couverte de petites lumières multicolores qui clignoteraient. Un OVNI, un vrai !
Les enfants écarquilleraient leurs grands yeux.
Et là, on pourrait discuter :
Ils nous demanderaient avec un énorme haut parleur :
« Que se passe-t-il ici, terriens ? »
Nous on répondrait :
« On en a marre de bosser et de mourir ! »
« Quoi ! Quoi ? »
« On veut vivre trois cent mille ans ! »
Ils nous répondraient :
« Ça va pas non ? Cent cinquante mille ! »
Et nous on dirait :
« Deux cent mille ! »
« OK, accordé… »
Et, nous, malins, on demanderait plus encore, en hurlant :
« On veut augmenter la surfaces des muqueuses érogènes sur le corps, pour jouir davantage ! »
« Ouais, mais qui va bosser pendant que vous vous palucherez ? »
« Ben, les robots !!! »
Au bout d’un très long moment de grand suspens ils répondraient :
« Bon OK, on vous largue des pilules qui opèrent une modification génétique, vous aurez le cul devant, et vous serez couvert de muqueuses, des épaules aux fesses, sous la forme d’une vingtaine de tétons. »
On leur crierait :
« Merci à vous ! »
Et ils répondraient :
« On s’en fout, on a le temps… »
Et pschitt, ils repartiraient chez eux.
Je m’égare…
Non ?
10 :30
Le sermon est terminé. Les quatre croque-morts positionnent le cercueil sur le trou fraîchement creusé. Lentement ils donnent du lest aux cordes, le cercueil descend.
Les femmes gémissent sous leur mantille, elles s’avancent et jettent un peu de terre sur le cercueil. J’aperçois Camille. Il s’est mis sur son trente et un. Il s’approche de moi :
— Quelle tristesse. Ça me fout en l’air. Lui qui était si vivant.
Il écrase une larme, sort un énorme mouchoir et se mouche bruyamment.
— Oui, il est mort maintenant, dis-je un peu piteux.
Camille soupire. Il jette à son tour une poignée de terre.
Ça sonne creux quand elle tombe sur le bois du cercueil. Je fais de même. Camille me parle à voix basse :
— Il parait qu’ils n’ont retrouvé que quelques grammes de chair, des cheveux et un morceau de montre, une Patek Philip.
Je tique :
— Quel gâchis!
— C’est un ami policier qui me l’a dit…
On entend les femmes qui gémissent de plus belle sous leur mantille. Camille me parle à voix basse :
— Il avait une quinzaine de filles qui faisaient le tapin. Il a fini par toutes les engrosser. Pour les allocations… Il était dur le Riton. Tu sais que c’est lui qui a commandité l’assassinat du Général Carrera Bianco, celui dont la voiture a été retrouvée sur un immeuble de trois étages à Madrid. Il avait creusé un tunnel sous la route et mis cent kilos d’explosif. On a cru que c’était les basques. Et tu sais pourquoi il l’a buté ?
— Non.
— Parce que l’autre avait fait un chèque en bois au restaurant.
— Non ?
— Si !
On éclate discrètement d’un rire bronchitique…
— Il avait des principes, le Riton.
Je regarde ma montre. Il est déjà onze heures. La foule se disperse. On s’embrasse un peu partout. Il y a des taxis qui attendent devant le cimetière. Camille me prend par le bras et m’entraîne à l’écart.
— Dis-moi, Albert, cette fille qui était avec toi hier soir.
— Oui ?
— Elle fréquente un type qui est sur notre liste noire.
J’ai le cœur qui s’arrête de battre. Je regarde Camille au fond des yeux :
— Tu es sûr ?
— Certain, c’est un journaliste qui fourre son nez dans nos affaires.
Mon sang ne fait qu’un tour.
— Tu connais son nom ?
— Daniel Desprat. Il emmerde tout le monde. C’est une balance. On a de quoi le faire sauter, mais faut faire attention avec la presse locale, faut pas les froisser.
— Je crois qu’il n’habite plus dans la région, dis-je un peu penaud.
Il me regarde surpris :
— Il aurait déménagé ?
Je me frotte le nez un peu gêné. Il comprend :
— Tu l’as…
Je lui parle à l’oreille :
— Je suis désolé, mon vieux. Il était vraiment trop curieux.
— Et donc t’as récupéré la petite…
— Et voila. C’est dans l’ordre des choses.
— Bon. T’as bien fait, ils sont trop curieux ces journalistes à la noix. Il n’a que ce qu’il méritait, après tout. Il est sûrement mieux là où il est. Bah ! Prends soin de toi, Albert. Et si t’as besoin, Camille est là. Allez va…
On se tape sur l’épaule, on se fait l’accolade, il a la barbe qui pique, moi aussi, ça fait un peu Velcro.
Je saute dans un taxi :
— Hôtel Florida !
Il démarre. Bientôt je file sur l’autoroute vers Capbreton. Le soleil est au zénith. J’essaie d’oublier les ondes maléfiques du cimetière Talouchet.
Les enterrements, ça creuse.
J’ai faim…
Laura et le journaliste, j’aurais dû m’en douter
Ça tourne dans ma tête. Si Laura connaît ce Daniel Desprat, elle a dû remarquer sa disparition. Peut-être espérait-il qu’elle m’extorquerait des informations sur l’oreiller. Peut-être que Laura couche avec moi juste pour ça…
Ou peut-être, tout simplement, elle l’a jeté avant de se jeter dans mes bras. C’est sûrement lui qui a laissé sa Twingo à la petite. Elle m’a parlé de cet ami disparu… Puis elle s’est repris en me disant qu’il était a Bordeaux pour le week-end. Je fouille les poches de mon pantalon. Elle est là, la clé passe partout que j’ai piquée dans le tiroir de l’office.
Il faut que je tire les choses au clair, comme dirait mon notaire…
Je ressens une grosseur qui enfle dans ma poitrine. C’est ma boule de solitude et de tristesse qui reprend du poil de la bête.
Je déglutis…
« Laura à quoi joues-tu ? »
11 :30
Il est onze heures trente lorsque le taxi me dépose devant l’hôtel Florida. Je vérifie qu’on n’a pas été suivi. Tout est calme. Je marche jusqu’à l’hôtel Miramar. Je rentre dans la réception. Il y a du monde au restaurant. Laura s’affaire au service de table. J’ai le temps de faire une petite vérification. Je monte les marches quatre à quatre jusqu’à ma chambre. Je récupère mon couteau qui était resté au fond de mon sac. Je le glisse dans la ceinture de mon pantalon. Il est bien là à sa place. Il me rassure. Tant que j’y suis, je prends le Nikon, c’est une bonne idée de photographier les indices, si j’en trouve. Je prends également une paire de gants en caoutchouc. Je laisse le sac. Je sors, referme ma porte et grimpe jusqu’au deuxième étage. Laura m’a dit qu’elle logeait dans la chambre 204. Il faut m’assurer que le groom n’est pas là. Je marche silencieusement sur la moquette jusqu’à la porte. J’écoute en collant mon oreille à la paroi. Je retiens ma respiration pendant une minute. Rien. Il n’y a personne. Je tends l’oreille. L’étage est vide, les clients mangent. Je mets les gants, puis j’introduis silencieusement la clé dans le trou de la serrure. Je la tourne. La porte s’ouvre.
J’entre.
Dans la pénombre, j’aperçois une chambre qui ressemble à toutes les autres chambres de l’hôtel. Le lit est fait. La couleur dominante est le bleue. C’est une petite chambre. Il y a un coin toilette avec un lavabo et une cabine de douche. Une armoire en tek. Une télévision sur une étagère. Un tout petit bureau. Une chaise, sur laquelle est posé un gros sac de sport en toile. J’inspecte la poubelle, elle est vide. Le ménage vient d’être fait. Ça me rassure. J’essaie de trouver des indices, je scrute chaque centimètre carré. Tout semble normal.
Le sac. Je tire sur la fermeture Éclair. J’écarte l’ouverture pour en inspecter le contenu.
Soudain j’entends des pas qui se rapprochent dans le couloir. Je me mets derrière la porte d’entrée et saisis le manche du saigneur à ma ceinture. J’arrête de respirer.
Les bruits de pas s’éloignent.
Je reprends mon investigation. Le sac de Laura est plein de linge sale. Petites culottes, tachées de sang. Je renifle. Mon cœur défaille. Mes tempes battent. Je glisse la culotte dans la poche de ma veste. Je la garde pour plus tard…
Je trouve des tee-shirts, des jupes, des chemises qui sentent étrangement bon la transpiration et la moisissure. Une trousse de toilette qui contient une bouteille. Je renifle encore : l’eau de Cologne de Laura. Une merveilleuse senteur, d’une sublime vulgarité. Il n’y a pas de marque sur la bouteille vide. J’éprouve comme une ivresse. Une bouffée chaude. Comme si ces objets intimes étaient sacrés.
Je continue de vider son sac. Un jean avec un ceinturon en cuir. Rien dans les poches. J’inspecte le fond, il est encore moulé des cuisses et du mont de vénus de Laura. Il y a encore son string à l’intérieur. Un soutien gorge rose avec une petite fleur en tissu entre les seins. J’arrive au fond du sac, je trouve des vieux papiers. Des fiches de paye. Un cahier. Des photos jaunies de Laura petite. Comme elle était mignonne…
Rien d’autre dans le sac.
Voyons, elle a déménagé les affaires de sa cabane après la tornade. Elle a sûrement pris les affaires les plus précieuses. Si elle veut me cacher des choses, elle ne les aura pas laissées dans ce sac.
J’observe la pièce. Je flaire :
Sous le matelas ? non, c’est trop facile.
Dans la chasse d’eau des WC ? trop humide.
Le parquet au sol semble intact.
La cheminée : elle est condamnée mais une porte à glissière en cuivre ferme le foyer. Je saisis la poignée et soulève. Ça grince. La porte glisse et libère le foyer. Je crois que j’ai trouvé. Facile comme cache !
Il y a là un dossier cartonné et ficelé par un élastique.
J’ouvre…
Ce que je vois, dépasse mon imagination. Un instant je doute de mes sens. Puis un frisson me parcourt, de la racine de mes cheveux, à mes socquettes en fil. Mon cœur s’arrête de battre. Net…
Sur la première page, une photo, je reconnais le visage angélique de « SIMONA »…
C’est la photocopie d’une coupure de presse :
« L’HORREUR QU’A VECU LA SERVEUSE DU MIRAMAR DEPASSE L’ENTENDEMENT. »
« IL LUI A MANGE LE CŒUR APRES L’AVOIR VIOLE… »
Mais que vient faire Simona ici ?
Je réfléchis : c’est moi qui ai demandé à Laura des informations sur le crime de la chambre 109. Elle a dû trouver des journaux de l’époque, qu’elle me destine, afin que j’écrive mon roman. Pourtant ces papiers ont l’air d’être dans ce dossier depuis des lustres. Ils en ont pris la forme, l’odeur, l’humidité.
Je pose à plat sur le parquet la coupure de presse. Je saisis le Nikon numérique, je le règle sur « macro », puis je cadre la coupure sur l’écran de l’appareil. Je prends quatre photos, dont une bien cadrée sur le portrait de Simona.
Il y a un cahier, il ne date pas d’aujourd’hui. C’est un cahier à spirale comme on les faisait dans le temps. Le papier est jauni. Il ne reste que quelques feuilles. Je tourne les pages, on dirait un journal intime. Je lis des bribes de textes écrites au stylo. Ça parle de travail, de restaurant, Édouard par-ci, Édouard par-là…
Il est incomplet.
Je me sens mal. Ce n’est pas le cahier de Laura. J’ouvre à la première page. :
« JOURNAL DE SIMONA NELSON »
C’est bien l’écriture de Simona.
Mon sang se fige, il n’est pas bien dans mes veines. Je me sens pâlir, comme si j’allais tourner de l’œil.
Que fait ce cahier dans le sac de Laura ?
Est-ce ce journaliste qui fouine partout ? Est-ce lui qui s’est procuré ce document incroyable ? Comment a-t-il pu l’avoir ?
Comme j’ai bien fait de le rayer de la carte des vivants. L’intuition du vieux pro que je suis…
Je lis :
« Journal de Simona Nelson :
Mon réveil électrique sonne. La douleur du réveil est insupportable. Il émet des ultrasons parfaitement cruels qui scient mes rêves. Édouard se retourne sur le ventre, il enfonce ses mains sous son oreiller, les plonge jusqu’aux coudes, il glousse de plaisir en bombant son petit cul sous le drap. Dans la cabane, la lumière du soleil filtre par tous les trous. C’est le signe qu’il fait beau. Je m’assois sur le lit. Je frotte le sable de mes yeux. Quatre heures de sommeil, c’est peu. Aujourd’hui c’est lundi, je suis toute seule au service. Heureusement, la plupart des clients de l’hôtel sont partis hier. Je suis très fatiguée, en plus, je vais avoir mes règles. Vivement la fin de la saison. J’ai mal aux jambes. Par contre, les pourboires tombent. J’ai deux mille francs en petite monnaie à aller changer à la banque. C’est une bonne saison. Je vais pouvoir me payer mes cours. Et rembourser Édouard.
J’ai dansé toute la nuit au Byblos. Bjorn, le DJ, est parti, c’était sa dernière soirée de boulot. Il a assuré, je n’ai jamais vu une piste de danse aussi chaude. On s’est éclaté jusqu’à quatre heures du matin. Je ne sais pas pourquoi aujourd’hui j’ai le cafard, c’est parce que c’est lundi. Je hais les lundis.
Je vais prendre ma douche. Dans le miroir de la salle de bain, je me regarde. J’ai les traits tirés. Par contre, j’aime voir mon corps, mes seins, mes jambes. J’ai appris à m’en servir. J’avais une meute de garçons après moi hier. Ils étaient chauds comme la braise.
Ici, les patrons sont très durs. Le maître d’hôtel me court après, c’est un vieux porc, je ne le supporte plus. Je redoute de me retrouver face à face avec cet obsédé sexuel. Il me met la main aux fesses pendant le service, en profitant de ce qu’on nous fait porter des jupes courtes. Un jour, je le giflerai, mais je pourrai dire adieu à mon travail. J’attends, plus que trente et un jours au jus, avant que je reprenne mes cours. Je m’habille, j’essaie de ne pas réveiller mon Édouard.
Tenue de travail : petit haut blanc avec col en dentelle. Jupe courte noire. Bas noirs et chaussures à semelles spéciales pour ne pas glisser pendant le service. Maquillage et parfum léger. C’est la consigne. Je sais que ce costume de soubrette excite les hommes. Je les comprends. La jupe moule mes fesses, je suis assez fière de cette jupe, elle me va parfaitement. Dès que j’ai le dos tourné, je sens les regards. Les vieux comme les jeunes, les hommes comme les femmes. Ça m’amuse.
Mardi
Je m’ennuie, je suis crevée, j’ai mal partout.
Mercredi
Jour de congé, merveilleux. Édouard m’a emmené promener sur la plage des Géants. C’était magnifique. Nous avons fait l’amour dans le blockhaus 128, j’y ai gravé nos noms. Puis il m’a invité à boire un verre, nous sommes allés au Casino, il m’a initié à un cocktail que j’ai adoré, le whisky Sour dont voici la recette :
1 dose de whisky : du Jack Daniels
Un jus de citron
Un peu de sucre en poudre
De la glace
Shaker
C’est tout, j’adore.»
Je fouille les papiers, une lettre attire plus particulièrement mon attention :
« Monsieur Daniel Desprat, chemin des Garluches à Tarnos. »
Je décachette délicatement l’enveloppe :
« Daniel,
J’ai le regret de te dire que tu es un salaud. Tu te sers de moi. J’ai décidé de ne plus être ta chèvre.
Va te faire foutre. Et récupère ta poubelle, sinon j’appelle la fourrière.
Laura. »
Elle n’a pas envoyé la lettre. Il n’y a pas de timbre sur l’enveloppe. Je fouille encore :
Des feuilles jaunies, ce sont les photocopies d’un rapport d’autopsie, écrit sur une vielle machine à ruban, je feuillette et lis au hasard des feuillets :
« Docteur Ducourneau : Rapport d’autopsie de Simona Nelson. »
« 172 — Examen externe :
Le cadavre a été éviscéré. La cage thoracique est ouverte. Le cœur a été extrait de sa cavité. Les artères sont coupées net par un objet très tranchant, probablement un couteau de cuisine ou de boucher. L’assassin est un expert dans le maniement du couteau. »
« 132 — Système nerveux central :
Le cerveau pèse 1410 grammes, les circonvolutions et ventricules sont neutres. Le cerveau est conservé… Crâne neutre, pas de trace de coups. »
Il manquerait plus que ça, je ne suis pas un sauvage quand même…
« 140 — Système cardiovasculaire :
Artères coronaires sectionnées, le cœur a été extrait… »
« 155 — Système urinaire :
Le rein droit pèse 125 grammes, il reste 14cc d’urine dans la vessie… »
« 156 — Appareil gastro-intestinal :
L’estomac contient 320 grammes de canard gras, probablement confit, issu du dernier repas. Traces visibles de vin rouge, probablement Bordeaux 1978, Saint Julien. Le pancréas est uniforme, rose et gris. Matières fécales fermes dans le gros colon. »
« 160 – Système génital :
Utérus, trompes et ovaires neutres. Élargissement du vagin et de l’anus indiquant un orgasme dû à l’absorption de drogue quelques secondes avant la mort. Pas de traces de sperme sur les parois vaginales et anales. »
« A l’ouverture de l’abdomen, il s’écoule un flot de liquide verdâtre…
… j’enlève l’œsophage, la langue, les poumons… »
Ils sont forts ces légistes pour remuer le couteau dans la plaie et enfoncer les portes ouvertes.
Je frissonne. Et si Laura connaissait ma véritable identité ?
Non, elle ne sait pas, elle aurait déjà téléphoné aux flics. Peut-être que Desprat voulait l’exclusivité, il voulait m’arrêter lui-même, à la main ? Ce salaud se servait d’elle comme appât pour me confondre.
Mais comment aurait-il su ? Je n’ai laissé aucune trace.
Même en vérifiant l’identité de Paul Montebourg, il ne pouvait remonter jusqu’à moi.
Voyons, je me remémore la discussion que j’ai eu avec le journaliste au restaurant :
« J’ai des révélations à vous faire. Des révélations sur Albert le Dingue. Peut-être allez-vous écrire un autre tome de votre livre? »
S’il m’avait suspecté, il ne m’aurait pas parlé comme ça… Et la police m’aurait cueilli à l’enterrement de Riton :
« Ils ne savent pas qui je suis ! »
J’en ai la conviction.
Il y a d’autres photos, dont une de Laura enfant qui souffle treize bougies en riant.
Je n’ai pas le temps de tout regarder, il ne faut pas que je moisisse ici. Je suis tenté de prendre des documents, mais cela mettrait inutilement la puce à l’oreille de Laura.
Je remets tout en place, en prenant soin de ne laisser aucune trace de mon passage. Je referme la cheminée puis je sors comme j’étais venu. Il n’y a personne dans le couloir. J’enlève mes gants.
Je descends un étage et rentre dans ma chambre. Du balcon je peux surveiller Laura qui met les couverts sur les tables de la terrasse.
Simona prend le soleil à poil sur une chaise longue. Je peste :
— Tu ne m’avais pas dit que tu écrivais un journal !
Elle lève la tête et remonte ses lunettes de soleil sur son front. Elle lit « Albert le Dingue ».
— Tu es là ? C’est quoi cette histoire de journal ?
— Je viens de fouiller les affaires de la petite. J’ai trouvé des choses intéressantes te concernant et notamment un bout du journal où tu racontes ta vie.
— C’est très romantique d’écrire son journal, tu ne peux pas me le reprocher. Mais que faisait-il dans les affaires de Laura ? Il devrait être entre les mains de la police. Dans le dossier d’instruction.
— Mais bien sûr.
— Elle te cache des choses. Ça t’énerve ? Fais attention, Édouard !
— Non, elle est pure et transparente. Je te parie qu’elle va m’amener tout le dossier pour que j’écrive mon roman.
Je déplace le lit et soulève la latte du parquet. J’y glisse la culotte tachée de Laura. Ce serait bête qu’elle trouve ça dans ma poche. Simona ne s’aperçoit de rien.
— Je ne veux pas te contrarier, me dit-elle, mais, un conseil, ne mange pas trop à midi, garde ton appétit pour ce soir, mon chéri.
Qu’est ce qu’elle raconte…
— Il est intéressant ce livre. Dis, chéri, c’est vrai que tu te masturbais beaucoup quand tu étais petit ?
Elle m’énerve…
— Et ta maman, elle te battait ?
Je claque la porte.
Je l’entends qui hurle encore :
— Tu as été violé hein ! Dans ton adolescence ? C’est ton père ? Le salaud !
Simona me gonfle…
Je l’entends qui hurle au loin :
— Il est vachement bien ce bouquin !!!
13 :00
Je descends au restaurant. Ma table est réservée. Je m’assois. Dehors, le temps se remet au gris. Je déplie ma serviette. Le rituel du déjeuner peut commencer. J’observe Laura, elle me voit et s’approche. Je ne sais trop quoi dire. Tous mes sens sont tendus sur ce qu’elle sait ou ne sait pas.
J’essaie de lire en elle. Peut-être me réserve-t-elle la surprise de me donner un dossier complet sur le crime de la chambre 109, afin que j’en écrive l’histoire. Elle aura contacté des membres du personnel, vingt ans après, qui auront gardé en souvenir les coupures de presse de l’époque. A moins que son ami journaliste ne les ait retrouvées dans les archives de son journal…
— Tu vas bien ? dis-je, en regardant le menu.
— Aujourd’hui, le chef vous propose de la lotte à l’américaine, me répond-t-elle, avec un riz pilaf.
Je plante mes yeux dans ses yeux. Elle ne cille pas. Elle me sourit.
— Va pour la lotte. Avec un petit verre de Sauvignon, je chuchote, il me tarde de te voir…
Elle récupère la carte.
— Je termine à quatorze heures trente, souffle-t-elle, mine de rien.
— J’écris en t’attendant. Mais j’ai du mal.
— Tu me feras lire ?
— Bien sûr. On se retrouve sur la plage vers quinze heures ?
— D’accord.
Elle s’éloigne en balançant son cul pour m’exciter un peu plus.
Le repas se passe, je suis contrarié, je n’ai pas faim. Cette matinée m’a retourné l’estomac. J’entends au loin une rumeur sourde qui m’avertit que des charognards de mauvais augure pourraient tournoyer, dans le ciel, au-dessus de ma tête, d’ici peu. Je suis dingue de cette fille et je commets des erreurs de débutant. Je sens le saigneur des couteaux passé dans ma ceinture, qui me blesse. Que se passerait-il si j’étais pris ? Pour la première fois, je n’arrive pas à chasser cette idée qui me traverse l’esprit. Probablement que je m’échapperais mentalement, en me plantant le saigneur dans le cœur. Si cinquante flics sortaient de partout, là, l’arme au poing, je plongerais ma main sur le manche. La pétarade des armes à feu exploserait dans mes oreilles, moi qui suis si fragile des tympans. Je sentirais les premiers impacts de balles dans ma poitrine et mes jambes. J’arracherais le saigneur de ma ceinture. Et je m’empalerais sur lui, de tout mon poids en tombant sur le sol :
« SAIGNEUR, JE NE SUIS PAS DIGNE DE TE RECEVOIR… »
Puis, une balle traverserait ma tête, comme une fusée fend le ciel, avec un bruit d’étoile filante. Je serais surpris de ne rien ressentir, qu’une sensation de froid. Je verrais la couleur pourpre de mon sang et éprouverais un dernier orgasme à sa vue. Peut-être même, dans un dernier effort, aurais-je la force de tirer la langue afin d’en laper quelques gouttes, quitte à m’en mettre partout sur le visage, d’une oreille à l’autre. Là, je tournerais de l’œil, lentement, en libérant une ultime et terrible dose de plaisir concentré et fluorescent qui inonderait tout mon cerveau. Comme un dernier flash fantastique. Tous les muscles de mon corps tétaniseraient pendant cinq secondes.
Fondu au rouge…
« Sommeil, Silence, Ombre, Froid, Décomposition. »
Je frissonne, de plaisir.
Je change de place et m’installe sur la terrasse. Laura me sert un café. Je lis machinalement la presse qui traîne sur la table.
Ça m’agace…
Je remonte dans ma chambre. Près de l’ascenseur, je croise le groom. Il me regarde bizarrement. Laura lui aura probablement parlé des photos.
Il est quatorze heures trente. Dans ma chambre, j’allume l’ordinateur portable et consulte mes emails. Un message est arrivé. Ça c’est pour le boulot, je lis :
« Bonjour
La cordelière des Andes est sous la brume
Et le lac Tanganyika est rempli de crocodiles.
Allongez votre pénis pour 20$. »
Je déchiffre : je vais avoir une mission, mercredi prochain, à Lyon, une « huile » à buter.
De toute manière je repars demain matin à la première heure. TGV pour Bordeaux, puis avion pour Lyon. Mes bagages ne seront pas longs à faire…
J’avale trois Xanax…
15 :10
Les pieds dans le sable, je me suis assis sur un rocher près du blockhaus 128. J’ai chaussé mes Ray Ban et mon chapeau Panama. La marée monte lentement. Les vagues s’écrasent devant moi. L’écume roule sur le sable. Des nuages noirs envahissent l’horizon. Ça sent le varech. Il va pleuvoir.
Soudain je la vois. Elle descend l’escalier en bois, là-bas. Je reconnaîtrais sa fine silhouette entre mille. Dans ce paysage impressionniste, on la croirait sortie d’un sublime tableau de Monet. Au dessus de moi, les nuages dessinent des formes sinistres dans le ciel. On dirait des fantômes.
Laura s’approche. Elle porte une veste en jean que je ne lui connais pas, elle a gardé sa jupe de service. Elle arrive près de moi. Je m’inquiète :
— Tu n’es pas trop fatiguée ?
— Un peu.
Elle regarde l’océan.
— Il va pleuvoir. J’ai reçu une goutte.
— On va s’abriter dans le blockhaus. Viens. Lui dis-je en lui tendant la main.
— Je n’aime pas trop ce blockhaus, Paul.
A mon tour je sens de grosses gouttes. J’insiste :
— Viens !
Elle me suit. Nous marchons dans le sable sans rien dire. Elle a l’air triste. Nous arrivons devant l’énorme cube de béton. La mer l’a lessivé. A l’intérieur le sable est propre.
— Viens entre, on va s’asseoir à l’abri.
Laura monte et s’assoit à coté de moi. Elle pose sa tête sur mon épaule. Elle enfouit ses mains dans les poches de sa veste.
— Ça n’a pas l’air d’aller, ma chérie ?
— Je ne sais pas, j’ai le cafard.
Je passe mon bras autour de son cou, elle se blottit contre moi.
— Tu as froid ?
— Non, souffle-t-elle. Je suis bien là…
— Tu n’aimes pas ce blockhaus ?
— Non, j’y ai de mauvais souvenirs.
Elle jette un regard circulaire.
— Tu sais il faut exorciser ses peurs et chasser les fantômes définitivement.
— Tu crois aux fantômes ?
— Mais bien sûr. Nous avons tous des fantômes qui vivent en nous. Ils ne sont pas ici ou là, dans des maisons hantées ou des forêts la nuit. Ils sont dans nos têtes. Ils se manifestent quand nous sommes dans des lieux qu’ils ont connus. C’est ce qui nous fait croire qu’ils hantent ces lieux.
Je lui caresse les cheveux doucement du bout des doigts.
— Alors il y a un fantôme dans ma tête qui est venu ici.
— Chacun de nous peut contenir plusieurs personnes disparues. Virtuellement, bien sûr. En plus du « moi », du « sur-moi », du « sous-moi ». On peut leur parler mentalement, elles répondent souvent. On les retrouve dans nos rêves ou nos cauchemars.
— C’est un peu flippant.
— S’ils t’effraient, il faut que tu exorcises les fantômes de ce lieu, Laura.
— Comment fait-on ?
— Il faut y faire l’amour. Sans capote.
— Tu te fous de moi ? Elle rit.
— Je suis très sérieux.
Je l’embrasse sur le front.
— Il avance ton bouquin ? s’inquiète-t-elle.
— Doucement, j’ai jeté quelques idées sur l’ordinateur.
— Tu vas raconter l’histoire de la chambre 109 ?
— Oui. J’ai bien réfléchi. C’est un terrible crime passionnel.
— Qu’est-ce qui te fait penser ça ?
— Toi !
— Moi ?
Elle me regarde, surprise.
— Oui toi, c’est probablement la même histoire que la nôtre. Il faudrait que je retrouve de la documentation, des coupures de presses de l’époque, pour comprendre.
— Dans ton livre, il faut que ce soit une histoire d’amour.
— Sais-tu où je pourrais trouver ça ?
— Des coupures de presse, d’il y a vingt ans ? Je ne sais pas, Paul…
ELLE ME MENT !
Je l’ai piégée. C’est effroyable. Elle me ment avec une candeur effrayante. Elle me ment depuis le début… Les documents qui sont dans son sac ne me sont pas destinés. Comment possède-t-elle ce rapport d’autopsie ?
Je sens les vautours qui tournent là-haut sur ma tête.
« Je ne suis pas ta chèvre » écrivait-elle dans la lettre qu’elle n’a pas envoyée à son journaliste. Elle voulait dire qu’elle ne voulait plus servir d’appât. La chèvre sert bien d’appât, pour attraper le loup ?
Dehors, j’entends le bruit de la pluie. Laura me regarde, elle tend ses lèvres. Je l’embrasse doucement. Ses longues cuisses s’échappent de sa jupe. Elle se laisse aller.
Elle semble amoureuse !
Je l’embrasse.
Mes sens s’échauffent. Je passe ma main entre ses cuisses. Elles s’écartent. Je baisse sa culotte en soie rouge. J’embrasse son ventre et remonte vers sa poitrine. Son parfum m’enivre. Je déboutonne sa veste, sa chemise. Elle ne porte pas de soutien-gorge. Sa peau est satinée. Je mordille son cou. Son menton. Sa bouche. Son nez. Ses yeux. Son oreille. Le lobe de son oreille duveté.
— Oh, Paul…
— Laura.
En passant ma joue sur sa poitrine, je sens son cœur qui palpite, là, tout près.
Sa bouche mange ma bouche, goulûment. Soudain elle se retourne sur moi. Me plaque au sol. Elle défait ma ceinture.
Mon dieu, le saigneur. Si elle le trouve je suis foutu. Je le saisis discrètement et le glisse sous moi. J’ai eu chaud, elle n’a rien vu…
Elle déboutonne ma braguette et baisse mon pantalon. Je bande. Elle saisit ma verge et ouvre grand sa bouche.
C’est où le Bengale ?
Y ai je été ?
Probablement. J’y chassais le tigre chaque été quand j’étais archéologue, en mission pour le musée du Louvre, c’était juste avant la première guerre mondiale.
Ah! Le Bengale (elle vient d’avaler mon pénis entier). Je me souviens de ce tigre magnifique qui courrait dans la forêt. Les parfums tropicaux, les perroquets multicolores, la végétation luxuriante. Les singes grimaçants et les serpents, énormes, turgescent. Oh ! Le maharaja donne un feu d’artifice. Les femmes de son harem me poursuivent dans les couloirs du palais. Elles m’attrapent. Soudain je le vois, énorme, il pousse un terrible grognement, le tigre…
— Non doucement, là… Chérie…
Dehors il pleut de plus en plus fort. Laura s’empale sur moi. Nous faisons l’amour. C’est quand même meilleur sans capote. Elle prend du plaisir, je ne peux pas croire qu’elle simule, ses yeux sont révulsés. Je me concentre pour ne pas éjaculer trop vite. Je cache tant bien que mal le saigneur sous moi.
Que j’aime son corps. Sa taille si fine. Ses fesses fermes et rebondies.
Que les femmes sont belles !
Je suis infidèle aux femmes de ma vie, car j’ai une théorie très pointue au sujet de la fidélité. Je pense que l’homme est fait pour avoir une multitude de femmes. En fait l’homme ne compte pas, ce sont les femmes entre elles qui font les enfants. Comme les insectes avec les plantes, le pollen que nous ramassons sur l’une, nous le déposons sur d’autres et les engrossons de la sorte, comme des fleurs. Nous avons l’illusion d’être père. Elles nous font croire qu’elles sont nos femelles, il n’en n’est rien. Il faut savoir que certaines plantes imitent la forme et l’odeur du sexe de la femelle de certains insectes. Le pauvre insecte croit voir une femelle, il fait son affaire (en fait, il la baise) et s’enduit par là même du pollen de la plante. Lorsqu’il recommence un peu plus loin (le veinard), il dépose le pollen sur la nouvelle plante. Sans le savoir, il est le sexe de la plante. C’est terrible, et cela existe dans la nature, la vraie, sans nucléaire, sans OGM et sans informatique, ceux qui ne jurent que par la nature doivent revoir leur copie, la nature est épouvantable, la nature est criminelle (d’ailleurs, elle tue tout le monde, je dis bien tout le monde…). Je préfère les mutations synthétiques, après tout, les Chamallows ne sont peut être pas si mauvais, en sauce, avec des cous de canards, c’est peut-être même bon. Je hais la nature, je détesterais porter des culottes en poil de bêtes, ça gratte, je préfère le tergal, ou ces magnifiques tissus synthétiques qui moulent et s’auto-lavent au contact de la peau, leur texture me fait penser à de la peau de couille d’extraterrestre. Ce n’est pas que j’ai beaucoup touché de couilles d’extraterrestres, mais, dans mon imagination, si j’avais à en toucher, je sais que j’aurais la même sensation. Maintenant, je ne garantis pas que la couille d’extraterrestre soit cent pour cent naturelle. Ils doivent se gaver de pilules mutagènes, depuis des générations, ce qui explique peut-être la douceur et la texture de leurs couilles.
Et toc !
La nature quelle horreur ! Si demain on crée une race de canard d’un mètre de long avec vingt pattes et dix foies de chaque côté. Je suis prêt à faire moi-même mes conserves comme mon vieux pote Riton. Je ferais quarante cuisses confites par canard. Et vingt foies gras. J’arrête la tuerie à gage et je m’installe, je vois déjà l’épitaphe :
« Ne pleure pas gros Canard, tu vas chez Albert, l’Empereur du Confit…»
Je m’égare…
Je me transforme en un énorme piston. Tous les deux, nous ne sommes plus qu’une locomotive à vapeur qui s’emballe sur la pente du Machu Picchu. Il y a en moi un machiniste fou, peut-être est-ce Gabin, la gueule noircie de charbon, qui bourre la machine, à grand coup de pelle, dans une ambiance de métal et de feu en chantant :
« Je sais ! Je sais ! Oh oui, je sais »
Nous allons à un train d’enfer, à tombeau ouvert, à bride abattue. Soudain, comme quand on dégoupille une cocote minute, je sens une fuite. Je suis propulsé. Ça pète. Je lâche. Je tire. Je défouraille. Mon cœur s’emballe. J’explose, me répands sur les murs. Je dégouline. Une fois de plus, je meurs de mort violente…
Laura est couverte de sueur. Elle semble revenir d’un voyage au paradis. Nous haletons en cadence. L’oxygène nous ranime.
Je n’ai pas pu me retirer à temps. Je note que, ici encore, la nature a commis une erreur de conception. Ce sperme gluant, qui colle, c’est désagréable quand on n’a pas de salle de bain à proximité. On remet son slip par-dessus en espérant que ça sèche, bonjour l’élégance. Si la nature avait un peu réfléchi, elle aurait inventé un truc plus pratique. On aurait pu éjaculer des petites graines, pas trop grosses pour pas que ça fasse mal. C’aurait été plus esthétique. Elles auraient pu êtres multicolores et éclairer dans le noir. Et avoir un petit goût de cachou. Autre avantage, et pas des moindres, ça aurait décuplé le plaisir en passant dans le canal étroit du gland. Un peu comme ces billes enfilées dans une ficelle que les filles s’enfoncent dans l’anus, dans les films pornos. Peut être même que le plaisir aurait été multiplié par cent. Voila une nouvelle revendication pour les « EUX », «The Them » en anglais.
« Gloria ! »
Le sperme en billes multicolores.
Et les billes, ça ne colle pas…
— J’ai froid… souffle Laura d’une voix blanche.
C’est vrai que l’air s’est refroidi, la pluie s’est un peu calmée. Je l’aide à se rhabiller. J’ai caché le saigneur dans ma ceinture en la reboutonnant.
J’ai presque oublié que je suis avec une sacrée menteuse. Laura frotte ses fesses, enlève le sable. Remet de l’ordre dans sa tenue.
— Le sable ce n’est pas terrible, m’avoue-t-elle.
— Non, en effet…
Elle se colle contre moi. La pluie se calme peu à peu. Je la réchauffe comme je peux.
— Tu as l’air soucieux, Paul.
— Tu lis dans mes pensées ? et ton fantôme ?
— Pschitt ! Il est parti… envolé.
— Tu vois, j’avais raison. Je suis soucieux, parce que j’attendais un journaliste du coin qui voulait me dire des choses, à propos de mon livre, et il m’a posé un lapin…
— Le journaliste qui t’as parlé au restaurant, l’autre midi ?
— Oui. Un grand maigre, plutôt moche.
— Oh, il n’était pas si moche que ça. Tu exagères.
— Tu le connais ?
— Un peu, il vient quelques fois à l’hôtel.
Ça ment comme ça respire. Laura tâte mes poches, je sais ce qu’elle cherche.
— Chéri, tu n’as pas envie d’une petite ligne ? demande-t-elle d’une petite voix.
— Ça ne serait pas pour me déplaire. J’ai planqué le sachet dans ma chambre. Si tu veux je t’en apporte un peu tout à l’heure pendant le service, quand je prendrai l’apéro.
— Merci, t’es un chou.
— Ce soir je dîne dans ma chambre. Préviens le chef que je veux le meilleur de sa cuisine.
— Tu pars demain ?
— Oui, mais je vais revenir très vite.
— Tu me promets ?
— Je te promets.
— On mangera tout les deux après ton service. Je vais t’initier à des plaisirs que tu ignores. Des choses qu’il convient de manipuler avec précaution.
— Tu me mets l’eau à la bouche, dit-elle, malicieuse.
— Il existe dans ce monde des zones inexplorées, Laura. Des replis de l’espace temps, où coulent des sources d’énergies bizarres. Des piscines sans eau dans lesquelles on plonge et on nage. Des lieux où il n’y a ni haut ni bas, ni devant ni derrière, ni gauche ni droite.
— Tu es sérieux ?
— Très sérieux. Tu vas connaître la « Révélation du Pentacle ». La seule vraie magie de ce petit monde. Sais-tu que lorsque tu as un orgasme, tu puises une énergie dans un réservoir collectif ? Cela veut dire que ton plaisir provoque le malheur et la douleur d’autres humains quelque part. Leur souffrance est symétrique à ton plaisir.
Laura rit d’un rire un peu forcé. Elle ne comprend pas. Elle est intriguée. C’est exactement ce que je veux.
— C’est l’heure, Paul, il faut que j’y aille, s’impatiente-t-elle, j’ai passé un moment merveilleux. J’étais déprimée tout à l’heure, et voila que je suis détendue, je ressens comme une ivresse. Je n’ai plus froid…
Elle glisse sa main sous ma chemise. La suggestion a fonctionné. Elle réagit parfaitement à mes incantations. Ce soir je vais lui ouvrir la « Porte ».
— Tu vas me manquer… murmure-t-elle de sa voix de fée clochette.
Lentement elle se redresse. Puis elle dépose un baiser sur mon front et se lève. Ses cuisses sont plus belles que le temple d’Angkor au coucher du soleil.
— A tout à l’heure, mon chéri.
Je lui renvoie son sourire. Elle saute sur le sable. La pluie a cessé. Je la regarde s’éloigner et redevenir un tableau de Monet. Je ne la quitte pas des yeux jusqu’à ce qu’elle remonte les escaliers en bois, là-bas et qu’elle disparaisse. Je pose mes doigts sur mon front, prends le baiser qu’elle y a laissé et le pose sur mes lèvres desséchées.
Ça va être l’heure de l’apéritif…
18 :10
Ça sent le vinaigre : c’est l’héroïne. Dans ma chambre, je dose la méthamphétamine. C’est un très subtil dosage que je prépare pour ce soir. Une mixture très complexe. Je tiens cette recette d’un médecin allemand, appelons-le Klaus, qui a bien connu Himmler pendant la dernière guerre. Nous avons passé un bon mois dans la même cellule en Argentine, il y a quelques années. Il s’est confié à moi avant que je l’exécute. C’est la recette qu’il faisait pour le Führer, lui-même, lorsqu’il faisait ses crises d’existentialisme nationaliste. Il appelait ça la « Porte ». Au début, je ne comprenais pas ce qu’il voulait dire. Il m’a fallut du temps. Puis un jour, j’ai eu la « Révélation ». Tout est dans le dosage. C’est un peu comme une onde radio, on peut glisser sur la fréquence et passer à coté du programme sans l’entendre. Le dosage de mon docteur allemand est comme une fréquence sur laquelle on entend un chant de sirènes hallucinant. La « Porte » qui s’ouvre à cet endroit psychique est bien plus fantastique que la porte des étoiles. Car elle ouvre sur un océan d’Extase. Les rares humains qui ont eu le privilège d’y plonger en sont revenus « mutants ». Leurs capacités sensorielles se sont décuplées et ils développent un septième sens, le « Sens Cosmique », qui donne une sorte de conscience universelle exacerbée. Sans compter avec la « Permutation Mentale » de deux êtres en symbiose. Il n’y a que ce problème de symétrie, cet effet secondaire, cette malédiction qu’on ne peut s’empêcher d’infliger aux autres. Quand on voit ce qu’Hitler a infligé comme douleur au genre humain, on comprend mieux les sensations hallucinantes qu’il ressentait lorsqu’il passait la « Porte ». Moi, à côté, je ne suis qu’un enfant de chœur…
C’est prêt !
Je pousse le lit contre le mur pour faire de la place. Puis je dessine un pentacle sur le parquet avec de la farine que j’ai pris aux cuisines. Deux étoiles imbriquées, un cercle de deux mètres de diamètre, afin de symboliser la « Porte ». Je prépare des bougies que je pose aux extrémités des triangles, pour l’ambiance. Je suis à la lettre les prescriptions du docteur Klaus Reich.
Il me fascine encore, le bougre…
C’était un vieillard très vicieux, avec des petites lunettes cerclées, une moustache qui datait du troisième Reich. Le bon docteur avait soigné les plus grands dignitaires du régime nazi : les hémorroïdes de Hess, le colon de Goering, les calculs biliaires d’Himmler et les reflux gastriques d’Hitler… Et cela grâce à une spécialité de son cru : la « Médecine Hallucinogène ». Un truc de fou. En gros, c’est l’opposé de l’homéopathie. D’ailleurs, c’est lui qui m’a appris à faire le voyage astral. A quitter mon corps pour errer dans l’éther et l’espace.
Nous avons même réalisé, à la fin du séjour, l’expérience ultime, la « Permutation Mentale ». On commençait par se bourrer d’un mélange subtil à base d’héroïne et de métamphétamine et de quelques autres composants que je ne peux divulguer ici. Puis, grâce à des incantations qu’il proférait, l’esprit sortait peu à peu du corps :
“ Herr töt zaglo. Kam zöt erroe…”
C’était un peu comme le voyage astral. Sauf qu’on permutait : il devenait moi et je devenais lui.
Je me souviens comme si c’était hier. Nous étions assis face à face, dans sa geôle, une cave minable et humide, dans une maison abandonnée, dans la montagne. Nous nous éclairions à la bougie, l’électricité n’avait jamais pu monter jusque là. Il y avait une table massive en bois, des tabourets brinquebalants. Nous nous regardions fixement dans les yeux, immobiles, pendant des heures. Il avait des petits yeux cruels, derrière deux gros verres convexes qui les rendaient encore plus cruels, comme ceux d’un iguane de Patagonie. La table était couverte de poudre blanche. On se serait cru à Megève au mois de mars. Nous en avions le nez rempli. C’était de la pure. De celle qui vous fait voir de quoi est fait le paradis de ceux qui n’y croient pas. Faut dire que la « Permutation Mentale », c’est du costaud. Ce n’est pas fait pour les gigolos. Il nous a fallu de longues soirées de pratique avant d’arriver à un début de résultat. La première fois que je suis rentré dans son corps, j’ai vraiment cru que j’étais en enfer. Ça puait la charogne. Ça grouillait de petit vers jaunes. Visiblement la sensation que je ressentais entre ses fesses (devenues miennes), laissait supposer que l’ignoble docteur se faisait sodomiser par tout ce qui pouvait le pénétrer : que ce fut organique, végétal, carbonique, liquide ou gazeux…
Son espace mental était d’une horreur immonde. On se serait cru dans un caveau trop plein. La barbe poussait en s’accrochant aux murs souillés, comme une glycine noire et pestilentielle. J’errais dans les latrines de son esprit, aux murs couverts de virgules marrons, peuplées de mouches vertes, remplies de papier journal d’extrême droite, auxquels se serait torché une garnison de SS qui auraient chopé une gastro-entérite carabinée. Une horreur. Lui, par contre, était indisposé par la propreté maniaque de mon « moi ». L’ordre qui régnait dans mes idées. La candeur de mes phantasmes, qui étaient aux siens ce qu’est l’eau de Vichy à l’absinthe des poètes maudits. Il me trouvait pathétique, triste, névrosé, bourré de complexes, timide. Fade. Sans goût. Il m’agaçait !
Jusqu’au moment où j’ai compris le but de sa manœuvre. La misérable ordure. Il voulait s’échapper à bords de mon corps. Ainsi, c’est moi, dans son enveloppe charnelle, qui aurait subi le châtiment qui lui était réservé. Il aurait été moi et j’aurais été lui. Heureusement j’ai vu clair dans son jeu. Ils sont malins ces nazis. Mais pas assez…
C’est vrai que je n’ai pas très bien compris toute la subtilité de leur doctrine. Il était intarissable sur le sujet, un vrai moulin à parole. Il m’expliquait les mystères de la race supérieure qui a perdu ses « pouvoirs » à cause du fait que les aryens se sont reproduits avec des animaux. Et qui, pour les retrouver, doit redevenir pure comme à l’origine.
« Un jour les aryens retrouveront les « Psy Pouvoirs » qui rendent immortel, invincible et supérieurement intelligent », hurlait-il.
C’est pour cela que les dignitaires nazis voulaient massacrer le reste de la planète. Car, m’expliquait-il, le massacre des tziganes, des juifs et des homosexuels, ce n’était que l’apéritif. Il fallait bien commencer par quelque chose. Il me confia qu’Heinrich Himmler avait dans ses cartons des plans bien plus diaboliques, notamment celui de stériliser des centaines de millions de femmes et d’hommes. Klaus Reich me confia qu’il avait travaillé aux projets fous des Docteurs de la mort dans les camps. Et notamment sur des sièges qui émettaient des rayons X, capable de stériliser une personne, homme ou femme, en vingt minutes (dans d’atroces souffrances). La stérilisation de masse était devenu la marotte d’Himmler. Car, grâce à cette technique, il éliminait les « impurs » sans avoir à surcharger les camps de concentration, autrement dit, en stérilisant des populations entières, il empêchait la naissance de centaines de millions, voire de milliards d’êtres indésirables…
Himmler avait été botaniste dans sa jeunesse. La botanique l’a finalement bien aidé à devenir le chouchou de son Führer adoré, en éliminant la mauvaise herbe du jardin SS.
Mais le projet a finalement été refusé, trop cher et inefficace : 20 minutes pour stériliser une personne, soit 3 personnes à l’heure par chaise. Soit 38 ans pour 1 millions de personnes.
« IRREALISTE !!!» s’était écrié le Reichführer, furieux.
« RAUS !!! »
Il écumait de rage…
C’est alors que Klaus lui proposa sa méthode de stérilisation par la « Médecine Hallucinogène ».
Il suffisait de montrer certains films (atroces) aux patients bourrés d’amphétamines, pour qu’ils soient traumatisés et stérilisés définitivement, à vie. Klaus me confia qu’Himmler lui-même, lorsqu’il lut les scénarii qu’il avait concoctés, refusa le projet tant ils étaient épouvantables. Il m’affirma que le Reichführer n’en dormit pas de la nuit, et qu’il dut lui faire plusieurs piqûres fortement dosées.
Je dois vous avouer que je n’ai pas cru un instant à son histoire de médecine.
« La puissance de l’hallucination est sans limites »
Rabâchait-il. Grâce à elle, on peut générer des cancers, des maladies psychosomatiques, des psoriasis, il prétendait pouvoir rendre définitivement chauve un patient lambda en une nuit. J’ai refusé poliment de me prêter à l’expérience.
Il avait écrit un énorme bouquin, qu’il m’a, d’ailleurs, gentiment dédicacé :
« HALLUCINOGEN THERAPY, BY GENERAL DOCTOR KLAUS REICH »
Il a écrit sur la première page, de sa main gantée, d’une écriture maudite, à l’encre noire:
« A mon ami Albert, ses larmes ne me ressusciteront pas, c’est pour cela qu’il me pleure… Heil Hitler ! »
Je n’ai pas compris tout de suite ce qu’il voulait dire. C’était tout simplement l’adieu pathétique d’une victime à son bourreau. Il avait pris une telle dose de coke, qu’il est mort en souriant, comme un bébé.
Je lui ai mis une balle entre les deux yeux, puis une dans chaque œil, pour être vraiment sûr qu’il ne m’hypnotiserait plus jamais. Il est probable que ses neurones couvrent encore les murs humides de cette vieille demeure montagnarde livrée à tout vent. Car ce n’était pas des petites bastos.
Les rats argentins se seront régalés, c’est l’essentiel. Quand à moi j’ai perçu une somme rondelette, payée par la junte militaire alors au pouvoir. Ils avaient appris par une de ses maîtresses, que Klaus Reich parlait en rêvant, la nuit.
Et ça, quand on a vécu ce qu’a vécu le docteur Reich, quand on a vu ce qu’il a vu, en Argentine, dans ces années reculées et troubles, c’était passible de la peine capitale.
Plus tard, j’ai lu le livre de Klaus Reich. J’ai dû doubler ma dose de Temesta pendant un bon mois…
Tout est prêt. Je me parfume et me coiffe. Je glisse mon sachet de poudre dans ma poche.
Ce coup-ci, c’est vraiment l’heure de l’apéritif…
20 :15
Je descends les escaliers quatre à quatre. La nuit tombe déjà. Les jours raccourcissent.
Le bar est vide. Je m’assois dans un immense club en cuir. Un bon whisky et un cigare devraient aider à parfaire ce moment de détente et de rêverie.
Je replonge dans le passé.
« J’ai donné chez les communistes aussi. »
Les pays de l’est représentaient un énorme marché, autrefois, pour la profession. Certes, l’âge d’or de la guerre froide est révolu. A cette époque, on tuait pour un « da » ou pour un « niet ». La concurrence des agents secrets et des espions de l’ouest était malhonnête. Je m’étais fait une bonne clientèle parmi les leaders politiques des petites villes de province. Ils avaient tous au moins dix têtes de turcs à liquider d’urgence. On travaillait nuit et jour. Je dis « on » car je m’étais associé à une polonaise. Une belle fille, au sang chaud comme la lave d’un volcan en éruption. Avec des arguments de poids, auxquels je n’ai vu personne résister. Une chute de reins vertigineuse. Des fesses étroites et fermes. Des cuisses fines. Un visage d’ange. Des yeux bleus clairs, derrière les mèches rebelles d’une chevelure platine. Un grain de peau apparemment fragile, laiteux, qui me rendait fou furieux, au simple contact. Un corps couvert de tâches de rousseurs que j’aimais observer à la manière de ces astrophysiciens quand ils regardent les galaxies, l’œil rivé à leur « énorme télescope ». Je me souviens du duvet blond, délicat et fin, au parfum très épicé, qu’il fallait aller chercher au fin fond des commissures, dans la douceur moite de la chair, à la limite des ourlets.
Comment s’appelait-elle déjà ?
« Vannia ! »
Ça me revient.
Je me rappelle le carnage de Saint Petersbourg. Elle s’était trompée de cible.
« Ah, les femmes !!! »
Elle avait dessoudé par erreur le capitaine de l’équipe de hockey locale. Furieux, le reste de l’équipe nous a violemment pris à partie. Nous avons été obligés de les liquider tous. Après le match, sous la douche. Je revois encore cet énorme tas de viande fumant dans les vestiaires remplis de buée. Ces éclaboussures écarlates sur le carrelage blanc. Et Vannia qui leur crachait dessus et leur donnait des coups de pieds en proférant des insultes effroyables que je ne comprenais pas. Cette nuit là, après que nous ayons fait l’amour, dans un luxueux hôtel de la vieille ville, j’ai dû me passer plusieurs fois de la crème anti brûlure sur le gland, pour éteindre la douleur et les cloques. Les polonaises sont dures à cuire. Elle a fini dans les bras velus d’un pilote d’hélicoptère afghan. Elle avait besoin de changer d’air. Moi aussi.
On était jeunes, on était fous…
Une voix familière me sort de ma rêverie.
— Et pour monsieur ce sera ?
C’est la voix de Laura. Elle me jette un délicieux regard que j’attrape au vol.
— Un whisky et un cigare, comme d’habitude.
Ses yeux pétillent.
— Bien, monsieur.
Elle fait la soubrette avec son petit tablier blanc et ses collants noirs. Je ne sais pas ce qui me prend, je trique. Dès que je pense à Vannia, je bande, elle est ma Fernande à moi. Mais si je pense à Vannia en regardant Laura en soubrette, j’ « enlarge my penis » de dix centimètres au moins.
— J’ai un cadeau pour toi, lui dis-je en aparté.
— C’est blanc comme la neige ?
— Tu as deviné.
Elle file vers le bar et me verse une triple dose de Lagavulin sans glace.
J’en profite pour extraire le sachet de poudre de ma poche. Puis elle revient, elle pose un petit plateau en argent sur ma table, à coté du verre de whisky.
Très discrètement, je verse une petite quantité de poudre sur le plateau. Elle a compris.
Elle vient poser la boîte à cigare, récupère le plateau en argent et file vers l’office. Je m’allume un Cohiba. Un nuage de fumée parfumée m’enveloppe. C’est bon. Laura revient un moment après, elle semble ne pas toucher le sol. Elle passe devant moi en se tortillant, heureuse de vivre.
Charles André Rubens entre dans le bar. Très élégant. Il m’aperçoit :
— Monsieur Montebourg va bien ? me demande-t-il cordialement.
— Tout à fait bien.
— Puis-je m’asseoir ?
— Mais bien sûr.
Il s’affale dans un fauteuil en face de moi.
— Quel temps pourri. Nous sommes allés, ma femme et moi, faire un tour dans un vide grenier en ville. J’adore chiner. Pas vous ?
— J’aime chiner, mais en Chine seulement. Avez-vous déjà chiné à Pékin ?
Il me jette un regard désespéré ne sachant si ma réponse est du lard ou du cochon. A son tour, il allume un cigare. Il change de sujet :
— Non, mais nous faisons une partie de bridge ce soir serez-vous des nôtres ?
— Ce soir c’est impossible, je dîne en chambre avec une maîtresse. Je serai donc dévoré par les plaisirs de la chair. Cher ami…
Il lève un sourcil.
— Comme vous avez de la chance. C’est un très bon programme.
J’attrape une carte sur une table voisine.
— Je pense que le vôtre ne va pas être mal non plus.
— Oh vous savez, à mon âge, il faut de la patience.
— Je suis sûr que Madame Fernanda à des arguments.
— Si vous saviez, cher ami. Faites attention à votre cœur. J’ai un petit truc personnel pour retarder l’éjaculation, je pense au lever des couleurs.
— Des couleurs ? Je ne saisis pas.
— Vous savez, les couleurs à l’armée, le matin on monte le drapeau pendant que le clairon joue l’air des couleurs. La troupe est au garde à vous. C’est très émouvant. Et bien, de vous à moi, quand je pense au lever des couleurs, je débande.
— Ça alors… C’est une forme de respect.
— Vous croyez ?
— Imaginez-vous, le sexe tendu, devant vos camarades pendant le lever du drapeau. Vous seriez atrocement gêné.
— Vous avez raison. Je n’avais pas pensé à ça.
Il faut que je compose le menu de ce soir.
Je fais un petit signe à Laura. Elle s’approche.
— Je voudrais commander un repas servi en chambre, pour deux personnes, mademoiselle.
— Mais certainement.
Laura joue son rôle à merveille.
Je regarde la carte. Voyons :
« Un Foie gras de canard.
Suivi d’un Filet de sole bonne femme.
Un Confit de canard aux figues, marrons, raisin.
Une petite Poêlée de cèpes.
Salade fromage.
Une Tourtière aux pommes de Grenade sur Adour.
Café, Armagnac 76.
Le tout arrosé d’un Château Haut Brion 89, pour changer. »
Rubens s’étonne :
— C’est une ode au cholestérol que vous récitez là… Vous savez, mon ami, je suis médecin militaire, j’en ai vu dans ma carrière, des grands gaillards très costauds qui se croyaient les maîtres du monde. Un jour ils sont tombés comme des mouches. Le cœur les a lâchés. Si j’étais votre médecin, je vous mettrais en garde. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le blanc des yeux qui tire sur le jaune dénote une alimentation trop riche, dit-il en me dévisageant, vous savez, l’alcool et le tabac ne font pas bon ménage.
— Docteur, je ne veux pas savoir !
Fernanda fait irruption dans la salle, elle s’assoit à côté de son mari.
— Charles André, cessez d’embêter monsieur Paul.
— Mais, chérie, il est de mon devoir de le prévenir des risques qu’il court.
— Docteur, je me porte comme un charme.
Je sens un pied de Fernanda qui vient se coller au mien, sous la table. Je ne bouge pas.
— J’ai bien connu un cardinal qui est mort en faisant l’amour chez une péripatéticienne. Il était dans la force de l’âge, lui aussi.
— Charles André, vous ne pouvez pas généraliser !
Le genou de Fernanda se colle au mien.
— Et bien non, ma chère, je ne suis que colonel. Ha ! Ha ! Ha ! Le colonel moutarde. Ha ! Ha ! Ha !
Il rit nerveusement sans pouvoir s’arrêter. Fernanda me jette un regard de détresse qui appelle au secours. Avec Charles André qui gagatise elle ne doit pas s’amuser tous les jours.
J’en profite pour m’éclipser. Je regarde ma montre et m’exclame :
— Hé là ! déjà 21 heures 30… On m’attend. Je suis désolé de vous quitter. Bon bridge et à demain, mes amis…
Je me lève. Je sens du désespoir dans le regard de Fernanda.
— Vous n’allez pas nous quitter si tôt ?
— Je suis désolé, Fernanda… Bonne nuit !
22 :00
J’ai pris un bain et je me suis parfumé. Je me sens parfaitement détendu. J’allume les bougies autour du Pentacle et j’éteins les lumières. C’est l’ambiance des grands soirs. C’est presque Noël. Il fait doux. Un alizé traverse la terrasse, chargé des parfums de l’océan. Simona est allongée sur sa chaise longue, elle est toujours plongée dans « Albert le Dingue ». Au loin, on entend la mer, la nuit est étoilée et la pleine lune brille dans le ciel. Elle me jette un regard complice :
— Alors, tu as tout préparé ? Tu n’as rien oublié ?
Je réfléchis un instant, lorsque Simona fait une remarque c’est rarement sans raison.
— Mais bien sûr, la sacoche.
Elle est restée dans le cache. On ne sait jamais, il vaut mieux que je l’aie à portée de main, même si je ne m’en sers pas. Je me précipite. Laura ne va pas tarder. J’ai commandé le dîner pour 22 heures, elle est en retard. Je récupère la précieuse sacoche. Je remets la latte du plancher. Dans la sacoche, je récupère le saigneur et le pose sur la table sous un journal. Puis je range la sacoche dans l’armoire.
Simona hurle sur la terrasse :
— Je pourrais vous regarder baiser, ça m’excite. Tu feras en sorte que je la vois bien, hein ? Albert ! Tu me réponds ?
— Mais oui, mais oui…
— Et puis met un peu de musique. Où as-tu mis le CD de Jimmy Hendrix ?
— Lequel ?
— Electric Ladyland ! Là où il y a les filles à poil sur la pochette.
— Il est là…
Je le place dans le lecteur. C’est parti pour deux heures de magie sonore. Je suis capable de reproduire avec ma langue le son saturé de la Fender et de faire à la perfection la guitare solo de « All along the Watchtower » :
— Lang long leng leng leng leng, CHHHHH, Lang long leng leng leng leng, CHHHHH, Lang long leng leng leng leng…
Impressionnant, non ?
Quand on frappe à la porte. Je me précipite pour ouvrir. C’est elle. Elle pousse un grand chariot sur lequel fume un repas pantagruélique. Il y a deux magnifiques couverts, les mets sont protégés par des cloches comme des gros seins en argent. Ça brille, ça fume, ça sent bon. Le vin est carafé. Rien ne manque pour faire un festin.
Laura pousse le chariot près de la table.
Une autre odeur délicieuse envahit la pièce. Elle s’est parfumée, mais a gardé son tablier et sa tenue de service. Je n’arrive toujours pas à déterminer ce parfum qui me rend fou.
Je la prends par la taille. On s’embrasse à pleine bouche, elle a un goût magique qui déchaîne une cascade de plaisir dans tout mon corps :
— Il me tardait ce moment, ça a été très long ce soir, leur bridge n’en finissait pas. La « Fernanda », cette poufiasse, je ne la supporte plus ! J’ai cru mourir. Mettons nous à table, je suis morte de faim. Sinon ça va refroidir.
Laura s’affaire. Je me mets à table. Elle dispose les couverts. Les bougies créent une atmosphère de fête. Profitant de ce que Laura à l’attention détournée, je prends discrètement le saigneur et le pose sur le chariot. Elle enlève sa veste de service. Un joli décolleté apparaît. Sa petite croix en or brille sur son cou.
Elle saisit la carafe et remplit mon verre d’un vin charpenté et tannique. Je renifle.
— Bordeaux ?
— Château Margaux premier cru classé 98. J’ai pris le meilleur dans la cave.
Laura plante son nez dans son verre, elle se concentre et ferme les yeux.
— Je l’ai ouvert il y a deux heures. Il devrait être parfait.
Je la regarde un peu médusé. Elle trempe ses lèvres dans l’élixir rubis. Elle a un regard extatique et une moustache sous le nez. Elle fait tourner le vin dans sa bouche.
— Il est tannique, framboise, banane, moisissure.
Je goutte à mon tour.
« Orgasme gustatif » est faible pour qualifier ce que ressentent mes papilles à la première gorgée. Le titillement du palais est délicieux. Mes glandes salivaires explosent littéralement. C’est un feu d’artifice gustatif, un déluge de sensations exacerbées. Un véritable coït buccal.
Soudain Laura aperçoit le saigneur posé sur le chariot. Elle le prend :
— C’est un couteau de cuisine ? Le chef a dû l’oublier sur le chariot…
— Ce n’est pas très grave, on lui rendra plus tard, dis-je mine de rien.
Elle touche la lame du bout des doigts.
— Il coupe comme une lame de rasoir.
Elle le repose sur la table. Puis elle soulève le couvercle d’un petit plat en argent et découvre deux magnifiques portions de foie gras, délicatement posées sur un petit nid de salade verte où brillent des copeaux de gélatine dorée.
— Je te sers, dit-elle avec gourmandise.
Je tends mon assiette. Elle me sert.
Puis je déplie mon énorme serviette en tissu blanc sur mes genoux. J’attrape le moulin à poivre et tourne trois tours qui noircissent la surface rosée du foie. Je plante ma fourchette et coupe un morceau. Je déguste. Croque dans une tranche de pain grillé et mastique ce bol alimentaire. C’est divin. Ça tourne dans ma bouche. La chair grasse fond délicieusement. Laura se régale elle aussi. A cet instant, je l’affirme, nous somme devant l’expérience la plus sophistiquée, la plus complexe et la plus mystérieuse de l’univers connu et probablement inconnu.
Un petit verre de Pacherenc de Vic Bilh vient clôturer cette suave mise en bouche. Le blanc liquoreux sur le foie gras est une hérésie qu’on tolère si c’est du Vic Bilh.
Laura soulève un autre couvercle en argent. Les filets de soles sont là, dans la sauce Bonne Femme. Sublime réduction de poissons, véritable colophane déglacée au vin blanc, réduite à nouveau à feu vif et encore déglacée à la crème fraîche. Des champignons de Paris à point venant parachever le chef d’œuvre.
Nous prenons le temps. Déglutissant respectueusement. Croquant religieusement. En prenant soin de retenir les acides gastriques de manière à prolonger la digestion au maximum…
23 :00
Elle frotte son ventre contre le mien. Je la soulève et la pousse contre le lit. Elle tombe et s’allonge. Les bras en croix et les jambes écartées. Je pose mes mains sur ses cuisses à la limite de ses bas noirs. Le bout de mes doigts remonte sur la peau douce jusqu’à l’ourlet de sa culotte rouge. Là, d’une pression, ils glissent sous l’élastique et trouvent un duvet charmant.
— Oh Paul !
Je caresse sous le nylon. Elle relève ses jambes pour mieux s’offrir.
— La salope !
— Tais-toi, Simona !
— Tu as dit quelque chose ? Mon amour ? supplie Laura.
— Ce n’est rien, chérie, c’est trop bon…
Je ne supporte pas les commentaires de Simona. Quand elle est jalouse son langage devient vulgaire et casse mes élans. Heureusement que Laura ne s’aperçoit de rien.
Je glisse trois doigts dans un enclos humide.
— Oh ! Paul ! gémit-elle.
Je la déshabille complètement. Je connais son corps par cœur. Elle se laisse faire.
Je me déshabille à mon tour. Nos vêtements sur le sol sont comme des pétales de rose.
Nous faisons l’amour.
Simona mate…
23 :55
Sur la table, j’allume une dizaine de bougies. Puis, je prends une assiette sur laquelle je répands le précieux mélange du docteur Klaus Reich. Je trace six lignes.
— Détend-toi. Je t’ai préparé un petit cocktail, ma chérie.
— Oh Paul, c’est trop… J’ai hâte de connaître cette « Révélation du Pentacle ».
Son visage, éclairé par les bougies, est d’une beauté irréelle. La lumière danse sur sa peau et dans ses grands yeux noirs. Ses épaules et ses seins sont magnifiques, tout en courbure, en onde douce, en chef d’œuvre d’art contemporain.
— Laura, comme tu es belle !
Sur la terrasse Simona hurle :
— Vas-y, Albert, tu vas te la faire… Le couteau est sur la table. Découpe là… Ah ! Je vais jouir.
Elle m’énerve, j’essaie de ne pas me laisser perturber. Simona va sûrement avoir ses règles, ça la rend agressive. Là encore, je me permets de critiquer la Nature. Car ces règles sont une vraie plaie. C’est quand même incroyable, on est entré dans le Troisième Millénaire et les femmes ont toujours cette horrible maladie, car c’est une maladie, comme la vieillesse.
Qui aurait cru ça ?
Mais que font les scientifiques ?
Bien sûr, nous, les garçons, nous ne devons pas trop nous en plaindre, car ça nous rend parfois service. Mais quand même, ces « pertes » qui sèchent et noircissent au fond des culottes, c’est ignoble.
Laura prend une paille. Elle se la plante dans le nez et sniffe d’un trait la première ligne blanche sur l’assiette.
Je l’imite. Dès le premier instant, je sais que le mélange est parfait. Les six lignes disparaissent. J’ai l’impression de me transformer en super nova et d’exploser aux confins de la galaxie.
— Viens, mettons nous vite sur le Pentacle.
Je la prends par la main. Nous nous asseyons par terre, au centre du cercle, face à face. Je lui tiens les mains. Nous sommes nus, entourés de bougies qui nous éclairent et créent une ambiance de mystère et de magie. Soudain, très lentement, tout se met à tourner autour de nous, comme un manège.
— Laura, regarde-moi bien dans les yeux.
— Oui Paul.
Son regard noir accroche le mien très fortement. Je lui serre les mains, elle me répond.
— Embrasse-moi, fort…
Elle avance son visage, nos lèvres se touchent. Je sens sa langue sucrée entrer dans ma bouche. Les deux muscles se frottent et se caressent nous procurant une sensation délicieuse, toutes nos glandes sont en alerte surtout les salivaires. Ça mouille et ça bave. Je sens la rage du mâle monter en moi. Je ne vais pas tarder à devenir grossier. Enfin c’est à mon tour de glisser ma langue dans sa bouche. Comme une succube, elle l’aspire d’une succion fellatrice. Lentement, mon organe gustatif glisse et s’échappe comme un phallus dans sa gorge profonde. Soudain, je sens un vide dans ma bouche. Un manque. Un frisson parcourt tout mon corps. Je me retire et me redresse. Laura me regarde, elle a deux yeux rouges halluciné.
« Bon dieu !!! »
Je n’ai plus de langue ! Ma bouche est vide. Elle m’a quitté. Je ne peux plus parler. Pourtant je sens encore mes papilles lécher les parois sucrées de ses entrailles. Comme si je téléguidais ma langue dans son corps.
Ceci est exceptionnel. Je n’ai jamais ressenti ces sensations auparavant. Laura a les yeux révulsés. Elle semble plongée dans un état hypnotique. Elle se penche sur moi, embrasse mon corps. Je sens les petites succions de ses lèvres sur mon ventre. Elle trouve mon pénis. La pièce tourne autour de nous, maintenant, à une vitesse vertigineuse. Les bougies font comme un cercle de lumière parfaitement lisse. Laura avale mon sexe goulûment. Elle est déchaînée. On dirait qu’elle veut engloutir entièrement la turgescence. Lorsqu’elle y parvient, je sens une rupture indolore. Je m’aperçois enfin avec horreur qu’il n’y a plus rien dans mon bas ventre.
« Elle a réellement avalé mon sexe!!!»
Il se passe quelque chose de tout a fait anormal. Mais je n’ai pas la force de réagir. Jimmy Hendrix torture sa guitare, j’entend le son déformé de « Bold as Love ».
« Horreur, elle a avalé mes testicules… »
Je suis paralysé, mes membres pèsent des tonnes.
Laura passe ses bras autour de mon cou. Elle frotte sa joue contre ma joue. Je sens une caresse mouillée sur mon oreille. Soudain je n’entends plus rien d’un coté. Incapable de réagir, je comprends qu’elle a avalé mon oreille. Elle est déjà sur l’autre oreille. Je deviens sourd je n’entends plus rien. Je me sens faible. Mon cœur bat la chamade.
Laura lèche mes mains. Et je m’aperçois que je n’ai plus de doigts à la main droite. Pourtant j’ai la sensation de mes doigts. Je touche des choses molles, des choses humides des muqueuses organiques.
J’écoute. Dans le silence il y a un chant. Une voix chaude de jeune femme, un chant de sirène qui psalmodie une mélodie lancinante et triste à mourir. Soudain, dans une brume épaisse, violette, je vois une tour en pierre magnifique, dans un ciel tourmenté où tournoient des oiseaux de mauvais augure.
“Purple Haze; All Along the Watchtower.”
Je n’aime pas ça, j’ai des visions ou plutôt des hallucinations. Je sens mes doigts. Un goût salé sur ma langue. Comment puis-je réagir ? Je n’ai plus de corps, je suis un pur esprit. Je tombe dans un puits sans fin, un puits de tristesse et de pessimisme extrême. Ce que je ressens est insupportable, indescriptible. La puissance de mes sens semble décuplée, je me sens hypra-lucide. Je suis au-delà du réel, dans un autre monde…
La peur de perdre conscience me tétanise. Je me rends compte que je suis en train de mourir.
Est-ce une overdose ?
C’est bien possible.
VII.
Dimanche 7 septembre
« Les Fantômes de l’Aube »
03 :00
Je revois des images défiler…
Un enfant qui joue, accroupi dans un jardin, avec des lombrics. Un hachoir qui broie une viande rouge comme de la pâte à modeler. Des visages familiers. Simona.
J’entends des voix lointaines :
« Albert nous sommes tous là. Nous t’attendons depuis si longtemps. Albert ! Albert ! Albert ! »
Une foule hurle. Je réponds :
« Mais qui me parle ? »
« Tu ne nous reconnais pas ? »
J’ouvre mes pauvres yeux, lubrifiés de larmes, comme si je sortais d’un sommeil profond.
Tout s’éclaircit brusquement, un rideau se lève devant moi : je suis dans un amphithéâtre. Comme un conférencier devant un parterre de quelques centaines d’auditeurs. J’ai un costume neuf. Ils applaudissent. Ils m’applaudissent :
« Standing ovation ! »
Je les regarde un par un. Je reconnais Dumoulin et son crâne d’obus. Le Docteur Reich qui transpire et applaudit. Simona au premier rang. Le gastro-entérologue Gluch semble avoir un peu grossi. Riton s’avance vers moi, la larme à l’œil, le service d’ordre le retient. Je lui fais un petit signe amical. Le journaliste Daniel Desprat est là aussi avec ses cheveux gras. Henriette. Jérôme. Sylvain. Jean Martial. Tout le monde est là : debout.
« Standing ovation »
Il y a bien trois cent personnes. Je suis ému.
Après quelques minutes, le silence revient. Ils s’assoient les uns après les autres. Je suis devant un pupitre, un micro est là devant ma bouche. Je dois parler. Tout le monde attend dans le silence. Je m’éclaircis la voix, je chevrote :
-Les enfants sont malheureux quand ils se sentent abandonnés de leurs parents.
(Qu’est-ce que je raconte)
J’ai la bouche sèche. J’enchaîne d’une voix pathétique :
— Rien n’est plus beau que le petit matin blême. La pâleur du jour. La sensation magique de l’extrême perception d’un jour neuf, cadeaux fantastique de la Nature, au delà de la conscience et de l’intelligence. Quand on sait que nos jours sont comptés et que nous ne les comptons pas. Imaginer l’inimaginable seconde que nous ne vivrons pas, celle qui suivra imperturbablement notre mort, me rend triste. Cette énergie noire, je dirais même cette énergie magique, qui fait s’éloigner chaque point de l’univers l’un de l’autre à vitesse égale, mais qui s’accélère dans le temps, me parait surréaliste, hallucinante et bancale. On nous raconte des histoires à dormir debout. Je ne crois plus en rien. J’ai trop aimé Sagan…
Silence dans la salle. Tout le monde se regarde. Ils n’ont rien compris mais néanmoins respectent mes paroles.
Soudain, au fond, des lumières s’allument. Devant moi, mon auditoire se retourne, il y a une autre chaire. Un autre pupitre, là, au fond. Les fauteuils tournent mécaniquement et les gens qui sont assis dessus, avec. La foule qui m’applaudissait tout à l’heure, me tourne maintenant le dos. Il y a quelqu’un au pupitre en face.
Mon dieu ! C’est Laura. J’entends sa voix dans la sono et l’écho. Elle m’interpelle :
— Albert, tu as tué tous ces gens ici présent !
Elle m’appelle Albert, c’est mauvais signe. Elle a une voix que je ne lui connais pas. Ce n’est pas la gentille Laura, discrète, dévouée que je connais. C’est un adversaire redoutable qui est en face de moi. Je me suis laissé abuser comme un gamin…
Je l’appelle :
— Laura ?
— Tu les as torturés, massacrés.
— Que se passe-t-il, Laura ?
— Ce soir, tu vas mourir Albert ! J’ai mis du cyanure dans ton repas. Je t’ai empoisonné. Je t’ai tué.
— Laura. Pourquoi ?
Sa voix s’affaiblit.
— Tu as tué maman…
Elle éclate en sanglots. J’ai peur de comprendre. Je ne savais pas que Simona avait une fille.
— Tu es la fille de Simona ?
Elle hurle d’une voix étranglée :
— Je t’ai démasqué, tu es Albert le Dingue. Tu as mangé le cœur de maman. Et moi je vais bouffer le tien, salaud…
Elle s’énerve. S’étouffe dans un sanglot. Je suis abasourdi. Simona ne m’a rien dit. Je la cherche du regard dans la foule. Je la vois qui baisse la tête. La foule proteste.
J’hurle :
— Simona, pourquoi tu ne m’as rien dit ?
Elle se cache. La foule la hue.
Laura la fille de Simona…
Quand une sorte d’huissier vient poser un pli sur mon pupitre. C’est une note. Je la décachette. Je lis en silence :
« Albert,
Restez calme. Pensez à la formule que je vous ai apprise. Prononcez-là en pensant à la fille. Elle vous fera « PERMUTER ».
Merci pour tout.
Signé :
Klaus REICH »
J’aperçois Reich au premier rang, il me fait un clin d’œil. La formule, je dois prononcer la formule du Docteur Reich, celle qui déclenche la « Permutation Mentale ». Après tout, pourquoi pas, au point où j’en suis. Laura m’a démasqué. Je n’ai rien à perdre.
J’hurle dans le micro :
“ Herr töt zaglo. Kam zöt erroe…”
Voila c’est ça. Je hurle encore:
“ Herr töt zaglo. Kam zöt erroe…”
Ma voix résonne dans la sono pourrie.
J’ai des sensations étranges. Tout disparaît peu à peu devant moi. Je vois une lumière blanche, un tunnel de lumière blanche. Je meurs ?
J’aperçois les contours de la chambre 109. Autour de moi, les murs cessent lentement de tourner. Comme si le mauvais trip était est en train de se terminer doucement. J’ai mal au cœur. Je ressens une terrible envie de vomir.
« Heuark !!! »
Tout le repas y passe, je vomis dans d’atroces hoquets. Mon estomac se vide devant moi. J’ouvre mes yeux, ils pleurent. Ils piquent. J’ai des cheveux devant les yeux. Il y a de la lumière qui oscille, le dernier feu des bougies. Ma vue se stabilise peu à peu. Soudain, je vois une chose impossible et pourtant bien réelle. Un corps nu est allongé devant moi sur le Pentacle, les bras en croix. Obèse. Blanc. Horriblement mutilé…
Ce n’est pas Laura. C’est…
C’est moi.
Je suis atrocement lacéré. Couvert de vomissures. Je baigne dans une mare de sang. Il n’y a plus d’yeux dans mes orbites, plus de doigts à mes mains, je n’ai plus de sexe. Mes morceaux gisent ça et là sur le sol. Ma poitrine est épouvantablement ouverte.
Je crie malgré moi en proie à une crise d’hystérie que je ne contrôle pas :
— Salaud, crève… Charogne !
Je ressens de la haine. Je pleure.
Suis-je mort ? Ma bouche crie :
— Ordure !!! Crève…
Un démon en moi se déchaîne. Le démon en moi…
« Ou plutôt moi dans un démon !!! »
Car comme dans un voyage astral, je ne suis plus dans mon corps. Je regarde mes mains sales, souillées de sang, au bout de mes bras. Je reconnais les mains de Laura, les bras de Laura, les seins de Laura. Et là, dans ma main: le saigneur sanguinolent. Elle m’a mutilé avec le saigneur.
Je sens des picotements dans mes nouveaux membres. Je prends possession de ce corps. Peu à peu Laura se tait, elle me laisse la place. Je me penche sur mon cadavre. Il ne respire plus. Il pue. Je frissonne de dégoût.
Je reste là hagard…
04 :00
Les bougies s’éteignent une à une. Les lumières de l’aube s’allument très lentement. Par la terrasse je vois le soleil se lever, majestueux. Fantastique sur l’océan translucide et calme.
Je réalise peu à peu que je viens de réussir l’expérience de « Permutation Mentale ».
Laura a pris possession de mon corps.
Et moi j’ai pris le sien.
Je sens une brûlure entre mes cuisses. Je suis humide. Je n’en reviens pas, elle jouissait. Elle m’assassinait en jouissant. A moins qu’elle ait uriné.
Et moi je suis là, je baigne dans une énorme marre de sang, il y en a partout. Je regarde mon cadavre, mon sexe arraché. Je l’aimais bien ce sexe. Combien de fois ais-je décalotté ce gland pour le caresser dans la douce chaleur des lits de mes nuits. Combien de fois a-t-il craché ses liqueurs de plaisir procurant l’extase sublime et divine ?
« Autant de fois qu’il a connu de jours, dès que j’ai eu huit ans. »
Et ce visage qui est le mien. Tordu de douleur, les oreilles arrachées elles aussi.
Pourquoi m’a-t-elle arraché les oreilles ?
C’est cruel…
« Elle me détestait donc tant que ça. »
Je me sens orphelin de Laura. De celle qui me couvrait de caresses et d’amour. Celle qui cachait l’autre. La fille de Simona. Comment ai-je pu tomber dans ce piège grossier ? Dès mon arrivée, elle a deviné que j’étais l’ange exterminateur. Elle m’a flairé. Elle a joué ce rôle de soubrette, attendant dans l’ombre du mensonge le moment de me tuer. Pourquoi a-t-elle attendu si longtemps ? Elle m’aimait peut-être. Un peu ?
« Laura tu me manques. »
Je regarde ma poitrine. Je réalise que j’ai des seins. Les seins de Laura. Je les caresse. Dire qu’ils sont à moi maintenant. Je ressens une émotion nouvelle. Je titille les pointes. C’est étrange, cela provoque l’éclatement de petites bulles de plaisir dans mon ventre.
Comme mes cuisses sont belles, lisses, fines, jeunes. Je vais pouvoir en disposer maintenant à ma guise. Je les écarte et passe mes mains sur mon désormais pubis.
Je regarde le corps nu et pitoyable d’Albert. Je ramasse le pénis sectionné qui traîne par terre, il est durci par la mort et déjà froid. Je le glisse dans mon nouveau vagin comme un ultime et dérisoire godemiché. Je le réchauffe.
Je vais, je viens, lentement. Un nouveau plaisir monte en moi. J’accélère, jusqu’à ce qu’un cri rauque sorte de ma gorge. Je jouis bestialement. Après tout, personne ne me voit. Je viens de ressentir mon premier orgasme :
« C’est GÉANT. »
« Je comprends maintenant pourquoi on peut penser des femmes que ce sont toutes des salopes.
Je comprends… Et je leur pardonne. »
— T’es un sacré vicelard, Albert…
— Quoi ? Qui parle ?
C’est Simona, elle se balance, nue, sur la chaise longue. Elle a le visage barbouillé de sang.
— Simona. Tu as tout vu ?
— Fabuleux, j’ai pris un pied terrible. Une bonne dizaine d’orgasmes à la suite. Championne du monde. J’ai battu le record. Le meilleur c’est quand elle a pris ton couteau et qu’elle t’a coupé en morceaux. Oh, Albert, passe-moi ta bite ! S’il te plait, mon chou, prête-la moi…
— Il va falloir que tu m’expliques des choses Simona. Elle est de qui cette fille que tu m’as caché ?
— Mais de toi mon chéri. Tu me l’as faite dans le blockhaus 128, tu as oublié ? La première année où l’on s’est connus. J’ai voulu te le dire, mais j’avais peur que tu me la prennes et puis tu m’as tuée avant. Passes moi la ! s’il te plait.
— Simona, je ne te crois pas…
— Passe la moi ! s’il te plait.
Je lui tends le bout de viande froid. Elle me l’arrache des mains.
— Merci mon chéri!
Je n’ai pas le moral. Je me sens bizarre. Je me lève en titubant et m’allonge sur le lit. Le jour se lève.
J’entends les gémissements de Simona qui jouit sur la terrasse, on dirait une cueca brésilienne.
Laura ma fille…
C’est incroyable.
Je vais me réveiller de ce terrible cauchemar.
Je vais me réveiller…
06 :00
Bon ! Le cauchemar persiste.
Ma décision est prise : j’appelle les flics. De toutes les manières, je n’arrive pas à dormir. La chambre est sens dessus dessous. Mon cadavre écartelé sur le Pentacle est une horreur, il pue. Je sens un dérèglement hormonal dans mon nouvel organisme qui provoque de temps à autre une arythmie cardiaque très désagréable. Le manque de sommeil, le travail, la drogue ont affaibli mon nouveau corps. Peut-être que, si Laura n’avait pas été ma fille, la « Permutation du docteur Reich » n’aurait pas fonctionné par manque de compatibilité.
Je m’en sors plutôt pas mal.
Je décroche le téléphone posé sur la table de nuit et compose le numéro des urgences :
— Allo, prévenez la police ? Il y a un cadavre dans la chambre 109 de l’hôtel Miramar.
Ma nouvelle voix, si claire, si féminine, me trouble. Je vais avoir du mal à m’y habituer.
Je n’ai plus qu’à attendre. J’ai la migraine. Ils vont arriver, je vais tout leur raconter :
Que ce salaud a tué ma mère et lui a bouffé le cœur, il y a vingt ans, ici, dans cette chambre.
Que c’est le vrai Albert le Dingue. Qu’il a voulu me tuer, il m’a droguée. Ça m’a rendue folle. Je l’ai empoisonné et je l’ai poignardé. Le poison ? c’est de la mort au rat que j’ai piqué aux cuisines, le chef m’avait dit que ça pouvait tuer un cheval.
Ce salaud a même tué mon petit ami le journaliste, j’ai voulu le venger.
Ils vont me libérer dans la journée. Bien sûr je serais mise à la disposition de la justice, mais cela ne m’empêchera pas de vaquer à mes occupations.
Il faudra que j’aille à Bordeaux, j’ai une cache à l’Hôtel des Quatre Sœurs, dans laquelle j’ai planqué une carte Gold, et une grosse liasse de billets de 500 euros.
J’entends les sirènes de la police. J’essaie de me remettre le soutien gorge qui traîne sur le parquet. J’ai du mal, ça n’est pas évident. Je m’y reprends à plusieurs fois. Là !
Ça y est…
J’enfile le slip de Laura. L’élastique claque sur ma peau ferme. Je réalise l’incroyable : je n’ai pas fini de me regarder dans les miroirs.
J’exulte :
« Putain, je suis jeune et belle ! C’est génial !!! »
Je m’enveloppe dans une couverture que j’arrache au lit. Je n’ai rien à moi ici. Je leur laisse le sachet de poudre, le couteau. Je récupère juste dans la poche de mon ex-veste le bout de nappe sur lequel j’ai écrit mon poème.
Je me relis :
« A la lueur
De l’aube
L’Exterminateur
Mange
Le cœur
D’un ange… »
Je le garde, pour mon recueil…
VIII.
Lundi 8 septembre
« Postface »
09 :30
Je lis le journal Sud-ouest, devant un café croissant, au buffet de la gare de Dax. Dans le kiosque, je fais la une des journaux. Je suis partout en première page :
« ALBERT LE DINGUE EST MORT LA NUIT DERNIERE ! »
— Brrr… je frissonne.
« Non sans avoir fait encore plusieurs victimes ! Un vacancier, docteur militaire à la retraite, à qui il a fait avaler une boîte entière de pilules de Viagra (voir interview de sa veuve dans les pages intérieures).
— Fernanda ! salope !
Il aurait également assassiné notre journaliste Daniel Desprat (nos condoléances à sa famille) dont on n’a pas encore retrouvé le corps.
— Ils vont le chercher encore longtemps.
La police a procédé à l’analyse de canards gras, en conserve, trouvés dans la sinistre chambre 109 où vivait le tueur en série. Il semblerait qu’elles proviennent de la cave de Riton l’Élégant, qui a péri dans l’explosion de sa villa en début de semaine. L’enquête se poursuit.
C’est une jeune serveuse de l’hôtel Miramar qui a démasqué le monstre et l’a empoisonné, alors que celui-ci allait l’assassiner.
Cette jeune serveuse n’est autre que la fille de Simona Nelson, assassinée elle aussi mystérieusement au Miramar, il y a vingt ans presque jour pour jours. La jeune Laura, persuadée que les tueurs reviennent toujours, tôt ou tard, sur les lieux de leurs crimes, a attendu pendant des années le retour de l’assassin de sa mère en se faisant embaucher dans le célèbre hôtel de la côte. Elle est dans un état de choc et ne peut encore répondre aux questions des enquêteurs.
Une messe sera dîtes cet après-midi en mémoire des victimes de cette tragédie. »
Ma photo est complètement loupée. C’est toujours pareil… J’ai une sale gueule. Celle de Laura est plus réussie. Voila ce que c’est que de ne pas avoir d’attachée de presse. Je regarde les pages intérieures.
« LA FIN D’UN EPOUVANTABLE TUEUR EN SERIE. »
« Georgette Cazade employée au Miramar a dû approcher le monstre, elle répond aux questions de notre envoyé spécial : — J’ai tout vu ! Il était cruel, avec des yeux terribles, un air méchant. Il a failli me tuer moi aussi. Je dois ma vie au fait que j’étais de repos. Il a tenté de me violer, un soir… »
Georgette, toi aussi tu me trahis. J’aurais dû te découper en tranches, tu aurais fait de beaux jambons. J’aurais mis tes camagnons dans une soupe de légumes avec des poireaux, des carottes, du chou, des pommes de terres et du gros sel. Ta graisse aurait surnagé dans ce potage, faisant comme des yeux écarquillés qui m’auraient regardé, étonnés, et auxquels j’aurais répondu :
« Georgette, marchande de quéquette ! »
10 :00
Les flics m’ont torturé pendant ma garde à vue. Torturé, c’est façon de parler, disons qu’ils m’ont posé mille questions. Je les ai convaincu qu’Albert le Dingue m’avait drogué pour me violer et me tuer, comme ma mère, mais que j’avais été plus rapide que lui. J’avais empoisonné son repas et dans la démence provoquée par la drogue qu’il m’avait fait prendre, j’ai mutilé son cadavre.
J’ai dû accepter un suivi psychiatrique. Je dois consulter une fois par mois jusqu’à nouvel ordre.
Ils étaient trop contents d’avoir mis fin à la carrière de l’épouvantable Albert, « le serial killer du siècle » comme dit la radio. Ils ont compati à mon malheur de « fille maudite, qui a vu l’enfer et qui a souffert toute sa vie de la mort horrible de sa mère… ».
Ils ont un cœur finalement ces flics, si on regarde bien, ils sont comme nous…
Ça rassure.
Bon, ce n’est pas tout, ça va être l’heure de mon train. On m’attend à Lyon. J’ai récupéré le sac de Laura dans sa chambre. Il contient ses clés, ses papiers, du linge propre. J’ai même découvert son parfum dans sa cabane : il s’appelle « Albert Nipon ». Quelque part, elle avait une attirance, une obsession, pour se parfumer avec un parfum qui porte mon nom. Si je n’étais pas entouré d’elle, de sa peau, de ses cheveux, de ses vêtements, je serais le plus malheureux des hommes. Quelque part, j’ai toujours rêvé d’avoir une fille.
J’ai donné ma démission au Miramar. Ils m’ont payé le salaire du mois de septembre complet. Je n’arrête pas de tousser pour m’éclaircir la voix quand je parle. Ça m’énerve. Je ne suis pas encore habitué à ma féminité. Il faut que je me fasse faire un passeport optique en règle. Et que je m’habille plus classe. Mon jean est usé et tâché de partout. Mes baskets roses sont râpés au bout. Mon pull griffé « esprit » me fait honte. Il n’y a que la petite médaille en or, que je porte autour de mon cou, qui trouve grâce à mes yeux.
Elle me rappellera toujours « Laura ».
Et puis, surtout, il faut que je trouve une pharmacie pour acheter des serviettes hygiéniques, des tampax et un peu de maquillage.
Je me sens ballonnée. Je suis nerveuse.
J’espère juste que je ne suis pas enceinte…
FIN







 Henri Salvador est mort en tenant sa revanche, au moins, sur les gens qui n’ont pas cru en lui et qui l’ont encensé cinquante après. Ça lui fait une belle jambe, me direz-vous, mais je pense que dans son rire, qu’il avait forcé, il y avait pas mal de rancœur sourde sur les années noires qu’on lui a fait subir à marche forcée.
Henri Salvador est mort en tenant sa revanche, au moins, sur les gens qui n’ont pas cru en lui et qui l’ont encensé cinquante après. Ça lui fait une belle jambe, me direz-vous, mais je pense que dans son rire, qu’il avait forcé, il y avait pas mal de rancœur sourde sur les années noires qu’on lui a fait subir à marche forcée.